mardi, 31 octobre 2006
En vente dans toutes les mauvaises librairies
Les livres « boîtes de chocolats » commencent à être disposés aux éventaires des librairies. À la Fnac-Italie (peut-on appliquer à ce lieu le nom de librairie ?), on crée des « rayons » à même le sol pour les coffrets de DVD, entassés comme des boîtes de conserves. La grande fiesta répugnante de la fin de l’année commence maintenant début octobre, au plus tard mi-octobre.
Allez les voir, ces livres qui ne servent à rien ! Ils sont d’ailleurs magnifiques, souvent. Honnêtement, objectivement, on fait des albums de plus en plus beaux – et lourds, et chers – c’est incroyable. On n’oublie pas l’immuable Rimbaud. Si le malheureux gamin ardennais pouvait voir ce qu’il inspire aujourd’hui ! Il y a longtemps déjà, Paulhan observait que « le commentaire à Rimbaud est devenu un genre littéraire en soi. » Ça continue à raison de quatre à six livres par an, et je passe sous silence le délire éditorial qui fut celui de 1991, pour le centenaire de sa mort. Viennent de paraître des livres de luxe signés d’autorités. Lefrère, biographe du poète et spécialiste reconnu depuis des années, publie son énième Rimbaud sous forme d’un album luxueux constitué de documents reproduits sur une page avec, en regard, un bref paragraphe. Rien de neuf, évidemment. On n’a rien retrouvé de nouveau, concernant le diablotin de Charleville, depuis 1970, à l’exception, il y a quelque temps, d’une photographie dont on n’est pas certain qu’elle le représente réellement. Cela n’empêche nullement la parution de nouveaux livres, et allez donc ! On propose aussi un gros album luxueux exclusivement consacré à l’affaire de Bruxelles, sous l’égide de l’Académie royale de Belgique. Comme si l’on ne savait pas absolument tout de cette histoire… Et avec une énormité en quatrième de couverture, où il est dit que c’est à Bruxelles que Rimbe et Lélian vont se fâcher définitivement, ce qui est absolument faux puisqu’ils se reverront une fois encore à Stuttgart, deux ans plus tard, en 1875, retrouvailles à l’issue desquelles l’ingrat garnement cassera la gueule de Verlaine et le laissera pour mort sur le bord du chemin. Ce qui n’empêchera pas le poète de tout mettre en œuvre, par la suite, pour faire connaître au monde l’auteur génial qui a bouleversé sa vie, celle de sa femme, celle de son fils. Eh bien, rien n’empêche, on affirme tranquillement que leur brouille définitive se produisit à Bruxelles en 1873. Avec le blanc-seing d’une institution.
14:45 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (3)
lundi, 30 octobre 2006
Comptes rendus
« En supposant un taux de droits d’auteur classique de 14 % en moyenne », note Le Monde du 28 octobre dernier, à propos des Bienveillantes. Peu importe d’ailleurs le sujet de l’article, c’est cette phrase révoltante que je retiens.
Puisque nous vivons dans un monde de chiffres, en général assénés d’autorité par des journalistes qui estiment toujours tout savoir alors qu’ils colportent seulement des idées reçues, voici, pour information, les pourcentages de droits qui me sont accordés par contrat, concernant mes livres parus.
1 - Léo Ferré, la mémoire et le temps, Seghers, 1987 : 8 %. À valoir de 40. 000 francs (avant déductions obligatoires et avant impôts.) Premiers et derniers droits perçus (après couverture de l’à-valoir) en 1994.
2 - Cabaret baroque, Le Bruit des autres, 1994 : rien, pas de contrat (on m’y reprendra.) Pas d’à-valoir.
3 - On n’emporte pas les arbres, L’Harmattan, 1998 : 0 % sur les mille premiers exemplaires (tirage : 500.) Pas d’à-valoir.
4 - Écrivains contemporains, L’Harmattan, 1999 : 0 % sur les mille premiers exemplaires (tirage : 500.) Pas d’à-valoir.
5 - Léo Ferré, une mémoire graphique, La Lauze, 2000 : 10 % à partager entre les deux co-auteurs, soit 5% (multiples relances pour être payé, contrat non respecté.) Pas d’à-valoir.
6 - Dix femmes, Éditions du Laquet, 2001 : 8 % (jamais versés.) Pas d’à-valoir.
7 - Albertine Sarrazin, une vie, Écriture, 2001 : 8 % (rien touché depuis 2001, l’à-valoir n’étant toujours pas couvert.) À-valoir de 15. 000 francs (avant déductions obligatoires et avant impôts.)
8 - Spectacle total, Éditions du Petit-Véhicule, 2002 : 7, 5 % (comptes non rendus, jamais rien touché.) Pas d’à-valoir.
9 - Avec le livre, propos et réflexions, L’Harmattan, 2003 : 0 % sur les cinq cents premiers exemplaires (tirage : 500.) Pas d’à-valoir.
10 - Les Chemins de Léo Ferré, Christian Pirot, 2005 : 10 %. Pas d’à-valoir.
11 - Les Films de Claude Sautet, Atlantica, 2005 : 4 % (la première année : 20 % de retenues contractuelles sur ces 4 %.) Pas d’à-valoir. (Multiples relances pour être payé.)
12 – Manon suivi de Guillemine, à paraître chez l’Harmattan : 0 % sur les cinq cents premiers exemplaires (tirage : 500.) Pas d’à-valoir.
J’ajoute que, contractuellement, il m’était imposé, pour les livres n° 3, 4 et 12, l’achat, à titre personnel, de cinquante exemplaires. Et, pour le livre n° 6, l’intéressement de l’éditeur sur les représentations éventuelles de la pièce (5 % des droits de la SACD à lui reverser.)
J’ajoute encore que, pour le livre n° 7, l’à-valoir de 15. 000 francs m’a fait sauter d’une tranche, ce qui m’a coûté 5.000 francs de supplément d'impôts. Je reconnais volontiers que l’éditeur n’y est pour rien. Il faut ajouter à cela environ 2.000 francs de frais (voyages, hôtels, restaurants, correspondance, téléphone, location de voitures...) occasionnés par les multiples déplacements nécessaires à la rédaction d’une biographie et bien entendu non pris en charge par l’éditeur. Cet ouvrage m’a donc rapporté 8.000 francs depuis 2001, soit 1.600 francs par an, soit 133, 33 francs par mois, ce qui représente 4, 44 francs par jour. Et même moins, puisque je n’ai pas tenu compte, ici, des prélèvements obligatoires sur les 15. 000 francs versés au départ. Qu’on sache enfin que ces 15. 000 francs devaient contractuellement être versés en trois fois et que, lassé d’attendre, j’ai dû réclamer les deuxième et troisième versements qui furent effectués en même temps. Autrement, je n’en aurais jamais vu la couleur.
N. B. : les pourcentages indiqués se calculent naturellement sur le prix de vente hors-taxes.
14:10 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 25 octobre 2006
Les éditeurs m’emmerdent
Mon douzième livre, groupant deux pièces de théâtre, devait, accepté depuis fin juin ou début juillet, paraître chez l’Harmattan. Depuis septembre, le service commercial bloque la fabrication au motif que le texte de quatrième de couverture ne leur convient pas. On m’a demandé une seconde mouture, que j’ai proposée immédiatement. Ça ne va toujours pas. Je refuse de modifier de nouveau le texte. Hier, à dix-huit heures, quelqu’un me téléphone à mon travail et laisse un message. Je rappelle ce matin. Il tente de me convaincre. Je reste calme, lui propose de faire lui-même le « raccord » demandé entre deux paragraphes, c’est lui qui refuse. Je réponds, en substance, que tout ça m’ennuie et demande qu’on m’envoie une lettre par laquelle nous annulons le contrat, d’un commun accord. Le livre ne sortira pas.
On imagine ce que m’a coûté cette décision. Il faut cependant savoir faire ce genre de sacrifice. Je ne suis pas prêt à n’importe quoi pour être publié.
10:55 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (7)
mardi, 24 octobre 2006
L’éditeur pourrissant
J’ai découvert les éditions Actes Sud en 1979, dans une petite librairie d’Apt (Vaucluse). La maison avait été fondée l’année précédente par Hubert Nyssen, écrivain belge amoureux du soleil de Provence. J’ai suivi le travail de cette maison jusqu’en 1986 environ. Depuis, petit à petit puis plus rapidement, je m’en suis détaché jusqu’à considérer qu’elle est devenue exemplaire : elle est, pour ce qui est de ses choix, tout ce que je n’aime pas. Cette opinion ne doit rien au fait d’avoir été refusé par elle à plusieurs reprises (j’ai été refusé par la terre entière, et je ne la déteste pas.) J’avais rencontré Bertrand Py, numéro deux de la maison, il y a vingt ans, dans les bureaux parisiens. Py est devenu ensuite le numéro un. J’avais aussi bavardé avec Nyssen au salon du Livre, en 1984, je crois. Martine s’était adressée à lui quelques années plus tard, au cours d’une rencontre dans une bibliothèque parisienne. Il lui avait parlé sans même la regarder dans les yeux.
J’avais lu en leur temps les trois tomes de L’Éditeur et son double, le journal que Nyssen publiait dans sa propre firme. J’y avais trouvé confirmation de mon désintérêt pour ce qu’il publiait, mais les livres de et sur l’édition sont un de mes dadas. Depuis plusieurs années, Nyssen ne fait plus paraître ses carnets. Mais, depuis novembre 2004, il les tient sur la Toile. Voilà un exemple intéressant de la différence d’intérêt qu’implique la différence de support. Ce qu’il nous raconte sur internet m’ennuie à mourir. Or, c’est la même chose que ce qu’il faisait paraître sous forme d’imprimé. Le même mélange de snobisme gentiment socialiste, d’érudition de salon, d’importance accordée à des livres que je ne veux même pas feuilleter, de grivoiserie légère, de vieillissement salace présenté (et sans doute vécu) comme une gourmandise du regard, de rêves d’homme à femmes qui sait tenir une plume mais n’a rien à raconter…
Pour être tout à fait franc, j’avais pris quelque plaisir à la lecture d’Éléonore à Dresde, mais Les Rois borgnes m’était tombé des mains. L’Italienne au rucher m’avait paru le comble de l’inutilité. Je n’avais pas détesté, en revanche, Du texte au livre, les avatars du sens ni Le Livre franc.
Sur internet, à présent, se trouve, avec fautes de frappe et, curieusement, l’ignorance des guillemets français, le mémento d’un éditeur qui lira, écrira et publiera des romans jusqu’à son dernier souffle, ajoutant les romans aux romans avant de lire quelques romans encore ; d’un éditeur qui, entre autres écrivains sans raison d’être, a imposé au monde entier, comme une découverte de première importance, un produit fabriqué : Nina Berberova, à elle seule le résumé d’Actes Sud.
15:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (26)
lundi, 09 octobre 2006
Ne croyez pas les éditeurs
Gilles Schlesser publie ce mois-ci, chez l’Archipel, un ouvrage intitulé Le Cabaret rive gauche. Comme l’indique son titre, il s’agit d’une histoire de ces lieux parisiens qui ont accueilli de nombreux artistes, de l’après-guerre à la fin des années 60 environ. Je l’attends avec impatience.
Bien entendu, l’éditeur affirme qu’il s’agit du premier livre consacré à un tel sujet. Pour les éditeurs, c’est toujours la première étude, toujours. Les éditeurs ne doutent de rien, surtout quand ils ne s’y connaissent pas.
Le sujet a déjà été traité par Geneviève Latour dans un volume intitulé Le « cabaret-théâtre », 1945-1965, publié par la Bibliothèque historique de la ville de Paris en 1996. Il s’agissait d’un catalogue d’exposition, mais d’un catalogue comme on les conçoit depuis quelques années, c’est-à-dire un véritable livre, avec un texte important, solide. L’exposition, d’ailleurs, était passionnante.
15:50 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (9)
vendredi, 06 octobre 2006
Rien de nouveau sous le soleil éditorial
Encouragé par quelques uns d’entre vous qui avaient cru y déceler quelque intérêt, voire même un brin de subtilité, je me suis laissé aller, en août dernier, à concevoir un recueil des Apostrophes insolites dont le lien figure dans la colonne de gauche. J’ai un peu remanié les textes, cherché un ordre cohérent, ajouté un bref avant-propos les situant humblement dans une lignée déjà existante. Bref, j’ai conçu un livre à partir de textes épars.
M’appuyant toujours sur le bon accueil que vous avez bien voulu leur faire, j’ai donc proposé ces lettres imaginaires à L’Archipel. Début août, durant ma semaine d’astreinte à Paris, je contacte Jean-Daniel Belfond (en vacances, me répond illico sa délicieuse secrétaire qui m’aime bien et que j’aime bien.) Le 16, jour de son retour, il me répond par courrier électronique de m’adresser ailleurs, soit « à un éditeur plus littéraire que nous » (sic) et, dans la foulée, me propose – comme il le fait chaque fois qu’il me refuse quelque chose, c’est-à-dire tout le temps – un autre sujet qui n’est certes pas mon propos actuellement. Quelques jours après, de retour dans le Lot, j’écris, toujours par messagerie, au Bois d’Orion et au Dilettante. Je propose le même recueil. Par retour d’internet, le Dilettante, par la « voix » de Françoise Lorel, me dit qu’il est difficile de juger sur mes quelques lignes de présentation et demande le manuscrit que j’expédie immédiatement du bureau de poste de Salviac – j’avais prévu d’emporter un exemplaire avec moi. Christian Le Mellec, patron du Bois d’Orion, par messagerie encore, me répond une semaine plus tard que cela ne l’intéresse pas et qu’il ne désire pas recevoir le texte. Pour ne perdre point de temps, de retour à Paris, j’écris à Cheyne, début septembre, et expose le projet. Cheyne ne répond même pas, ce qui vaut refus de seulement prendre connaissance du texte. On note au passage que les petits éditeurs, soi-disant différents, se comportent encore plus mal que les grands, et ne craignent pas d’en rajouter dans la grossièreté. Hier soir, je trouve la réponse, évidemment négative, du Dilettante. Un imprimé de refus classique, agrémenté cependant de quelques mots manuscrits de Françoise Lorel, que je reproduis ici en conservant fidèlement l’orthographe et la ponctuation de cette éditrice : « Votre écriture est tout à fait honnête, le style fluide, ces petits textes sont agréables à lire mais ils leur manquent un caractère particulier un peu de singularité. Peut-être est-ce trop sage pour nous ? » Retour à la case départ. Si vous avez aimé ces Apostrophes, vous ne les lirez pas en volume.
La terre, cependant, continuera à tourner, naturellement.
10:20 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (15)
jeudi, 28 septembre 2006
De l’indexation quand elle est exotique
J’ai publié onze livres (douze, bientôt) ; neuf d’entre eux sont parfaitement disponibles : il y a un épuisé et un autre, disparu dans le naufrage de l’éditeur. On n’en trouve aucun en vente, même pas les deux derniers, parus en 2005 et consacrés à des artistes qui ont eux-mêmes un public, ce qui pourrait très éventuellement justifier la présence de ces ouvrages dans les fonds thématiques des librairies. Enfin, on trouve mes modestes travaux en Amérique, en Angleterre, au Centre culturel français de Pékin, dans des bibliothèques universitaires réparties dans le monde entier, bref, cela me console ou plutôt me fait rire : mes éditeurs sont des casseroles qui ne savent placer leurs parutions qu’auprès des institutions. C’est plus facile, plus immédiatement rentable.
L’indexation est une chose curieuse. Elle est très souvent erronée et, depuis l’apparition du courtage de livres sur internet, on s’aperçoit que toutes les chaînes de vente puisent aux mêmes sources. Les erreurs sont donc répétées à l’envi et personne ne s’avise, par exemple, qu’un titre comme Avec le livre, propos de réflexion, ne signifie rien. Il fallait lire, évidemment : Avec le livre, propos et réflexions. De même, Spectacle hôtel n’a pas grand sens, le titre exact est Spectacle total. Enfin, Léo Ferré, la mémoire du temps est presqu’en permanence substitué à Léo Ferré, la mémoire et le temps. Cet essai se voit d’ailleurs, la plupart du temps, affubler de deux cent trente-sept pages dans les notices des vendeurs comme dans celles des bibliothèques, quand il en propose deux cent trente-huit. Cela n’a pas grande importance, certes, mais pourquoi ?
Il arrive que les éditeurs eux-mêmes se fourvoient dans leur propre indexation, ce qui n’est pas ordinaire. L’Harmattan, qui a publié On n’emporte pas les arbres, le fait figurer, dans son propre catalogue, sous la rubrique « Littérature, romans, nouvelles Océan Pacifique », on se demande vraiment pourquoi.
Ce même recueil, On n’emporte pas les arbres, doit à son titre de figurer sur un site qui recense les ouvrages consacrés à la nature. C’est de l’interprétation au premier degré ou je ne m’y connais guère.
Dans la notice consacrée à Écrivains contemporains, toujours par son propre éditeur l’Harmattan, on peut lire : « Ce qui domine, dans ces monographies, c’est toujours le sentiment de l’affection », quand j’avais écrit, et le texte de quatrième de couverture le dit bien : « Ce qui domine, dans ces monographies, c’est toujours le sentiment, l’affection. »
Le douzième livre à paraître groupe deux pièces de théâtre portant le nom de leur personnage principal (Racine, qui me téléphone de temps en temps, me l’a vivement conseillé), Manon et Guillemine. En principe, je ne devrais pas avoir de surprise. Encore que… Peut-être lirai-je, dans les recensements divers, Canon et Cuisine ? Cela permettra au volume d’être indexé en « Militaria » et en « Ouvrages pratiques », pourquoi pas ? À moins que Guillemine ne devienne Guilledou, ce qui expédiera l’ouvrage en « Curiosa », qui sait ?
16:05 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (8)
lundi, 18 septembre 2006
Vingt-cinq ans de prix unique
La loi sur le prix unique du livre, dite « loi Lang », a vingt-cinq ans. Le point est fait dans un article du Monde par Alain Beuve-Méry, qui écrit toujours d’une façon aussi confuse. Il faudra s’y faire puisqu’il est le « Monsieur Édition et Librairie » du journal.
14:20 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 18 avril 2006
Quel métier !
L’ami Feuilly me signale, sur le site Fabula, une recension, faite par Thomas Mercier, du livre dirigé par Bertrand Legendre et Christian Robin, Figures de l'éditeur, représentations, savoirs, compétences, territoires, paru en 2005 chez Nouveau Monde Éditions.
Je relève dans ce compte rendu que, pour les étudiants en formation, ceux qui apprennent le métier, l’éditeur « n’est ni incarné par une figure héroïque ni appréhendé comme un marchand ou un artisan. Il est davantage fantasmé comme une constituante du milieu artistique. Les jeunes interviewés n’envisagent que l’éditorial, le graphisme et le service de presse, ils oublient systématiquement la partie fabrication et la partie diffusion. Aucun d’entre eux ne perçoit l’éditeur comme un chef de projet qui formalise une idée de collection, alors que c’est bien souvent ce qu’il est. »
C’est a priori l’aspect le plus intéressant de l’ouvrage, si j’en juge, à tout le moins, par ce simple article. Car ce rêve éditorial, s’il est a priori sympathique, uniquement tourné vers la partie artistique de la fonction (encore que le service de presse n’en relève pas exactement), ne correspond à aucune réalité. Pis, la notion de contenu est ici totalement absente. Cela promet de beaux tristes jours pour le livre de demain.
14:40 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (6)
vendredi, 31 mars 2006
De l’auto-édition
Pierre Bosc m’a envoyé, il y a quelques jours, les deux derniers livres, parus coup sur coup, de Jean-Paul Pelras, son ami. Pelras est un agriculteur qui, par suite de difficultés, a abandonné son métier en 2001 et s’est reconverti dans l’écriture. Il avait publié son premier livre en 1991, il en est à son treizième, un roman que je n’ai pas encore lu, paru aux éditions du Rocher, Le Vieux garçon. Dans l’intervalle, il a fait paraître quatre ouvrages au Trabucaire et donné à lire tous les autres en auto-édition. C’est le cas de l’avant-dernier dont j’ai entamé la lecture, un livre d’entretiens qu’il a intitulé Jean Carrière avait encore deux mots à vous dire. Ce volume a paru aux Presses littéraires.
Ce qui me donne l’occasion d’évoquer ici l’auto-édition qui, faut-il le rappeler, n’est pas le compte d’auteur. Dans le cadre de l’auto-édition, l’auteur s’adresse à un imprimeur, de préférence spécialisé, acquitte intégralement les frais d’impression et de fabrication, reçoit l’intégralité du tirage et entrepose les volumes dans sa cuisine en se demandant ce qu’il va bien pouvoir en faire maintenant. La différence avec le compte d’auteur est qu’il n’engraisse pas un requin escroc qui ne prendra aucun risque, touchera la plus grosse part de très maigres ventes et proposera ensuite à l’auteur-pigeon de racheter les invendus qu’il avait déjà financés au départ. Passons.
L’auto-édition, donc, permet de faire paraître ce que l’on veut, sans rien demander à personne et en tirant la langue aux comités de lecture qui, je le rappelle, sont une chimère. Ensuite, pour ce qui est de la diffusion, de la distribution, bref, de la vente, l’auteur se débrouille. Au moins encaissera-t-il l’intégralité des sommes perçues si, d’aventure, il arrive à vendre quelques volumes. Aujourd’hui, de très nombreux sites, sur la Toile, permettent de pratiquer l’auto-édition, si l’on a les moyens de le faire.
Ce n’est pas pour Pelras que je dis cela, moins encore contre lui, qui a décidé de verser à Amnesty International ce que lui rapportera son Jean Carrière (était-il cependant nécessaire de le préciser par deux fois dans le volume ?). C’est pour citer un cas concret d’auto-édition.
 Voici donc ce livre. D’emblée, je précise que Les Presses littéraires, ça n’existe pas. C’est un label, uniquement un label. Il s’agit de l’imprimeur Fricker, installé à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), spécialisé dans l’impression de revues littéraires et dans l’auto-édition, qui fabrique des livres sans mention d’éditeur (et pour cause) ou bien propose, à la place, un label qui a un peu d’allure, moyennant – je suppose – un supplément de prix.
Voici donc ce livre. D’emblée, je précise que Les Presses littéraires, ça n’existe pas. C’est un label, uniquement un label. Il s’agit de l’imprimeur Fricker, installé à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), spécialisé dans l’impression de revues littéraires et dans l’auto-édition, qui fabrique des livres sans mention d’éditeur (et pour cause) ou bien propose, à la place, un label qui a un peu d’allure, moyennant – je suppose – un supplément de prix.
Le résultat est estimable visuellement. Le savoir-faire de Fricker est incontestable. Mais c’est là qu’il faut ajouter une chose : l’imprimeur fait son métier, il imprime… ce qui lui est donné. Et cette fois, rien ne va plus. Car l’édition traditionnelle, dont on sait suffisamment que je n’en pense pratiquement que du mal, offre au moins, lorsque, par la conjonction de cent millions de hasards et surtout d’intérêts, elle a retenu un manuscrit, des services professionnels : le manuscrit est « peigné », les épreuves sont revues (enfin, c’était le cas avant que les crapuleux gougnaffiers de l’édition ne sucrent le poste de correcteur qui leur coûtait trop cher), la maquette est étudiée, parfois refaite…
En auto-édition, rien de tout cela. Juste la bonne volonté de l’auteur et son regard, qui n’est pas nécessairement exercé à la correction, qui n’a pas obligatoirement la mesure immédiate d’une charte graphique, qui ignore peut-être la cohérence de la marche – en résumé, qui n’est peut-être pas un dingue dans mon genre, malade mental de la correction typographique (qui, malgré tout, n’est jamais parvenu à produire un livre sans coquille aucune).
Le volume dont il est question ici tombe dans tous ces pièges. Je ne veux pas, on l’imagine bien, j’espère, faire la fine bouche et dénigrer ce qu’on m’a offert. Ce n’est pas mon sujet. Nous parlons bien d’auto-édition. Ces entretiens avec Carrière souffrent de coquilles innombrables ; d’une tendance au charabia de la part de Pelras (j’insiste : il n’y a là, en dépit des apparences, rien de méchant) ; d’une absence de cohérence graphique (différences dans l’enrichissement, d’une page à l’autre) ; d’erreurs de conception (entre le « Du même auteur » des deux hommes, l’épigraphe, la dédicace, la préface de Bernard Blangenois, l’avertissement de Pelras, le récit de sa rencontre avec Carrière puis des circonstances ayant abouti à ces conversations, les entretiens proprement dits ne commencent qu’en page 26, ce qui est une aberration quand on considère que l’ouvrage n’en compte que cent-douze, le texte proprement dit s’arrêtant en page 108) ; de maladresses de maquette (la photographie de la quatrième de couverture aurait dû, à tout le moins, être recadrée, et le texte de cette même quatrième est bancal.)
Tout cela, c’est un travail éditorial. Cela fait partie des multiples étapes qui font passer du manuscrit au livre. Hubert Nyssen, snob prétentieux, coureur sur le retour, écrivain sans intérêt majeur, homme que je n’aime guère et dont je n’apprécie que peu les choix éditoriaux, a publié sur la question un intéressant Du texte au livre, les avatars du sens. Ce n’est pas un secret des dieux, c’est un métier qui s’apprend. L’auto-édition ne peut pas répondre à ces questions ; en cela, elle n’est pas une solution satisfaisante aux problèmes des auteurs. Je ne parle même pas du coût… J’ignore comment fait Pelras pour faire paraître autant de livres de cette façon.
Je n’ai pas évoqué, je le sais bien, le contenu proprement dit de ces discussions entre Pelras et son maître à penser. Ce n’était pas mon propos aujourd’hui.
12:36 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (14)
vendredi, 24 mars 2006
À plus d'un titre
Les éditeurs, comme vous le savez, procèdent parfois à des retenues de titres. Ils font paraître dans les publications professionnelles comme Livres-Hebdo (ex-La Bibliographie de la France) des encadrés qui prennent date, afin d’éviter que des confrères, en toute bonne foi ou en toute mauvaise foi, n’éditent des ouvrages de même dénomination, ce qui pourrait prêter, évidemment, à confusion.
Ce n’est pas si simple, toutefois. Il faut que le titre prévu possède un caractère d’originalité suffisant. Si l’éditeur désire publier le roman La Chaise, ou bien La Table, ou encore Le Retour, il n’est pas certain qu’il puisse retenir ce qu’on a coutume de nommer un « mot-titre ». En revanche, il pourra retenir, et cela se comprend, L’Idéal et le spectre.
Et puis, parfois, les annonces sont à se tordre, lorsqu’il s’agit de titres d’une effrayante platitude. Je lis dans la livraison du 24 février dernier : Actes Sud retient L’Imprévisible, Hatier retient Terres littéraires, John Bindefeld (?) retient Mémoires insolites. Ahurissant : les éditions du Moniteur retiennent Précis du droit des marchés publics.
Peut-être, en y réfléchissant, est-il encore plus nécessaire de garantir l’utilisation d’un titre lorsqu’il est effroyablement banal ? Alors, de l’édition française, ce serait une raison supplémentaire de désespérer – « et mon Dieu, ça ne manque pas. »
07:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (14)
mardi, 21 février 2006
« L’édition menacée »
Je viens d’acheter L’Édition menacée, livre blanc sur l’édition indépendante. C’est une brochure parue en décembre 2005, très mal réalisée techniquement, mais ce n’est pas le problème. Elle fait le point, aux éditions Duboiris, pour huit euros. Les auteurs : Roger Bordier, André Schiffrin, Janine Brémond, Bernard de Fréminville, Raphaël Pirouteau et Gilbert Trompas, sous la direction de Charles Onana. Le tout sous l’égide de l’association L’Autre livre, qui tient salon à Paris en décembre. Préface de Gilles Perrault. L’intégralité des recettes sera versée à l’association. Voici le texte qui figure en quatrième de couverture :
L’entrée brutale des multinationales dans l’édition pose depuis quelque temps des problèmes graves dans la production du livre. Ces multinationales contrôlent désormais près de 70 % de l’édition française. En novembre 2003, le commissaire à la concurrence de l’Union européenne, Mario Monti, recensait douze marchés de l’espace européen où le groupe Lagardère-Éditis était en position dominante. Une telle position ne permet pas un accès libre et équitable au livre pas plus qu’elle ne garantit le pluralisme et l’indépendance dans la création et la production des œuvres culturelles. Comment donc continuer à éditer des livres d’auteurs, audacieux, inspirés, talentueux, ingénieux ou inconnus dans un environnement international où la concurrence est brimée et le marché sous contrôle ? Quels sont le poids et l’apport des « petits éditeurs » ou des « éditeurs indépendants » dans ce nouveau contexte ? Comment les pouvoirs publics européens peuvent-ils agir pour arbitrer voire arrêter ces dérives nuisibles à la liberté d’expression, de création et de diffusion ? Voilà les questions auxquelles tente de répondre le « livre blanc sur l’édition indépendante ». Auteurs, éditeurs, diffuseurs et libraires ont mis ensemble leur expérience personnelle ou leurs enquêtes de terrain pour enrichir ce débat devenu indispensable pour les professionnels du livre et pour les lecteurs.
Ne rêvons pas. Une plaquette de 80 pages n’impressionnera pas Lagardère. Je vous en reparlerai.
14:05 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 17 février 2006
Luc Ferry revient
Juste pour mourir de rire, cet extrait du Monde du 16 février. Habituellement, les éditeurs se montrent plus méfiants lorsqu’ils choisissent des collaborateurs.
Depuis le 1er janvier, Plon a recruté Luc Ferry, ancien ministre de l’Éducation nationale et surtout ancien président du Conseil national des programmes. Pour le PDG de Plon, il s’agit de développer un département jeunesse, à l’instar de Gallimard, mais aussi de s’investir dans le parascolaire, en concevant une collection « pour aider les parents à aider leurs enfants ». Tel est le nom retenu. Auteur de Apprendre à vivre, sous-titré Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations, paru chez Plon en février, l’ancien ministre a accepté de prendre en charge ce secteur. Les premiers livres ne seront publiés qu’en janvier 2007. Cela fait longtemps que Luc Ferry souhaite « abolir les champs disciplinaires entre l’école primaire et le collège ». Les livres dont il réalisera les canevas seront conçus comme « des encyclopédies à destination des familles ». « Les sujets seront très variés : de la naissance des étoiles à la sexualité, de l’Union européenne à la question de l’esclavage », explique-t-il.
15:59 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (5)
Le temps des droits d’auteur
Incroyablement, j’ai reçu hier, au titre de 2005, quelques droits pour un livre paru au printemps dernier. L’éditeur avait jusqu’au 31 mars pour me les adresser, il l’a fait mi-février. Sans que je réclame rien, sans que je lui rappelle ses obligations contractuelles, sans rien. Du jamais vu en ce qui me concerne (non, j’exagère, Seghers faisait ça aussi). Je tape suffisamment, en ce lieu, sur les mœurs éditoriales pour saluer, cette fois, un tel comportement. Comportement qui me change beaucoup, vraiment.
Dans la foulée, j’ai écrit à un autre éditeur pour lui rappeler qu’il ne m’avait plus rien adressé depuis le quatrième semestre 2004, alors que le contrat prévoit des comptes trimestriels…
Et je vois déjà venir le mois d’avril où, tous délais dépassés, Martine devra aller chez un autre éditeur pour réclamer les comptes, systématiquement non rendus depuis 2001 tant qu’elle ne se manifeste pas. Je précise que les comptes en question consistent en un relevé pur et simple, puisqu’il n’y a jamais de droits avec…
Je passe sur tel éditeur qui ne m’a jamais rendu aucun compte depuis 1994…
Je passe – que faire ? – sur tel autre, disparu avec mes droits jamais versés depuis 2001, les exemplaires restants (la moitié du tirage) et toute la propriété d’une pièce de théâtre que je ne puis par conséquent faire rééditer ailleurs – et qui n’est plus jouée puisqu’on n’en trouve plus le texte, si bien que je ne reçois plus rien non plus pour ce qui est de la scène, par l’intermédiaire de la SACD.
Et je ne vais certainement pas vous ennuyer avec cet éditeur qui ne me verse rien pour les trois livres qu’il a à son catalogue, ni avec cet autre qui ne me verse rien non plus pour un autre ouvrage…
Quant à cet éditeur qui a prévu par contrat six mois pour rendre les comptes, cette période étant suivie des mois d’été, si bien qu’il y a toutes les chances pour qu’on se retrouve en septembre avant qu’il se soit passé quoi que ce soit, que fera-t-il ? Je vous en parlerai quand je le saurai moi-même.
11:24 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
jeudi, 09 février 2006
Hachette Livre, éditeur américain
Dans Le Monde du 8 février 2006, on peut lire cet article d’Alain Beuve-Méry que me signale l’ami Feuilly. Je passe sur la médiocrité absolue du style de l’auteur. Si, après lecture, vous pensez encore pouvoir faire quelque chose dans le monde du livre, j’admire l’intensité de vos illusions.
Hachette Livre devient le troisième éditeur mondial
Pour le groupe Lagardère, 2005 avait été une année d’attente, sans acquisition majeure. Lundi 6 février, c’est dans le secteur de l’édition et aux États-Unis que le groupe de médias et de produits culturels a décidé de frapper un grand coup. Pour 537, 5 millions de dollars (449 millions d’euros), Arnaud Lagardère (resté à Paris) et Arnaud Nourry, PDG de Hachette Livre (présent à New York) ont conclu un accord avec Dick Parsons, président de Time Warner, en vue de racheter Time Warner Book, le cinquième éditeur de livres américain. Cette acquisition fait passer Hachette Livre du cinquième au troisième rang des éditeurs mondiaux, derrière Pearson et Bertelsmann.
Pour Arnaud Lagardère, il s’agit d’« une acquisition faite par optimisme et pour se faire plaisir ». « L’industrie du livre, on y croit beaucoup, parce qu’on commence à avoir la taille critique », précise-t-il. Pour le PDG du groupe, « contrairement à d’autres secteurs, le livre devrait rebondir grâce au numérique ». Hachette Livre, qui est « présent dans les manuels scolaires, la fiction et le secteur de la jeunesse », « connaît un modèle vertueux ». « Il n’y a qu’en France que l’on ne peut plus grossir, en raison de la législation européenne », précise-t-il.
Déjà premier éditeur en France et en Nouvelle-Zélande, deuxième en Espagne (avec Anaya), Hachette Livre passe de la deuxième à la première place en Grande-Bretagne et en Australie et s’implante de manière significative aux États-Unis.
Time Warner Book est un éditeur de littérature grand public aux États-Unis, un peu comme Hodder Headline, au Royaume-Uni, dont Hachette Livre avait fait l’acquisition à l’été 2004. C’est désormais autour de soixante pour cent de son chiffre d’affaires que le groupe français va réaliser à l’international, dont environ quarante-huit pour cent dans le monde anglo-saxon. Il est positionné de manière stratégique sur les trois bassins linguistiques anglo-américain, espagnol et français.
Pour Arnaud Lagardère, ce « coup » est une sorte de retour aux sources. Il avait fait ses premières armes aux États-Unis dans le secteur de l’édition, où il avait tenté de rattraper l’opération calamiteuse faite avec le rachat de l’éditeur d’encyclopédies Grolier en 1988 — au moment où ce secteur s’effondrait — revendu tant bien que mal en 2000. Le mauvais souvenir de cette première expérience américaine explique en partie pourquoi, lors du rachat de Vivendi Universal Publishing (VUP) en 2002, le groupe Lagardère n’a pas retenu Houghton Mifflin parmi les actifs stratégiques qu’il entendait conserver.
Finalement, dix ans après Bertelsmann, propriétaire de Random House, première maison d’édition américaine, Hachette Livre devient un éditeur américain à part entière. Arnaud Lagardère réussit là où Jean-Marie Messier, à la tête de Vivendi, avait échoué.
Au finish, c’est avec le groupe de Rupert Murdoch (propriétaire de Harper Collins aux États-Unis) que les Français étaient en lice dans la dernière ligne droite. La qualité des contacts noués entre Arnaud Lagardère et Dick Parsons, tout comme le fait que le management de Time Warner Book était favorable à l’offre française ont, semble-t-il, joué. Le prix payé par Lagardère est légèrement inférieur au chiffre d’affaires 2005, qui n’a pas été communiqué par la firme américaine. En revanche, il n’est pas certain qu’il conserve la marque.
Hachette Livre complète son dispositif international, ce qui constitue un véritable atout au moment où les négociations pour la vente et l’acquisition des droits des auteurs de best-sellers se font à cette échelle. De fait, c’est Lattès, maison d’édition logée au sein du giron d’Hachette, qui a fait l’acquisition des droits des quatre premiers livres de Dan Brown, auteur du Da Vinci Code. De plus, Arnaud Lagardère n’entend visiblement pas borner ses ambitions à ce niveau-là. Lors des voeux adressés aux « barons » de son groupe, début janvier, il avait annoncé « deux années de profondes mutations » avec une priorité donnée au secteur des médias et de l’édition. Après le continent américain, c’est vers les marchés indien et chinois de l’édition que se porte désormais son attention.
Cet achat aux États-Unis n’est pas exclusif de nouvelles acquisitions notamment dans le secteur des médias, précise-t-on chez Lagardère. Après une prise de participation significative, en 2005, dans Le Monde SA, les discussions avec Vivendi pour une entrée en force dans le capital de Canal + se sont récemment accélérées.
La bonne santé du groupe Lagardère et d’Hachette Livre, tout comme celle d’Éditis, numéro deux de l’édition française (et propriété à cent pour cent de Wendel Investissement), tranche avec la morosité actuelle du secteur dans l’hexagone. Les deux groupes devraient annoncer prochainement une progression de leur chiffre d’affaires de plus de dix pour cent chacun, alors que pour la première fois depuis 1997, le marché de l’édition a enregistré une baisse globale d'un demi pour cent de son chiffre d’affaires en 2005.
07:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (5)
jeudi, 02 février 2006
Classement
Si j’en crois l’ami Pierre Bosc, et pourquoi ne le croirais-je pas, je vous le demande, puisqu’il cite lui-même le classement établi par Livres Hebdo, Astérix, Harry Potter et Dan Brown sont en tête des meilleures ventes de livres, en 2005, en France.
Premier avec 1. 305. 300 exemplaires vendus, Uderzo. Marc Lévy occupe les sixième, septième et huitième places avec La prochaine fois (490. 000 exemplaires), Vous revoir et Et si c'était vrai.
Michel Onfray (153. 000 exemplaires) domine les ventes des essais, catégorie qui est en chute libre, dit la revue professionnelle.
Quand on parle de vente de livres, avouant tout en le niant que l’édition se porte bien, n’oubliez jamais que c’est toutes catégories confondues et que des inexistants comme Lévy entrent en ligne de compte. N’oubliez pas non plus que les différents tomes d’Harry Potter sont comptabilisés au même titre que Stendhal et que Dan Brown est l’égal de Flaubert ou d’Hemingway en matière de chiffres d’affaires.
Évidemment, on vous affirmera que le succès de Potter permet d’éditer des livres difficiles, de vente réduite voire inexistante. C’est au nom de ce principe, le dirai-je jamais assez, qu’on publie huit cents tomes de Potter et une plaquette de poèmes. N’écoutez pas les sirènes amères de l’édition. Ce blog n’aura de cesse de les faire s’enrouer. Ne croyez pas ce qu’on vous raconte – et ne croyez surtout jamais ceux qui ont quelque chose à vous vendre ou à vous fourguer.
14:10 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (24)
lundi, 30 janvier 2006
Un contrat célèbre
Entre MM. Poulet-Malassis et Eugène de Broize, imprimeurs-libraires à Alençon, d’une part ;
et
M. Charles Baudelaire, littérateur, d’autre part ;
a été convenu ce qui suit :
M. Charles Baudelaire vend à MM. Poulet-Malassis et Eugène de Broize deux ouvrages, l’un : Les Fleurs du Mal, l’autre Bric-à-brac esthétique.
M. Charles Baudelaire livrera Les Fleurs du Mal le vingt janvier prochain et le Bric-à-brac esthétique à la fin de février.
Chaque tirage sera de mille exemplaires.
Pour prix de cette vente, M. Charles Baudelaire touchera, pour chaque volume tiré, vendu ou non vendu, vingt-cinq centimes, soit un huitième du prix marqué sur le catalogue de MM. Poulet-Malassis et Eugène de Broize.
M. Charles Baudelaire s’interdit la reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de la matière contenue dans les deux volumes.
M. Charles Baudelaire ne pourra offrir ces ouvrages ou l’un de ces ouvrages à un autre libraire qu’au cas où MM. Poulet-Malassis et Eugène de Broize n’ayant plus en magasin qu’un très petit nombre d’exemplaires, [négligeraient de] se refuseraient à les réimprimer.
Fait double, à Paris, ce trente [janvier] décembre mille huit-cent cinquante-six.
Aug. Poulet-Malassis Ch. Baudelaire
17:10 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 13 janvier 2006
L’édition selon Sabine Wespieser
L’ami Feuilly me signale un entretien avec l’éditrice Sabine Wespieser, transfuge de la firme Actes Sud, qui a créé il y quelques années une petite maison.
Il faut lire, vraiment, cette conversation convenue et factice.
« Quand je reçois des textes particulièrement bien écrits mais « creux » à mon sens, il m’arrive souvent de répondre que je ne publie pas ce genre de choses mais d’aller voir ailleurs parce que je les aime bien ». Voilà un exemple remarquable de l’hypocrisie éditoriale : c’est creux, allez chez le voisin, c’est lui qui prendra les risques. L’auteur naïf va chez le voisin et lui explique que Sabine Wespieser lui a conseillé de s’adresser à lui. L’éditeur se dit immédiatement, et c’est logique : « Si cela avait la moindre valeur, Sabine Wespieser l’aurait gardé pour elle ». Il refuse donc et, quand il n’est pas courageux, il oriente l’auteur décidément un peu idiot vers une troisième maison. Au troisième refus, l’auteur aura-t-il compris ?
« Si l’on dit qu’un livre coûte 100 francs. 20% vont à la fabrication, 10 à 15% à l’auteur, entre 55 et 65% vont à l’étape suivante qui est la commercialisation. Ce qui veut dire que sur le prix public de vente, l’éditeur récupère au mieux 44% avec lesquels il paye son imprimeur, son auteur. Il lui reste environ 14% pour se payer, payer ses salariés, les frais de fonctionnement et pour éventuellement rentrer suffisamment d’argent pour se permettre de publier d’autres livres ». Il est scandaleux de dire que l’auteur reçoit dix à quinze pour cent. Huit pour cent est le plus courant et cela peut descendre à six, voire à quatre. Je tiens mes contrats à disposition de qui voudrait vérifier la chose. Bien sûr, cela n’est pas vrai pour ceux qui ont un brin de notoriété… Ceux-là, cependant, ne sont pas chez Sabine Wespieser.
« Tout ceci explique que le livre est cher bien que ça me fasse doucement rigoler quand je vois comment les restaurants sont remplis, les marchands de DVD aussi ». Si jamais vous aviez un jour pensé que les éditeurs savaient s’exprimer, qu’ils possédaient la maîtrise de la langue, voilà qui vous rassurera.
« J’assume tout à fait d’être autocrate parce que je crois que je le suis ». S’il vous fallait un autre exemple…
« Hors pour faire un bon livre, il n’y a pas de recettes ». Si vous pensiez que des propos d’éditeur étaient toujours soigneusement relus avant publication, vous serez fixés.
Assez de ces manières, de ce baratin érigé en système et de ces éditeurs prétentieux. Assez.
15:55 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
De Victor Hugo à Christian Jacq
L’ami Feuilly me signale un article du Monde du 13 janvier. On y apprend que le groupe éditorial de Bernard Fixot, XO, créé en 1999, se fond à présent dans Éditis. Fixot avait été éditeur, avant 1999, sous son propre nom. Le changement d’appellation n’a pas modifié les choix de la maison : la nullité commerciale la plus décourageante. Le groupe possède aussi ce que Le Monde appelle pudiquement une « filiale, Oh ! Éditions, spécialisée dans les documents d’actualité », c’est-à-dire dans la boue.
L’éditeur le plus honteux de France remet donc ainsi entre les mains d’Éditis des fonds aussi intéressants que ceux de Laffont et de Julliard, aussi prestigieux que celui de Seghers. On peut se demander, d’ailleurs, pourquoi Laffont a vendu sa maison à Fixot, lorsqu’il a décidé de passer la main. Dans ses souvenirs dont il a déjà été question ici, Laffont laisse entendre que cela ne lui a pas fait plaisir et conclut qu’il ne souhaite pas s’étendre sur cette question.
L’article précise encore – et sans rire – que Fixot, qui « s’était assigné comme objectif de "remettre des auteurs français dans la liste des best-sellers mondiaux, comme au XIXe siècle", peut être satisfait de son bilan. Sur cinquante-sept titres publiés, cinquante et un ont figuré sur la liste des meilleures ventes et quarante-trois ont été vendus à l’étranger – ce qui représente plus du tiers du résultat de l’entreprise ». On est bien content, en effet. Le résultat de cette volonté éditoriale farouche fut : « Un nouveau roman historique en quatre tomes consacré à l’Égypte ancienne de Christian Jacq, Les Mystères d’Osiris, et surtout les Mémoires de Farah Pahlavi, l’épouse de l’ex Chah d’Iran ». Voilà ce qu’on inscrit sur la liste des best-sellers mondiaux, laquelle comprend déjà Les Misérables (par exemple).
Vive l’édition française.
12:35 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 10 janvier 2006
Antoine Gallimard parle
Dans Libération du 5 janvier dernier, cet entretien avec Antoine Gallimard (petit-fils de Gaston et fils de Claude). Bien sûr, je ne suis pas responsable de la médiocrité du chapeau ni de l’expression, piteuse, du responsable de la plus prestigieuse maison d’édition française. Je me suis contenté de rectifier quelques horreurs typographiques contenues dans la mise en page initiale.
Je ne pense pas médire en relevant que le terme « littérature » est présent une seule fois dans tout le texte (associé au qualificatif « populaire ») ; en observant que « talent » n'est employé qu'une fois, au pluriel, associé à « nouveaux » ; en remarquant que les mots « écriture », « œuvre » et « style » ne sont jamais prononcés.
À la mi-décembre, Antoine Gallimard, qui préside aux destinées de la maison de la rue Sébastien-Bottin depuis 1988, a reçu, à Barcelone, le prix Atlantide, décerné par le Cercle des éditeurs catalans : un hommage à sa « trajectoire éditoriale » et à la façon dont il a su préserver et concilier le « caractère familial et le rayonnement d’une maison d’édition emblématique ». À cette consécration hors frontière, nous racontait-il quelque temps plus tard avec le sourire, n’a pas manqué le rappel « qu’il faut toujours revendiquer le droit à l’erreur ». Même à cette occasion, on a renvoyé ce Gallimard de la troisième génération au souvenir du refus opposé à Proust (« Toute ma vie, on va me le ressortir ! »). Choix des livres, stratégie d’entreprise sur un marché français où la concurrence se raidit depuis la fusion avortée d’Hachette-Éditis, la marge de manœuvre reste délicate pour Gallimard. Le PDG aime à rappeler la constante dualité de son rôle : être à la fois « aux fourneaux et dans la salle de restaurant », et puis, pour user d’une autre métaphore, pratiquer « le pas du patineur », travailler sur la durée, par exemple avec la Pléiade (le contrat pour le volume Poésie a été signé avec Aragon en 1980, et ne sort que cette année), repérer les nouveaux talents, signer des coups avec droits dérivés à la clé. Tout en veillant avec la prudence traditionnelle de la maison à l’élargissement de sa diffusion et de sa distribution. Retour, avec l’intéressé, sur une année 2005 marquée par le départ de Teresa Cremisi (bras droit passé chez Flammarion), et analyse des enjeux actuels de l’indépendance éditoriale.
Quel bilan tirez-vous de l’année 2005 ?
Globalement, il semble que le marché aura un peu progressé, peut être de 1,5 %, mais cela reste incertain. Tout le monde se plaint. Dans ce contexte, où les préoccupations se polarisent sur les questions financières, la maison Gallimard reste un peu atypique. Elle a la chance d’être un bateau bien quillé : la part du fond représente beaucoup de livres. Et si, cette année, nous avons peut être eu un peu moins de best-sellers que les années précédentes, nous avons eu quelques bonnes surprises. Prenez Waltenberg, d’Hédi Kaddour, premier roman d’un poète, un livre relativement difficile, épais, complexe, avec des galeries souterraines, des chausse-trappes... Nous étions très enthousiastes ici, mais je pensais que cela tournerait autour de dix mille exemplaires. On en est à trente mille. Nous avons eu le Médicis étranger d’Orhan Pamuk pour Neige, qui en est à quelque trente-cinq mille exemplaires. Ont marché le Lutétia de Pierre Assouline, la Malédiction d’Edgar de Marc Dugain. La Théorie des nuages de Stéphane Audeguy, autre premier roman, qui en est à dix-huit mille exemplaires, a rencontré un public, ça continue, c’est tout ce qu’on aime dans ce métier.
Vous avez aussi Harry Potter et Narnia...
Avoir un Harry Potter aide beaucoup les livres de comptes. Narnia, qui était précédemment publié par Flammarion, nous en avons acheté les droits il y a trois ans, sans savoir qu’un film allait en être tiré. Nous avons également pu acquérir, en même temps, les droits dérivés-papier : nous en sommes à quatre-cent mille exemplaires en titres dérivés... Le bilan est donc plutôt bon.
Composez-vous de la même manière les programmes de septembre et de janvier ?
Personnellement, je préfère janvier, on a le sentiment que la respiration littéraire est lente, plus facile. J’ai tendance à vouloir y mettre mes locomotives. Tahar Ben Jelloun, qui vient du Seuil, c’est pour janvier. Sollers, c’est mieux pour janvier aussi. Pascal Quignard, au mois de mars. La saison de septembre ne peut pas oublier les prix littéraires. Elle cristallise les difficultés et l’ingratitude de ce métier, dans une atmosphère très concurrentielle, marquée par le besoin de reconnaissance, d’argent, etc. Les auteurs sont de plus en plus demandeurs de succès, il faut à la fois établir des scores et s’inscrire dans la durée. La presse, elle-même, ne peut pas lire tous les livres. Il y a des sacrifiés, de la casse, et c’est l’éditeur qui reçoit les bris de verre au visage. Cela fait toujours des petits dégâts collatéraux. J’ai deux amis écrivains : Pascal Quignard, longtemps j’ai espéré avoir le Goncourt avec lui, finalement il l’a eu chez Grasset ; et François Weyergans, dont j’étais assez proche, pareil.
Comment êtes-vous organisé ?
Des éditeurs comme Christian Bourgois ou POL se saisissent d’un livre en direct, le prennent ou le rejettent. Moi, j’interviens s’il y a un problème particulier. Mon souci est donc plutôt de choisir mes collaborateurs littéraires... C’est un travail d’équipe. Je suis comme un chef de gare, ou comme dans un aéroport : je regarde si les avions ont leur plein de kérosène ; je veille à l’équilibre des programmes. Trop de titres, vous n’allez pas pouvoir les défendre. Je ne veux pas dire qu’il y a trop de livres. Non. Il y a trop de livres qui se ressemblent, ou trop de faux livres.
La façon dont vous gérez les auteurs du passé évolue. Auriez-vous sorti le Ramier d’André Gide il y a quinze ans ?
Non, cela n’aurait pas été compris. Si nous le faisons aujourd’hui, c’est moins le fait de l’évolution de Gallimard que de Catherine Gide, la fille de Gide : avec le temps et l’expérience, elle est devenue plus souple. Une de mes premières activités ici a été de faire les « Cahiers » Céline avec Jean-Pierre Dauphin et Henri Godard. Je vais publier un choix de la correspondance de Céline en Pléiade, on n’aurait pas pu le faire il y a quelques années. Personnellement, je pense qu’on devrait publier les pamphlets. Sa veuve s’y oppose. Un jour peut-être... Je suis l’exécuteur testamentaire de Paul Morand. J’ai publié son Journal inutile, quasiment pas censuré. En revanche, je me pose des questions sur la correspondance, énorme, qu’il a entretenue avec Chardonne. Morand n’en sort pas grandi. Chardonne non plus. En même temps, Morand souhaitait qu’elle soit publiée. Il faut que j’y réfléchisse.
Que représente pour vous une maison comme Verticales (label éditorial racheté au Seuil) ? Est-ce l’équivalent d’une collection ?
J’ai formé un petit ensemble, avec Verticales et Joëlle Losfeld : je les installe rue Saint-André-des-Arts, avec POL, dans les locaux autrefois occupés par Balland ; la Table ronde (rachetée à 97 % en novembre, ndlr) n’est pas très loin. Pour nous, ces satellites ont plutôt la fonction qu’avaient naguère les revues littéraires, qui permettaient de «draguer» les auteurs. Ils ont des petits tentacules, des papilles gustatives différents des nôtres. Après, j’ai ma voiture-balai. Eventuellement, les auteurs peuvent passer dans la collection «blanche», comme Jauffret en complet accord avec Bernard Wallet (le patron de Verticales, ndlr).
La maison Gallimard est un ensemble diversifié et intégré, de l’édition à la librairie...
Il n’y a pas de logique industrielle derrière nos librairies. Depuis la librairie du boulevard Raspail, créée par mon grand-père, elles ont plutôt été acquises sur des coups de coeur : celle de la place Clichy, le Divan, Delamain, et, à Strasbourg, Kléber (que nous allons développer). Mais nos librairies ne jouent quand même pas un rôle stratégique. Ce qui est important, pour notre développement, c’est plutôt le secteur jeunesse et les filiales comme Denoël, ou encore le fait d’avoir notre propre diffusion et notre distribution, avec un centre de traitement des livres qui peut abriter soixante millions de volumes et traiter quatre-vingt dix-mille références...
Qu’est-ce qui vous détermine à intégrer certains labels ou, au contraire, à créer des filiales, comme récemment pour la BD ?
Dans le domaine de la BD, je me suis associé à cinquante-cinquante avec Soleil pour relancer la marque Futuropolis, que j’ai apportée dans l’accord. La filialisation se justifie quand on a besoin d’un partenaire,mais pas autrement. On peut aussi dire qu’il y a des intégrations qui ont un sens, comme le fait de reprendre POL, par exemple, et d’autres pas. Il n’aurait pas été logique que je récupère First. Ni Le Rocher à 100 % : j’aurais pu, mais je n’ai pas voulu, j’ai préféré me limiter à une participation. De cette façon, je m’associe à un partenaire qui peut prendre une place dans la littérature populaire, je sécurise le contrat de diffusion-distribution passé avec lui et... c’est toujours une petite part de marché que la concurrence n’aura pas !
En matière de diffusion-distribution, après Odile Jacob, allez-vous récupérer L’École des loisirs, autre grand diffusé du Seuil ?
L’École des loisirs va nous rejoindre. La seule incertitude porte sur la date du transfert, compte tenu du contentieux qui les oppose au Seuil et pour lequel ils sont en attente d’un jugement sur le fond. Par ailleurs, nous avons confirmé notre contrat de distribution avec Bayard. Cela dit, les problèmes que le Seuil peut rencontrer, je ne m’en réjouis pas. Aujourd’hui, je me sens plutôt seul. Dans la catégorie des maisons familiales d’une certaine taille, restent Albin Michel et moi. Et Albin Michel est dans le sillage d’Hachette, à travers sa distribution et son association au Livre de poche. Aujourd’hui, les bateaux ne régatent plus suivant les mêmes règles, pardon pour l’image nautique. Depuis que Charles-Henri Flammarion a vendu, qu’il y a eu l’affaire Hachette-Éditis, que les familles Bardet-Flamand ont vendu le Seuil, tout est agité. Et ce n’est pas fini. On est dans la tempête.
Il faut grandir ?
Il y a un vrai problème de concentration. Le point numéro un, c’est la liberté d’accès au marché. Les équilibres éditoriaux essentiels à Gallimard dépendent de la survie d’une librairie de qualité. Elle est là, elle joue son rôle. Mais sa situation est préoccupante. Et on s’aperçoit que, si le marché se développe, c’est essentiellement sur les hypers et les grandes surfaces. Une maison de taille moyenne, comme la nôtre, a aussi besoin d’accéder à ces autres niveaux. Or, les groupes qui contrôlent toute la chaîne de commercialisation risquent de fermer ces débouchés aux autres éditeurs. J’ai, par exemple, du mal à vendre mes guides de voyage, qui sont en concurrence avec le Guide du routard (publiés par Hachette, ndlr) dans les Relay Hachette. Des séries comme les Folio à deux euros, je n’arrive pas à les vendre non plus. Et, pour atteindre certains fragments de marché, qui n’appartiennent pas aux chaînes de mes concurrents, je suis quand même encore obligé de passer par leur intermédiaire : une partie des centres Leclerc, par exemple, ne veulent pas être traités en direct, ils ont donné l’exclusivité de leurs relations-livres à Hachette.
Serez-vous un jour tenté de vendre ?
Je n’en ai pas l’intention ! Sauf si j’étais frappé d’une grave maladie, à ce moment-là, je simplifierais les choses pour mes petites héritières. Je tiens ce métier de mon grand-père, de mon père, c’est un passage de témoin. Je suis fier de cette maison, j’aime bien la vie par ailleurs, je n’irais pas me sacrifier. Si ça peut continuer au-delà de ma personne, j’en serai ravi. Dans ce métier, on est comme les galeristes, il faut aimer être trahi, aimer aussi ne pas être trahi. On passe autant de temps à trouver des auteurs qu’à vouloir les garder ou empêcher qu’ils s’en aillent. Ou à vouloir récupérer l’auteur du copain. Ce qui m’embête, ce sont les concentrations. Je ne suis pas obsédé par Hachette, mais Hachette a repris des maisons en Espagne et en Angleterre : les auteurs jeunesse que ces maisons publient et qui m’intéressent, je ne peux pas les avoir. Ce n’est pas une bonne chose.
07:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (22)
mardi, 20 décembre 2005
La collection « Passion »
 La collection « Passion » que publie Textuel est élégante et très intéressante. Ce sont de grands livres au format 28 x 25, 5 cm, illustrés (environ trois-cent cinquante images par volume) contenant des biographies simples, relativement peu fouillées (pas réellement scientifiques) mais toujours honnêtes – et surtout présentées selon un éclairage particulier, l’auteur mettant l’accent sur des points bien définis, en général annoncés par le sous-titre. Cette optique fait qu’on peut lire ces textes même si l’on connaît très bien le sujet ; on découvrira forcément quelque chose.
La collection « Passion » que publie Textuel est élégante et très intéressante. Ce sont de grands livres au format 28 x 25, 5 cm, illustrés (environ trois-cent cinquante images par volume) contenant des biographies simples, relativement peu fouillées (pas réellement scientifiques) mais toujours honnêtes – et surtout présentées selon un éclairage particulier, l’auteur mettant l’accent sur des points bien définis, en général annoncés par le sous-titre. Cette optique fait qu’on peut lire ces textes même si l’on connaît très bien le sujet ; on découvrira forcément quelque chose.


 Une des originalités de cette série est que les illustrations sont de deux sortes : « directes » – en rapport avec le sujet – et « indirectes » – images d’ambiance recréant un contexte. Le texte renvoie à toutes, systématiquement, si bien que rien n’est gratuit (encore une de mes obsessions : éviter la gratuité du propos).
Une des originalités de cette série est que les illustrations sont de deux sortes : « directes » – en rapport avec le sujet – et « indirectes » – images d’ambiance recréant un contexte. Le texte renvoie à toutes, systématiquement, si bien que rien n’est gratuit (encore une de mes obsessions : éviter la gratuité du propos).


 Une autre particularité : ces livres en noir et blanc paraissent être en couleurs. Rêve visuel à l’explication fort aisée. Les maquettistes, très talentueux, choisissent pour chaque sujet une dominante colorée et une seconde couleur de contrepoint. Ces deux teintes sont utilisées en surimpression de certains documents en noir et blanc, mais pas de tous. Le résultat est que les images sont parfois en noir et blanc, d’autres fois en bichromie (couleur choisie et noir). Les titres sont aussi imprimés dans la dominante. Si bien que le lecteur a vraiment le sentiment de lire un livre… en quadrichromie. Le papier légèrement teinté ajoute aussi, évitant l’indécente blancheur artificielle et usante pour les yeux, à cette impression.
Une autre particularité : ces livres en noir et blanc paraissent être en couleurs. Rêve visuel à l’explication fort aisée. Les maquettistes, très talentueux, choisissent pour chaque sujet une dominante colorée et une seconde couleur de contrepoint. Ces deux teintes sont utilisées en surimpression de certains documents en noir et blanc, mais pas de tous. Le résultat est que les images sont parfois en noir et blanc, d’autres fois en bichromie (couleur choisie et noir). Les titres sont aussi imprimés dans la dominante. Si bien que le lecteur a vraiment le sentiment de lire un livre… en quadrichromie. Le papier légèrement teinté ajoute aussi, évitant l’indécente blancheur artificielle et usante pour les yeux, à cette impression.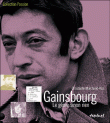
 Le choix des sujets s’effectue dans plusieurs domaines. Des musiciens (Bach), des personnages historiques (Napoléon, de Gaulle), des artistes (Piaf, Ferré), des poètes (Rimbaud, Baudelaire, Hugo, Apollinaire), des architectes (Le Corbusier), des écrivains (Sartre, Simenon, Colette)… Il est vrai que c’est sans risque mais l’originalité, précisément, tient dans l’optique de l’auteur, comme il a été dit au début.
Le choix des sujets s’effectue dans plusieurs domaines. Des musiciens (Bach), des personnages historiques (Napoléon, de Gaulle), des artistes (Piaf, Ferré), des poètes (Rimbaud, Baudelaire, Hugo, Apollinaire), des architectes (Le Corbusier), des écrivains (Sartre, Simenon, Colette)… Il est vrai que c’est sans risque mais l’originalité, précisément, tient dans l’optique de l’auteur, comme il a été dit au début.

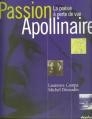 Cependant, tout n’est pas parfait. J’ai attendu longtemps le volume consacré à Apollinaire et, l’ayant feuilleté, je ne l’ai pas acheté, un peu déçu. Les documents d’ambiance ne valent qu’en complément de ceux, plus « directs ». S’agissant d’Apollinaire, je connaissais déjà toutes les images « directes », le reste alors n’avait plus le même intérêt. C’est que l’entreprise a ses limites iconographiques : on ne peut pas inventer des documents qui n’existent pas.
Cependant, tout n’est pas parfait. J’ai attendu longtemps le volume consacré à Apollinaire et, l’ayant feuilleté, je ne l’ai pas acheté, un peu déçu. Les documents d’ambiance ne valent qu’en complément de ceux, plus « directs ». S’agissant d’Apollinaire, je connaissais déjà toutes les images « directes », le reste alors n’avait plus le même intérêt. C’est que l’entreprise a ses limites iconographiques : on ne peut pas inventer des documents qui n’existent pas.
 J’écris cette note d’autant plus librement que les éditions Textuel m’ont joué, il ya deux ans et demi, un très sale tour, si bien que je ne les porte pas dans mon cœur. J’ai donc un réel plaisir à présenter, avec beaucoup d’indépendance, cette collection. Je le fais sans intérêt personnel aucun, faut-il le préciser ?
J’écris cette note d’autant plus librement que les éditions Textuel m’ont joué, il ya deux ans et demi, un très sale tour, si bien que je ne les porte pas dans mon cœur. J’ai donc un réel plaisir à présenter, avec beaucoup d’indépendance, cette collection. Je le fais sans intérêt personnel aucun, faut-il le préciser ? Malheureusement, ces livres coûtent cher : quarante-neuf euros.
Malheureusement, ces livres coûtent cher : quarante-neuf euros.


10:25 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 13 décembre 2005
Un livre de Bernard Grasset
J’ai acheté sur les quais de la rive gauche un volume de Bernard Grasset, La Chose littéraire, publié par Gallimard en 1929. Il s’agit d’un recueil d’articles parus auparavant dans Le Journal.
Outre que Grasset y apparaît tel qu’en lui-même, hautain, arrogant, élitiste, méprisant, péremptoire, misogyne, outre qu’il accumule les affirmations en prétendant démontrer avant de conclure : « Vous voyez bien que » alors qu’on n’a rien vu du tout – il reste une chose qui m’amuse quand elle ne me fait pas grincer des dents, c’est ce que Grasset raconte de l’état de l’édition au moment où il écrit. Nous sommes, je le redis, en 1929, au moment de la crise, dix ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale (quand il note : « Avant la guerre », c’est « Avant la Première Guerre mondiale » qu’il faut comprendre).
Eh bien, Grasset brosse alors un tableau que j’avais déjà vu avant de lire son livre. C’est celui qu’on me présente depuis ma toute première tentative éditoriale, en 1971. Les mêmes problèmes, les mêmes mots et la même fâcheuse tendance à lier ces questions à l’époque en ce qu’elle a de soi-disant particulier et d’exceptionnel.
Alors, quand les éditeurs vous parleront de la crise de l’édition et des difficultés inhérentes et du goût du public et des problèmes de stockage et des prétentions financières des auteurs et du coût des stocks et de la course aux prix et patati et patata, si m’en croyez, éclatez de rire. En 1929, Grasset, avec ses excès classiques, ses outrances d’expression, disait déjà tout ça. N’en croyez pas un mot.
07:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 28 novembre 2005
La boue et la grâce, 2
Les droits du Journal de Goebbels seront donc versés à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Soit.
Précisons ici ce qu’on entend habituellement par « droits ». N’allez surtout pas imaginer que l’éditeur de cette cochonnerie ne touchera rien. Les bénéfices de l’éditeur, s’il y en a, et il y en aura, ne sont pas considérés comme des droits. De quels droits s’agit-il alors ? Certainement pas de ceux des traducteurs. On ne voit pas pourquoi les trois traducteurs professionnels, Dominique Viollet, Gaël Cheptou et Eric Paunowitsch, ne serait pas payés pour leur travail, un travail d’ailleurs considérable. Grands dieux, pourquoi ont-ils accepté une telle commande ? Si j’étais traducteur, je refuserais tout net ce genre de besogne.
Les droits de Pierre Ayçoberry, qui a établi et annoté le texte français ? Sûrement pas.
Alors, les droits de qui ? Les droits d’auteur. Il n’y en a pas d’autres. Or, l’auteur est mort. S’il avait pu mourir beaucoup plus tôt, d’ailleurs, c’eût été encore mieux. Il faut donc chercher du côté des ayants-droit. Qui est l’héritier de Goebbels ? Un banquier suisse. François Genoud est l’héritier de Goebbels et d’autres dirigeants nazis, si j’en crois Le Point du 24 novembre 2005. Ce serait donc ce monsieur qui, très large, n’est-ce pas, très généreux, donnerait ses droits. Quelle hypocrisie. Comme je suis infiniment naïf, j’aurais pensé, a priori, que l’héritier de Goebbels se serait fait tout petit, aurait bien pris soin de cacher une telle ascendance ou, s’il n’a pas avec le fou de liens de famille, une telle relation, et n’aurait en aucun cas autorisé la publication des ordures du malade.
Au lieu de cela, ce type s’en sort avec les honneurs, passe pour généreux et pour racheter l’horreur.
Oui, je suis très naïf.
10:30 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (19)
samedi, 26 novembre 2005
La boue et la grâce
Je suis tombé hier sur ce livre, qui m’a fait me poser mille questions.
Il est précisé que les droits correspondants seront versés à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je crains qu’il ne s’agisse d’un effet pur et simple. Les sommes, sans doute, ne seront pas significatives et la Fondation ne sera guère avancée dans son action. Au rebours, le mal que pourront faire de telles « idées » sera forcément plus important. Je demande : qu’est-ce que publier les délires de Goebbels dans un pays où Mein Kampf est interdit ? Où veut-on en venir ? Le nazisme est le mal absolu – il s’est bien appliqué à le prouver, me semble-t-il – et les journaliers de Goebbels ne peuvent pas, à mon avis, être considérés ainsi qu’un document historique comme un autre. Le nazisme n’est pas anodin. Une édition scientifique de ces saloperies n’est pas une édition scientifique comme une autre. On peut, même si l’on déteste Napoléon, lire sa correspondance ou le Mémorial de Sainte-Hélène de Las Cases sans risque majeur pour l’avenir de l’humanité. On ne peut pas lire l’hystérie nazie sans risque, même si l’on est cuirassé, blindé, bétonné.
Car il faut dire une chose.
Nous en arrivons au point de la responsabilité éditoriale. Je m’explique. J’ai tenu dans mes mains cet ouvrage. C’est un livre magnifique. D’un format légèrement supérieur à la moyenne des publications, d’une épaisseur en parfait accord avec ses dimensions, il possède par conséquent une main merveilleuse. C’est terrible : ce livre est sensuel. C’est affreux. Il est extrêmement bien présenté, très bien imprimé, avec des marges agréables, bref, il est presque parfait en tant qu’objet. C’est même un des plus beaux livres qu’il m’ait été donné de voir depuis fort longtemps : le danger est immense. Il est rendu plus grand encore par le portrait du sinistre bonhomme qui figure en couverture. Un portrait était-il nécessaire ? Une couverture typographique n’eût-elle pas suffi ? Le portrait en question étant de grande qualité, le diariste risque de paraître séduisant.
Vous savez que l’édition est un de mes dadas. J’étudie les problèmes du livre depuis trente ans au moins et je pense connaître l’effet que peuvent avoir les livres sur le public, avant même d’être lus. Celui-ci est trop beau pour le poison qu’il contient. L’abjection n’a pas besoin d’être fleurie. La boue ne doit pas être ornée des rubans de la grâce. C’est bien trop risqué. Cela ne s’arrête pas là. En quatrième de couverture, une photographie en couleurs montre Goebbels aux côtés d’Adolf Hitler. Les deux hommes rient. Une image en couleurs des premières années 40, ce n’est pas fréquent et donc d’autant plus attirant pour l’esprit, la curiosité. Toujours en quatrième de couverture, figurent quelques mots de l’auteur du Journal, disant en substance que, parfois, Hitler lui demandait de rester avec lui parce qu’il avait beaucoup de choses à lui dire et que sa présence le rassurait ; le fou malade explique qu’il se sentait très honoré de cela. C’était exactement le genre de propos qu’il ne fallait pas reproduire : ils induisent un Hitler proche, affectueux, demandant à être rassuré (!).
Je résume : un texte dangereux et puant est édité dans une superbe présentation avec une couverture attirante. Il paraît un mois avant Noël. J’ajoute que, pour 766 pages de texte, ce volume ne coûte que 35 euros. C’est inadmissible. À titre de comparaison, le tome premier de la Correspondance générale de Verlaine (1857-1885) proposé cette année par Fayard dans l’édition de Michael Pakenham, coûtait 45 euros. C’était cher, j’avais abordé ce sujet dans un article de mon ancien blog. Toujours par comparaison, Le Corbusier, la planète comme chantier de Jean-Louis Cohen paru chez Textuel dans la collection « Passion » (191 pages très illustrées) est vendu 49 euros. C’est cher aussi. Verlaine et Le Corbusier me paraissent pourtant avoir été plus utiles à l’humanité que le pitre infâme Goebbels. Autrement dit, la monstruosité, l’ignoble, la honte de l’histoire ont droit à un prix raisonnable. Je ne sais pas à quoi l’on joue mais je sais que c’est avec le feu.
13:10 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (17)
mardi, 22 novembre 2005
Expérience du monde de l’édition, par Feuilly
L’ami Feuilly nous fait part ici de ses démêlés éditoriaux.
F. Weyergans, qui vient d’obtenir le prix Goncourt, a fait un roman sur la difficulté d’écrire un roman. Ne pourrait-on en faire un sur la difficulté que rencontrent certains à se faire éditer ?
Voici, pour ceux que cela tenterait, un exemple tiré de la réalité. Il n’y a plus qu’à broder là-dessus, transformer quelque peu les données et vous obtiendrez un roman qui ne sera peut-être pas mauvais, mais qui à son tour… ne sera jamais publié.
***
Un lecteur assidu décida un jour de prendre la plume. Modestement, il commença par quelques nouvelles. Les mois passant, les feuilles s’empilèrent sur son bureau au point de constituer un gros volume. Comme on écrit tout de même pour être lu, le lecteur devenu « écrivant » proposa donc ses textes à quelques éditeurs. Les grandes maisons lui répondirent dans les deux mois qu’elles n’étaient pas intéressées. Les petites maisons lui dirent la même chose, mais dans un délai d’un an et demi. L’une d’entre elles, cependant, précisa qu’elle n’éditait jamais de nouvelles mais que pour des textes de qualité, elle suggérait l’auto édition (à la même adresse). Intrigué, mais encore fort naïf, le pauvre lecteur devenu « écrivant » demanda pourquoi, si le texte était bon, l’éditeur ne le publiait pas lui-même. La réponse (immédiate) fut qu’il était impensable de publier des nouvelles d’un auteur inconnu car le méchant public ne s’y intéressait pas. Au mieux on acceptait des nouvelles de la part des auteurs « maison », mais encore fallait-il tricher sur la couverture et faire croire qu’il s’agissait d’un roman. Non, pour les nouvelles, il n’y avait qu’une méthode : se faire connaître en insérant des textes dans des revues.
Comme justement le petit éditeur en possédait une, de revue, et que cela tombait fort à propos, le lecteur devenu « écrivant » proposa donc une nouvelle. Elle ne fut pas retenue. Sans doute était-elle mauvaise, mais à vrai dire les autres qui étaient publiées dans la revue n’étaient pas très bonnes non plus. Il comprit alors que la revue demandait des textes à des auteurs locaux ayant quelque notoriété dans leur région, lesquels exécutaient à la va-vite ce travail de commande. Comme personne à part eux ne lisait la revue, ce n’était pas très grave.
Notre lecteur devenu « écrivant » (et beaucoup moins naïf) n’en continua pas moins à écrire des nouvelles. Les feuilles s’empilèrent de nouveau et constituèrent rapidement un deuxième volume. Il eut la sagesse de ne pas chercher à l’éditer et s’attela plutôt à la rédaction d’un roman. Comme il n’écrivait que la nuit (la journée, il devait travailler afin de pouvoir acheter des feuilles et de l’encre pour son imprimante), cela lui prit un certain temps, mais il éprouva beaucoup de plaisir à cette occupation.
Ensuite, le manuscrit terminé, il l’envoya de nouveau à quelques grandes maisons qui, comme précédemment, lui répondirent dans le deux mois qu’elles n’étaient pas intéressées. Plus naïf du tout, il contacta pour s’amuser le petit éditeur qui ne publiait pas de nouvelles en lui disant en substance : « Comme vous me l’aviez demandé, me revoici avec un roman. » Trente-quatre mois après, il reçut une réponse du petit éditeur qui le prenait encore pour un niais car il disait dans sa lettre qu’il était débordé et que son programme était déjà complet pour plusieurs années. Il expliquait que le texte envoyé « n’avait pas résisté à l’écrémage inévitable » et ajoutait hypocritement que « la qualité de l’écriture était là mais qu’il lui fallait faire un choix parmi les bons manuscrits. » Tout cela afin de faire croire qu’il avait lu le texte du lecteur « écrivant », que ce texte avait été en compétition avec d’autres et qu’il était même bon. Complètement déniaisé, le lecteur qui entre-temps avait renoncé à écrire éclata de rire.
Morale de l’histoire : pourquoi attendre aussi longtemps pour envoyer une réponse ? Pourquoi donner aux gens de l’espoir sur la qualité de leur texte alors que celui-ci n’a bien évidemment pas été lu ?
***
Dominique Autié a souvent défendu ici sa profession et c’est normal. Il n’en reste pas moins que la forteresse de l’édition semble imprenable à qui ne dispose pas des bonnes armes.
Pour être objectif, Feuilly tient à joindre un article du Monde.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3246,36-712472@51-688805,0.html12:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 21 novembre 2005
Quatrième épisode
Suite et sans doute fin de l’histoire de France Culture. Je ne vous infligerai pas un résumé des trois épisodes précédents (Chasse gardée, Précision, Suite de l’affaire de France Culture).
J’ai écouté hier soir Projection privée de Michel Ciment, qui ne dure qu’une demi-heure. Trois voix (l’animateur et les deux auteurs de Sautet par Sautet), dans ces conditions, c’est déjà beaucoup et je me demande quel temps de parole aurait pu rester à chacun si j’étais allé participer à l’émission.
Pour ce qui est du contenu, je n’ai rigoureusement rien appris. Il est vrai que j’ai beaucoup étudié le sujet et que cela, sans doute, ne m’était pas destiné. Tout confirme que l’album est une boîte de chocolats pour Noël et qu’il utilise des entretiens déjà utilisés ailleurs. À part ça, Ciment a quand même fait trois erreurs en trente minutes. À la fin de l’émission, il a signalé mon « court essai » (sic) en une phrase. Je m’y attendais, et puis c’est l’usage, ça se fait. J’ajoute quand même que le « court essai » contient plus de texte que le gros album-gâteau-chantilly. Et ce texte, qui vaut ce qu’il vaut, c’est moi qui l’ai pondu, quand celui du gros album-barbe-à-papa est le résultat d’entretiens.
L’émission peut être écoutée cette semaine sur le site de France Culture.
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissio...
10:30 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 15 novembre 2005
Chocolats de papier
Voici revenu le temps des livres-boîtes de chocolats. Les gros albums bourrés d’images en couleurs (ou en noir et blanc s’il s’agit d’exploiter la nostalgie, laquelle, c’est bien connu, rapporte beaucoup) écrasent les tables des librairies. Le moins possible de textes, surtout ! Et le format le plus grand ! Le pire, c’est qu’ils sont beaux, ces ouvrages, on ne peut même pas dire le contraire…
Et touours l’imagination de l’édition française, jamais en retard d’un conformisme, d’une platitude. En quelques jours à peine, huit livres consacrés à Mitterrand – encore ne suis-je pas sûr de les avoir tous comptés ; je ne sais combien à Marie-Antoinette… Bah, oublions cet inventaire, non sans avoir noté que l’année du centenaire de Sartre, qui nous a valu une avalanche de publications et de rééditions, continue à produire, au fil des mois mais à un rythme plus raisonnable, des volumes nouveaux.
15:40 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 07 novembre 2005
Suite de l’affaire de France Culture
Après Chasse gardée et Précision, voici une note qui bouclera la trilogie.
J’ai feuilleté hier, à la librairie L’Écume des pages, boulevard Saint-Germain, le Sautet par Sautet de Binh et Rabourdin. C’est vraiment une boîte de chocolats pour Noël. Un énorme volume, très lourd, pas manipulable, et qui surtout reprend les entretiens ayant déjà servi au documentaire et au DVD de Binh. À première vue, rien d’inédit. Les très nombreuses photos sont déjà connues. Bref, rien de neuf, un livre a priori inutile, sous réserve d’une lecture plus attentive par mes soins, mais qui n’aura pas lieu tout de suite, l’ouvrage coûtant cinquante-trois euros.
La surprise vient de la bibliographie, par ailleurs fort incomplète. Il se trouve que mon petit livre de rien du tout y figure. Or, voilà : pour tous les autres ouvrages mentionnés, quelques mots, une phrase ou deux, précisent le contenu. Pour le mien, rien. Ce qui prouve bien qu’il n’est pas connu et que, selon toute vraisemblance, Ciment l’ayant reçu en service de presse l’a signalé aux auteurs ses amis, qui l’ont ajouté sans l’avoir vu. Or, je tiens qu’on ne peut écrire un livre sur quelque sujet que ce soit, sans avoir lu tout – je dis bien : tout – ce qui a déjà été dit sur la question. Je certifie que c’est ce que j’ai toujours fait.
La seconde surprise vient du libraire lui-même. Mon petit volume, toujours lui, qui avait été, dès son arrivée, placé au ras du sol dans un endroit jamais regardé par personne, ce même petit volume qui, la semaine dernière, ne se trouvait plus dans ce discret rayon, y était de nouveau hier. Incompréhensible. Je passe sur le fait que la couverture de chaque exemplaire (trois) est abîmée et donc que ces livres sont forcément invendables.
La troisième surprise vient de l’émission de France Culture dont nous avons déjà parlé. Cette émission, que je pensais à tort être en direct, est en fait diffusée en différé. Enregistrée vendredi 4 novembre, elle devait passer dimanche 6 à 22 h 10. C’est du moins ce qu’affirmait le programme donné sur le site officiel de France Culture. Curieux de tout, je m’installe hier soir pour écouter cette émission et j’entends la voix de Ciment annoncer… tout autre chose. Il a parlé de ce qui serait abordé, cité les noms des invités. Rien à voir, rien à voir, rien à voir.
Une histoire de fous. J’ajoute que Ciment, comme il fallait s’y attendre, n’a pas répondu à mon petit mot de l’autre jour. Je vous raconterai la suite, s’il en est une. La trilogie deviendra peut-être une tétralogie.
10:35 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (12)
lundi, 31 octobre 2005
Précision
Je crois qu’une précision s’impose, après ma note Chasse gardée et les explications que j’ai données sur ma réaction face à l’invitation qui m’était faite par Ciment, pour France Culture.
Il semble que plusieurs personnes se soient étonnées de cette question de disponibilité que j’avais soulevée, cette question de congé à prendre. On me l’a dit ici même (c'est très bien ainsi) et maintenant, voilà que d’autres me le disent en privé. J’aurais préféré, justement, qu’elles le disent ici, quitte à me bousculer.
Je n’ai pas voulu jouer les divas. Depuis trente-deux ans que je travaille à temps plein, je me heurte au même problème – et lorsque mes filles étaient petites, c’était pire encore, au point de vue de l’emploi du temps. Je le regrette, mais j’ai des patrons sur le dos et je ne peux pas m’absenter comme je veux. Croyez bien que ça ne me plaît pas. En l’occurrence, pour me libérer ce vendredi, je n’aurais pas pu être fixé avant mercredi. Ciment voulait une réponse rapide, pas quarante-huit heures avant, et je le comprends, une émission ne s’improvise pas l’avant-veille. Donc, par le fait, je ne pouvais que dire non. En dehors même de toutes ces questions éditoriales dont nous avons parlé, sur le simple plan pratique, je ne pouvais pas répondre. Je précise que je n’ai pas fait part à Ciment de ces considérations-là. Je me doute bien que ce n’est pas son problème. C’est ici uniquement que je l’ai dit.
Cela étant, il ne faut pas non plus être ébahi parce qu’on est invité à France Culture. C’est la première fois que je refuse une émission. J’ai fait une douzaine de radios et participé longuement à un documentaire pour la télévision. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Je ne le dirai jamais assez : je n’ai aucun ego, et les émissions, je m’en fiche. Ce n’est pas ça qui me fera m’ébahir ni m’aplatir en me confondant en remerciements. D’ailleurs, une émission enregistrée en 2000 (j’avais pris un jour de congé…), qui devait être diffusée en différé sur Radio Bleue, n’est jamais passée.
Ce qui m’ennuie bien plus, vraiment, c’est qu’à cause de cette histoire, même si ce n’est évidemment pas son seul motif, un ami qui écrivait ici ne veut plus participer. J’espère qu’il changera d’avis. Car pour un ami, je donnerais tous les Michel Ciment du monde.
19:40 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 28 octobre 2005
Chasse gardée
 J’ai publié en mai dernier un petit livre, Les Films de Claude Sautet, aux éditions Atlantica-Séguier. Depuis six mois bientôt, ce travail n’a obtenu aucun article, aucune recension, aucun écho de quelque nature que ce soit. Un ouvrage dont on ne signale pas l’existence est mort-né, tout le monde le sait. J’ai trouvé cela étonnant puisqu’il existe tout de même un public – le sujet est connu – mais j’ai accepté, c’est la règle du jeu, c’est ainsi.
J’ai publié en mai dernier un petit livre, Les Films de Claude Sautet, aux éditions Atlantica-Séguier. Depuis six mois bientôt, ce travail n’a obtenu aucun article, aucune recension, aucun écho de quelque nature que ce soit. Un ouvrage dont on ne signale pas l’existence est mort-né, tout le monde le sait. J’ai trouvé cela étonnant puisqu’il existe tout de même un public – le sujet est connu – mais j’ai accepté, c’est la règle du jeu, c’est ainsi.
De toute façon, ce volume, prévu pour février, avait paru avec trois mois de retard et j’avais trouvé les relations avec Atlantica lamentables : délai invraisemblable pour l’établissement du contrat (honteux mais accepté par moi puisque je n’avais pas le choix) après accord du patron, lenteur excessive pour la moindre réponse ou le plus petit envoi, temps infini pour l’expédition de mes exemplaires d’auteur, bref, une catastrophe. La responsable de la fabrication, elle, s’était montrée rapide, efficace, précise, agréable, intelligente, je n’avais rien à dire. Mais les services éditoriaux et administratifs, eux, furent en-dessous de tout. Quant au service de presse… On m’a téléphoné début juin – un mois après la parution – pour me demander ce que je comptais faire. Heureusement, j’étais assis. J’ai bredouillé : « Mais… Je croyais que c’était fait depuis longtemps… » Réponse : « J’attendais que vous m’appeliez ». Voilà qui était nouveau : « Ah ! Parce que c’est moi qui devais vous appeler ? » Bref, à quelques jours du mois de novembre, rien, aucun article, aucune recension, aucun écho.
La semaine dernière, Atlantica m’envoie un courrier électronique, me faisant part d’une invitation qui m’était faite par Michel Ciment à participer à son émission de France Culture, Projection privée, le 4 novembre prochain. Thème : « Autour de Claude Sautet », en compagnie de Dominique Rabourdin et N. T. Binh, eux-mêmes auteurs de Sautet par Sautet, à paraître aux éditions de la Martinière. Ledit ouvrage, un album de trois cent quatre vingt quatre pages, très illustré, vendu cinquante-trois euros, n’est pas encore en librairie mais a déjà obtenu un article dans Première et cette émission de radio. Soit, c’est le jeu et l’attachée de presse de la Martinière est plus efficace que celle d’Atlantica, c’est tout. Rien à dire. Mais je suis agacé et réponds, poliment, que je ne pourrai pas participer à l’émission, ce qui d’ailleurs aurait supposé que je prenne un jour de congé car, naturellement, tout cela a lieu aux jours et heures ouvrables.
Hier, je me dis que, tout de même, il n’est guère courtois de rabrouer ainsi Michel Ciment par l’intermédiaire d’Atlantica et je décide de lui envoyer un petit mot par Internet. Je lui écris donc, via France Culture, sur le site de son émission. En substance, je lui dis mes six mois de déception et mon peu d’empressement, par conséquent, à participer à une rencontre avec d’autres… J’ajoute que même Positif n’a pas signalé la parution de mon ouvrage (alors que Positif soutient Sautet depuis quarante-cinq ans), en sachant très bien que Ciment fait lui-même partie de Positif. J’ajoute que Binh est auteur d’un documentaire sur Sautet, que le documentaire en question est sorti en DVD, que voici maintenant le livre et, avec une ironie un peu triste, je demande : « À quand un CD-rom et un porte-clefs ? »
Et puis, hier soir, je décide d’aller voir, sur le site de La Martinière, de quelle manière est annoncé l’ouvrage à paraître. Et je reste sans voix devant la notice biographique des auteurs. Binh, en plus de ce que j’avais relevé, fait partie du comité de rédaction de Positif. Ciment reçoit donc son collègue du journal dans son émission. Ce n’est pas interdit. Il y a autre chose : le coauteur, Dominique Rabourdin, est directeur de collection de Ramsay-Poche Cinéma. Or, en même temps qu’Atlantica, j’avais contacté Ramsay pour proposer mon manuscrit. Je n’ai jamais reçu la moindre réponse : ni oui, ni non, ni zut. Je comprends mieux aujourd’hui : un des collaborateurs de Ramsay avait un projet similaire en cours. Je dérangeais. D’où le silence qui a entouré la parution de mon petit travail de cent quarante pages à peine, sans illustrations, à couverture uniquement typographique (titres blancs sur fond noir), vendu dix-sept euros, qui paie moins de mine que l’autre, vraie boîte de chocolats pour Noël qui, curieusement, approche.
Qu’on n’aille pas lire ici l’envie ou l’amertume, surtout. Je n’ai rien contre les réseaux, inévitables : on ne peut pas empêcher les hommes de se connaître, de s’apprécier, de s’aider. C’est le côté « chasse gardée » qui me gêne beaucoup plus. Qui êtes-vous, monsieur ? Je l’ai dit cent fois : on ne peut pas publier si l’on n’est pas journaliste ou universitaire, voire les deux (Ciment, par exemple, est aussi professeur à Paris VII). Tant pis pour mon texte, uniquement tourné vers le travail du cinéaste, examiné très en détail et sans anecdotes ni images.
J’ajoute que le sujet n’est pas en cause ici. Qu’on apprécie ou pas Sautet ne fait rien à l’affaire. D’ailleurs, les éditions Textuel m’avaient joué un tour similaire en 2003, pour un tout autre domaine d’étude.
Pour être honnête, je dois ajouter que, sur son blog, l’ami Ludovic avait rédigé une note sur mon livre.
10:40 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (37)
dimanche, 16 octobre 2005
Robert Laffont
 On parle régulièrement d’édition, en ce lieu. Le dernier-né de ma documentation consacrée à ce métier vient de paraître, c’est un nouvel ouvrage de Robert Laffont, le dernier des grands éditeurs fondateurs (ou l’un des derniers, je ne sais plus). Il paraît aux éditions Anne Carrière, c’est-à-dire, si je ne me trompe, chez sa fille. J’en reparlerai certainement.
On parle régulièrement d’édition, en ce lieu. Le dernier-né de ma documentation consacrée à ce métier vient de paraître, c’est un nouvel ouvrage de Robert Laffont, le dernier des grands éditeurs fondateurs (ou l’un des derniers, je ne sais plus). Il paraît aux éditions Anne Carrière, c’est-à-dire, si je ne me trompe, chez sa fille. J’en reparlerai certainement.
Robert Laffont, Une si longue quête, en collaboration avec Brigitte Lozerec’h, Anne Carrière, 2005.
Pour mémoire, les précédents ouvrages de Laffont :


Robert Laffont, Léger étonnement avant le saut,
Robert Laffont, 1996.
18:35 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (24)


