mardi, 12 mars 2013
Demy, 6 : d’un opéra populaire à l’autre

Pourquoi le film Une chambre en ville n’a-t-il pas reçu un accueil aussi enthousiaste que Les Parapluies de Cherbourg ? Tous deux sont des opéras populaires, tous deux sont entièrement chantés.
Comme de coutume, il n’y a pas de raison unique, mais un ensemble de causes.
La musique de Michel Colombier, magnifique partition, n’est pas aussi chantante que celle de Legrand. On ne peut pas isoler d’airs, détacher des « chansons » du contexte.
La lutte des classes « paie » moins, au cinéma – ou dans ce que les spectateurs de Demy attendent faussement de lui ? – que les amours malheureuses. Et pourtant, les amours malheureuses sont aussi présentes dans Une chambre en ville, ô combien.
Les grèves de 1955 aux chantiers navals de Nantes intéresseraient-elles moins le public que la guerre d’Algérie ? 
Dans Les Parapluies, Geneviève est infidèle : elle se lasse assez vite d’attendre son amoureux parti à la guerre, emporte avec elle l’enfant qu’il lui a fait et épouse Cassard, qui donnera son nom à la fille de Guy. Cela serait-il mieux accepté que François Guilbaud abandonnant purement et simplement Violette enceinte de ses œuvres, au milieu d’un marché où l’on balaie les détritus ? Est-ce que, par hasard, le public ne saurait aimer Guilbaud après cet acte lâche, minable, la passion qu’il vit avec Édith ne le dédouanant pas, sa mort tragique ne l’excusant pas, celle d’Édith se suicidant sous les yeux de tous les protagonistes du film ne rachetant rien ?
On compte deux suicides (dont un particulièrement violent, sur le plan visuel) et une mort tragique dans la dernière partie du film : serait-ce trop pour être accepté ?
La stylisation d’Une chambre en ville est-elle plus grande que celle des Parapluies ? Ces grévistes qui lancent sur les CRS des pavés imaginaires, des pavés ramassés nulle part et qu’ils ne portaient pas dans leurs mains avant l’affrontement, seraient-ils moins crédibles que Guy et Geneviève montés sur le travelling et paraissant glisser, flotter dans leurs rêves d’amour, au lieu de marcher comme ils sont censés le faire ?

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 11 mars 2013
Demy, 5 : la figure du père
 Chez Demy, le père est absent : le plus souvent décédé, ou bien parti, et même en prison. Quand, d’aventure, il est présent, il se nomme M. Fournier (La Baie des anges), exerce la profession d’horloger, ce qui suppose, au moins dans le film, un caractère strict, précis, et porte une blouse blanche. Il est autoritaire, fermé, il ne veut pas le savoir. Parfois, un substitut de père apparaît, en la personne du patron : le garagiste Aubin, par exemple (Les Parapluies de Cherbourg). Aubin, lui aussi, porte une blouse blanche, ce qui n’est pourtant pas le plus courant dans un atelier de mécanique.
Chez Demy, le père est absent : le plus souvent décédé, ou bien parti, et même en prison. Quand, d’aventure, il est présent, il se nomme M. Fournier (La Baie des anges), exerce la profession d’horloger, ce qui suppose, au moins dans le film, un caractère strict, précis, et porte une blouse blanche. Il est autoritaire, fermé, il ne veut pas le savoir. Parfois, un substitut de père apparaît, en la personne du patron : le garagiste Aubin, par exemple (Les Parapluies de Cherbourg). Aubin, lui aussi, porte une blouse blanche, ce qui n’est pourtant pas le plus courant dans un atelier de mécanique.
Parfois, après être parti, il revient, mais c’est toujours longtemps après, plusieurs années parfois, et il est encore vêtu de blanc, comme Michel (Lola). Cela ne l’empêche pas de repartir quelque temps plus tard, cette fois pour de bon. On trouve aussi le père du sketch La Luxure, tout juste bon à distribuer des gifles au fils qui pose une question. Ou le père ultra-conservateur et autoritaire de Lady Oscar, qui décide que sa fille sera un garçon et finit, des années plus tard, par se battre avec elle à l’épée.
Souvent, les personnages ignorent qui est leur père. C’est le cas de Cécile (Lola) : elle ignore que son oncle Aimé est en réalité son père. C’est le cas de Françoise Cassard (Les Parapluies de Cherbourg) : elle ignore que Guy est son père et qu’elle devrait s’appeler Foucher. C’est le cas de Boubou (Les Demoiselles de Rochefort) : il ignore que Simon Dame est son père. C’est le cas de Delphine et de Solange (Les Demoiselles de Rochefort) : elles ignorent qui est leur père et portent le nom de leur mère, Garnier. C’est le cas de l’enfant que porte Violette (Une chambre en ville) : il ignorera que François Guilbaud est son père. C’est le cas de Marion (Trois places pour le 26) : elle s’appelle Lambert quand elle devrait s’appeler Montand ; elle ignore que Montand est son père et va pousser jusqu’au bout le rêve d’inceste qui traverse toute l’œuvre de Demy.
Parfois, le père est tout bonnement en prison : le baron de Lambert, père adoptif de Marion (Trois places pour le 26) a cet avantage d’ainsi ne déranger personne. Ici, le père est un pur et simple escroc. Parfois, il vit loin, son fils lui téléphone et leur conversation tourne court à force d’incompréhension : c’est ce qui arrive à George (Model Shop).
Les autres fois, le père est mort. M. Émery, père de Geneviève (Les Parapluies de Cherbourg). Le colonel Langlois, père d’Édith (Une chambre en ville). Ou bien il vend sa fille au fils du baron (Le Joueur de flûte). À moins qu’il ne veuille l’épouser (Peau d’âne). Ou qu’il soit enceint (L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune).
On l’aura compris, le portrait du père, chez Demy, n’est guère reluisant. M. Demy père, le garagiste, a-t-il tant dressé son fils contre lui, au moins inconsciemment, en refusant au début sa vocation de cinéaste, en voulant à tout prix qu’il aille au collège technique apprendre un métier manuel, avant de céder au bout d’un long moment devant l’obstination du jeune Jacques ?
09:49 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 10 mars 2013
Pour sauver le plus beau film du monde
« La société familiale Ciné-Tamaris a besoin de votre aide pour numériser, restaurer le film et le proposer aux normes actuelles de projection ».
J’ai vu, il y a quelques jours, que la famille Demy-Varda lançait un appel, une sorte de souscription pour sauver Les Parapluies de Cherbourg et permettre de continuer à exploiter le film, en le restaurant en numérique. Le pourquoi du comment, la méthode et le suivi de l'opération sont présentés sur une page spéciale, qui explique tout en détail. On peut verser de 1 à 6. 000 euros avec, chaque fois, d'amusantes et artistiques contreparties. Voici le lien :
http://www.kisskissbankbank.com/il-faut-sauver-les-parapluies-de-cherbourg
20:30 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 09 mars 2013
À la retraite
Vieille bique,
J’ai reçu l’autre jour un acte administratif intitulé « Arrêté de radiation des cadres », avec effet du 30 septembre prochain. Voilà que vous vous faites annoncer plusieurs mois à l’avance. Ce doit être pour me laisser le temps de dérouler le tapis rouge, le tapis gris, plutôt, à l’instar de cette comptine où l’on parle aussi de pomme de reinette.
Ainsi, vous allez enfin venir me rendre visite. Depuis si longtemps, je vous attendais et d’absurdes décisions gouvernementales venaient en permanence retarder notre hymen. Vous savez, il est ainsi des gens – on les appelle des personnalités – qui prennent des décisions dans un bureau, et ces décisions engagent votre vie, votre vie à vous, mais ils s’en moquent. Les personnalités ne connaissent pas les personnes.
J’aurai donc espéré notre liaison durant quarante et un ans. Il faut savoir se montrer patient, quelquefois, mais la patience a un défaut rédhibitoire, elle fait blanchir les cheveux et, parfois, les fait perdre. Vous conviendrez que perdre les cheveux des autres est fort culotté. C’est un peu comme si je m’avisais, moi, de faire perdre son temps à la durée. La durée de cotisation, naturellement.
Je suis du genre fidèle, j’espère que vous l’êtes et le serez aussi et que vous ne me claquerez pas dans les doigts sans crier gare, à peine célébrée et consommée notre future union. Ce serait inélégant et, toute vieille dame que vous soyez, il faudra maintenir coûte que coûte votre élégance. Il y va de notre réputation et je ne saurais marcher dans la rue, une traîtresse à mon bras. Ayez à cœur de vivre avec moi aussi longtemps qu’il nous plaira conjointement.
07:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 08 mars 2013
Demy, 4 : de la récurrence
En littérature, en bande dessinée, les personnages récurrents sont aisés à animer. Il suffit à l’auteur de désirer les faire apparaître et réapparaître. Au cinéma, c’est bien plus difficile : les acteurs doivent être toujours vivants, intéressés par le nouveau projet et, bien entendu, libres au moment du tournage.
En dépit de ces obstacles, Demy qui, au commencement de son aventure, voulait réaliser cinquante films, pas moins, et que toutes ces œuvres soient liées entre elles (il n’est malheureusement pas parvenu à ses fins) a tout de même abouti au schéma suivant.
Personnages récurrents, présents à l’écran ou simplement évoqués
Jackie Demaistre : La Baie des anges ; évoquée dans Model Shop.
Michel : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Mme Desnoyers : Lola ; évoquée dans Les Demoiselles de Rochefort ; évoquée dans Une chambre en ville.
Cécile : Lola ; évoquée dans Model Shop.
Lola : Lola ; évoquée dans Les Parapluies de Cherbourg ; Model Shop.
Roland Cassard : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg ; évoqué dans Model Shop.
Frankie : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Yvon : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Aimé : évoqué dans Lola ; évoqué dans Les Demoiselles de Rochefort.
M. Favigny : évoqué dans Lola ; évoqué dans Trois places pour le 26.
Dambiel : Une chambre en ville ; évoqué dans Trois places pour le 26.
Il était par ailleurs question que Guy (Les Parapluies de Cherbourg) réapparaisse dans Les Demoiselles de Rochefort, mais cela n’a pu se faire.
À noter que Demy s’autorise une mise en abyme au milieu d’une récurrence : lorsque Lola, personnage récurrent du film Lola, évoque, dans Model Shop, son passé et, en même temps, celui de Michel, d’Yvon, de Frankie, de Cassard et de Jackie Demaistre, le réalisateur ajoute Catherine Deneuve, citée, elle, comme actrice, par le truchement d’un magazine glissé sous l’album de photographies de Lola.
Toutefois, l’univers du cinéaste se prolonge dans le sens de la récurrence, à travers une série de lieux et de situations.
Lieux et situations
Cafés tenus par des femmes : Lola ; Les Demoiselles de Rochefort.
Mères vivant seules avec leurs filles : Lola (Mme Desnoyers et Cécile) ; Les Parapluies de Cherbourg (Mme Émery et Geneviève) ; Les Demoiselles de Rochefort (Yvonne Garnier et les jumelles) ; Une chambre en ville (la baronne et Édith) ; Trois places pour le 26 (la baronne et Marion).
Pères absents, ailleurs ou décédés : Lola (Cécile rejoint son oncle Aimé à Cherbourg, sans savoir qu’il est son père) ; Les Parapluies de Cherbourg (père de Geneviève décédé) ; Les Demoiselles de Rochefort (jumelles sans père ; Boubou ne sait pas que M. Dame est son père) ; Une chambre en ville (père d’Édith décédé) ; Trois places pour le 26 (père adoptif de Marion en prison ; Marion passe la nuit avec Montand, sans savoir qu’il est son père).
Femmes enceintes sans mari : Les Parapluies de Cherbourg ; Une chambre en ville.
Marraines influentes : Les Parapluies de Cherbourg ; Peau d’âne.
Baronnes désargentées : Une chambre en ville (baronne qu’une mésalliance a faite colonelle et qui, veuve, doit louer une chambre à un ouvrier) ; Trois places pour le 26 (entraîneuse devenue baronne, mais le baron est ruiné et sous les verrous).
Dîner à trois (veuve, fille et Cassard) : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg.
Enfer : Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Parking.
Foires, fêtes foraines, carnavals : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Le Joueur de flûte.
Forains ou artistes arrivant en ville et amenant l’action avec eux : Les Demoiselles de Rochefort ; Le Joueur de flûte ; Trois places pour le 26.
Personnages partant, devant partir bientôt ou désirant partir : Lola ; La Baie des anges ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Model Shop ; Peau d’âne ; Le joueur de flûte ; Trois places pour le 26.
Personnages se croisant, au début sans se connaître : Lola ; La Baie des anges ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Une chambre en ville ; Trois places pour le 26.
Homosexualité, bisexualité, ambiguïté sexuelle : Lady Oscar ; La Naissance du jour ; Parking.
Inceste ou sentiment incestueux : Lola ; Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Les Demoiselles de Rochefort ; Peau d’âne ; Une chambre en ville ; Trois places pour le 26.
Ports : Lola (Nantes) ; La Baie des anges (Nice) ; Les Parapluies de Cherbourg (Cherbourg) ; Les Demoiselles de Rochefort (Rochefort-sur-Mer) ; Une chambre en ville (Nantes) ; Trois places pour le 26 (Marseille).
Librairies : Lola ; Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Trois places pour le 26.
Petits commerces : Lola (coiffure) ; La Baie des anges (horlogerie) ; Les Parapluies de Cherbourg (magasin de parapluies ; garage) ; Les Demoiselles de Rochefort (magasin de musique) ; L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune (coiffure ; auto-école) ; Une chambre en ville (magasin de télévision) ; Trois places pour le 26 (parfumerie).
Passage Pommeraye : Lola ; mentionné dans Les parapluies de Cherbourg ; Une chambre en ville.
Principaux lieux où se concentre l’action et où se retrouvent tous les personnages : Les Parapluies de Cherbourg (magasin de parapluies) ; Les Demoiselles de Rochefort (café sur la place) ; Une chambre en ville (chez la baronne).
Rendez-vous donné « à huit heures devant le théâtre » : Lola (Lola à Cassard) ; Les Parapluies de Cherbourg (Geneviève à Guy).
Voitures noires survenant comme de mauvais présages : La Baie des anges (Citroën de Caron) ; Les Parapluies de Cherbourg (Mercédès de Cassard) ; Parking (Porsche de Caron).
Ces relevés, peut-être non exhaustifs, montrent que les films sont davantage liés entre eux, qu’il n’y paraît au lu d’une simple liste de personnages récurrents. Ils montrent encore la cohérence absolue du monde de Demy. On note que la récurrence, qu’elle soit des personnages, des lieux ou des situations, se manifeste indépendamment du genre des films (opéras populaires filmés, comédies musicales, films avec chansons, contes) et de la technique (noir et blanc, couleur).


Marc Michel joue Roland Cassard dans Lola et dans Les Parapluies de Cherbourg


Anouk Aimée joue Lola dans Lola et dans Model Shop
07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 07 mars 2013
Demy, 3 : demeurer un chef-d’œuvre
Pourquoi le film Les Parapluies de Cherbourg demeure-t-il un chef-d’œuvre ? Au moment de son tournage, pouvait-on se douter qu’il ferait le tour du monde et que, cinquante ans plus tard, on en parlerait encore, mieux : que la ville de Cherbourg organiserait des manifestations commémoratives ?

Comme toujours, il n’y a pas de réponse et l’on ne peut avancer que l’exposé d’une série de causes, d’un faisceau de raisons. L’authenticité absolue du cinéaste, évidemment. L’invention géniale d’un genre, naturellement. La création de couleurs et de costumes encore jamais vus, en tout cas, jamais vus réunis. La rencontre parfaite, faut-il le dire, de deux créateurs, deux artistes, Demy et Legrand, et l’osmose de leur collaboration. L’exigence et la rigueur de l’auteur, palpables dès la première vision, vérifiables au long des dizaines qui suivirent. La fluidité d’un filmage et d’un montage, parfaitement incontestables. La photographie, juste et précise, d’une société donnée à une époque donnée, tellement juste et tellement précise que, paradoxalement, elle sort du temps et devient universelle, un peu comme ces photographies de classes qui deviennent, avec les années, l'école elle-même.
Et ce film magnifique, non content de ramasser le prix Delluc et la Palme d’or au passage, comme sans s’en apercevoir, révèle et consacre en même temps un réalisateur, un compositeur, une productrice et une actrice. Seulement.

Les Parapluies de Cherbourg : tournage de la scène du départ de Guy, sur le quai de la gare : le travelling arrière est effectué à une vitesse différente de celle du train, ce qui crée un bel effet visuel (Photo DR, Ciné-Tamaris).
07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (8)
mercredi, 06 mars 2013
Demy, 2 : le plus beau film du monde
 Je ne sais pas de film plus réellement populaire, plus réussi que la merveille de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, avec la musique de Michel Legrand. C’est une fête somptueuse, bâtie sur un argument cruel au possible, œuvrée dans un décor aux couleurs inimaginables.
Je ne sais pas de film plus réellement populaire, plus réussi que la merveille de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, avec la musique de Michel Legrand. C’est une fête somptueuse, bâtie sur un argument cruel au possible, œuvrée dans un décor aux couleurs inimaginables.
Tout ici est une réussite, du générique où se croisent les parapluies filmés à la verticale, à la dernière image, celle de cette station-service dans la nuit, sous la neige de Noël, avec toutes ses lumières, tel un gâteau blanc sous le rouge cerise des pompes à essence. De la partition remarquable en tous points, qui a su permettre de chanter l’intégralité du texte, même lorsqu’il était extrêmement prosaïque (les scènes qui se déroulent au garage Aubin, par exemple), à la voix des chanteurs doublant les comédiens, qui furent tenus de jouer sur un rythme plus lent qu’au naturel. De ce choix de couleurs plus que vives (on peut même dire que certaines nuances furent absolument inventées en 1964) au contraste qu’il crée, justement, avec la noirceur du thème. C’est bien d’un opéra qu’il est question, non d’une simple comédie musicale. L’ambition même du genre s’oppose à la modestie de Guy, de Geneviève et de Mme Emery, de Madeleine ou de tante Élise. On narre une histoire triste, de tous les jours, qui, avec des personnages communs, banals, se déroule dans des milieux modestes dans une ville de province, à une époque, la plus conformiste qui soit. Mais on a fait appel à tous les talents, à toutes les inventions, on a servi le film avec amour et, de là, naît un authentique et incontestable chef-d’œuvre.
Si notre société n’a strictement plus rien à voir avec celle qui est montrée dans ce film, on le regarde encore aujourd’hui d’un œil que la nostalgie n’a même pas besoin d’attendrir. Parce qu’il reste présent, quotidien. Tour de force artistique, cette œuvre est à la fois « décalée » et « en phase » par rapport à nous. Ce qui aurait pu n’être qu’une délicieuse bluette, même tournant mal, ne se démodera jamais parce qu’ayant touché à l’universel. Cette histoire reste un bout du génie de l’humanité, un trésor de la création populaire bien comprise, respectueuse de son public et authentiquement engagée dans une démarche d’artiste consciente.
Ce film mémorable supporte plutôt bien d’être vu sur un petit écran, ce qui est rare. Il ne s’éloigne jamais, en effet, de l’intimisme inhérent à son sujet, même si la toile de fond est celle de la guerre d’Algérie, historique. Ce n’est pas pour autant un spectacle « familial » car, s’il arrive qu’on y pleure des larmes jamais vulgaires, il pourrait bien se produire aussi que l’injustice du destin y révolte des cœurs tendres.
 Des esprits jeunes, en effet, souffriront de voir Mme Emery pousser Geneviève, enceinte de Guy, à épouser Roland Cassard, diamantaire protecteur. Ils comprendront mal qu’elle n’ait pas absolument tort d’agir ainsi, contexte socioculturel aidant. Ils donneront à Guy, soldat absent, toute leur sympathie, au détriment de Cassard.
Des esprits jeunes, en effet, souffriront de voir Mme Emery pousser Geneviève, enceinte de Guy, à épouser Roland Cassard, diamantaire protecteur. Ils comprendront mal qu’elle n’ait pas absolument tort d’agir ainsi, contexte socioculturel aidant. Ils donneront à Guy, soldat absent, toute leur sympathie, au détriment de Cassard.
Et pourtant, risquons un point de vue différent de celui couramment partagé. Même en sachant, cela se voit à l’écran, que Mme Emery épouse Cassard par procuration en lui donnant sa fille, il reste que Cassard est réellement désintéressé, amoureux et sincère ; il sauve littéralement Guy d’un échec futur puisque, Cassard ou pas, enceinte ou non, Geneviève est bel et bien en train de l’oublier (« C’est drôle, l’absence ») parce que deux ans de séparation, c’est bien long, sans téléphone possible, au hasard de courriers qui n’arrivent pas. Guy et Geneviève, réunis, auraient couru au désastre. Allons, Cassard n’est pas si mal venu, n’est-ce pas ? Même si Geneviève l’épouse sans amour. Madeleine n’est pas qu’une consolation pour Guy car elle l’a, elle, toujours aimé en silence et attendu avec patience ; elle se serait effacée si elle l’avait dû, elle ne demande rien, jamais, ne réclame aucun sentiment qui n’aurait pas lieu d’être ; c’est Guy qui lui demande de rester, après la mort d’Élise qu’elle aura assistée jusqu’au bout. C’est avec elle et grâce à l’héritage d’Élise que Guy réalisera ses projets. C’est elle qui peut façonner son bonheur. Et c’est durant son absence d’un moment, à la fin du film, que revient Geneviève, par hasard (un hasard qui, alors qu’elle rallie Paris au départ de l’Anjou, la fait passer par Cherbourg !), prendre de l’essence pour la Mercedes de Cassard, qu’elle conduit à présent. Cette même Mercedes que Guy n’a pas pu réparer, au début, parce qu’il ne pouvait pas faire une heure supplémentaire, et pour cause : il allait au théâtre... avec Geneviève. Qu’allaient-ils voir et entendre ? Un opéra. Cette scène ultime, dure mais si bien notée, pour ainsi dire décalquée dans le carnet de dessins de la vie tant elle est évidente pour qui a connu un bout d’amour une fois dans son existence, peut révolter les cœurs intègres. En attendant qu’ils en vivent un jour une copie, peut-être sans musique et sans trop de couleurs cette fois.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 05 mars 2013
Demy : que conseiller ?
 Si je devais recommander des films de Jacques Demy à quelqu’un qui ignorerait tout de ce cinéaste prodigieux, que choisirais-je ? Sans doute ne choisirais-je pas et dirais-je : « Il faut regarder, plusieurs fois de préférence, l’intégrale publiée il y a quelques années et qui, comme toute intégrale, ne l’est pas puisqu’il y manque deux courts-métrages de commande, mais enfin, ce n’est pas très grave puisque Demy ne les reconnaissait pas vraiment comme siens ».
Si je devais recommander des films de Jacques Demy à quelqu’un qui ignorerait tout de ce cinéaste prodigieux, que choisirais-je ? Sans doute ne choisirais-je pas et dirais-je : « Il faut regarder, plusieurs fois de préférence, l’intégrale publiée il y a quelques années et qui, comme toute intégrale, ne l’est pas puisqu’il y manque deux courts-métrages de commande, mais enfin, ce n’est pas très grave puisque Demy ne les reconnaissait pas vraiment comme siens ».
Mais encore ? Si je devais ? Eh bien, j’indiquerais évidemment les deux films qui ressortent d’un genre littéralement inventé par Demy, l’opéra populaire filmé. Inventé, oui, puisque personne n’avait jamais osé cela auparavant et que personne n’a plus jamais tenté de le faire ensuite, une fois le cinéaste disparu. Un genre, donc, définitivement marqué par lui, porteur de son empreinte, qui n’a rien à voir avec la comédie musicale stricto sensu, dont il a par ailleurs dessiné l’image à la française.
Un genre nouveau, qui l’est resté, où tout le texte, sans exception, est chanté. Opéra, puisqu’entièrement chanté. Populaire, puisque compréhensible. Filmé, pour la première fois. C’est tout simplement merveilleux.
On aura reconnu Les Parapluies de Cherbourg, que je tiens pour le plus beau film du monde, excusez du peu, et que j’ai dû voir vingt ou trente fois… pour le moment, car j’ai bien l’intention de continuer. On aura reconnu Une chambre en ville, qui n’eut pas le même succès, peut-être parce que le thème était plus noir encore que celui des Parapluies, peut-être parce que la musique de Michel Colombier contenait moins d’« airs » que celle de Michel Legrand. Pourtant, il s’agit ici de deux tragédies, raison de plus pour ne pas parler de comédies.
Après avoir regardé ces deux œuvres extraordinaires, il faudra poursuivre, explorer cent fois cet univers extrêmement bouleversant, traversé en permanence par les obsessions du cinéaste (bisexualité, inceste), où se promènent des personnages récurrents, où les destins se croisent, toujours dans l’amertume, où les amours ratent, sont condamnées par les guerres ou les grèves, où la figure du père, presque toujours absente, est montrée une fois ou deux d’une manière péjorative, où tous les clins d’œil et citations sont disséminés (comprenne qui pourra), où les personnages qu’on ne revoit pas physiquement sont cependant nommés au cours du dialogue, où, dans un port ou un autre, l’on va de départ en rupture, de désillusion en espoir caduc, où la pudeur de l’auteur vient farder tout cela de chansons et de gammes chromatiques éblouissantes... Bien entendu, on gagnera infiniment à regarder tout cela dans l’ordre chronologique.
univers extrêmement bouleversant, traversé en permanence par les obsessions du cinéaste (bisexualité, inceste), où se promènent des personnages récurrents, où les destins se croisent, toujours dans l’amertume, où les amours ratent, sont condamnées par les guerres ou les grèves, où la figure du père, presque toujours absente, est montrée une fois ou deux d’une manière péjorative, où tous les clins d’œil et citations sont disséminés (comprenne qui pourra), où les personnages qu’on ne revoit pas physiquement sont cependant nommés au cours du dialogue, où, dans un port ou un autre, l’on va de départ en rupture, de désillusion en espoir caduc, où la pudeur de l’auteur vient farder tout cela de chansons et de gammes chromatiques éblouissantes... Bien entendu, on gagnera infiniment à regarder tout cela dans l’ordre chronologique.

14:28 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 04 mars 2013
Bourrades
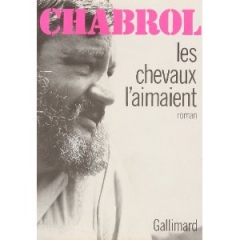 Je me souviens de Jean-Pierre Chabrol signant ses ouvrages à la fête du journal L’Humanité, à la Courneuve, en septembre 1972. Il me dédicace son roman, paru chez Gallimard, Les chevaux l’aimaient. Il note : « À Jacques Layani, avec une bourrade complice des vents rebelles ». Son écriture est à sa mesure : elle occupe la page entière. J’ai longtemps été très fier de cette dédicace. Quarante et un ans passèrent. La semaine dernière, j’avisai, vendu d’occasion chez Gibert, un autre exemplaire des Chevaux. Je l’ouvris et, l’espace d’un instant, me demandai ce que mon livre faisait là. Même écriture, évidemment, mais aussi même encre (un stylo-feutre bleu), pour cette dédicace, sans aucun doute rédigée le même jour : « À M. Untel, avec une bourrade complice de nos tramontanes rebelles ». Sacré Chabrol ! Je ne suis pas choqué, je comprends parfaitement qu’on s’autorise, lorsqu’on signe à tire-larigot, à écrire à peu près la même chose à chacun. Finalement, le plus étonnant est que, dans une agglomération de douze millions d’habitants, je tombe, moi, sur un livre revendu, porteur de ce texte de 1972, presque identique au mien, alors que nous sommes en 2013.
Je me souviens de Jean-Pierre Chabrol signant ses ouvrages à la fête du journal L’Humanité, à la Courneuve, en septembre 1972. Il me dédicace son roman, paru chez Gallimard, Les chevaux l’aimaient. Il note : « À Jacques Layani, avec une bourrade complice des vents rebelles ». Son écriture est à sa mesure : elle occupe la page entière. J’ai longtemps été très fier de cette dédicace. Quarante et un ans passèrent. La semaine dernière, j’avisai, vendu d’occasion chez Gibert, un autre exemplaire des Chevaux. Je l’ouvris et, l’espace d’un instant, me demandai ce que mon livre faisait là. Même écriture, évidemment, mais aussi même encre (un stylo-feutre bleu), pour cette dédicace, sans aucun doute rédigée le même jour : « À M. Untel, avec une bourrade complice de nos tramontanes rebelles ». Sacré Chabrol ! Je ne suis pas choqué, je comprends parfaitement qu’on s’autorise, lorsqu’on signe à tire-larigot, à écrire à peu près la même chose à chacun. Finalement, le plus étonnant est que, dans une agglomération de douze millions d’habitants, je tombe, moi, sur un livre revendu, porteur de ce texte de 1972, presque identique au mien, alors que nous sommes en 2013.
10:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 19 février 2013
Les importuns
Au mois d’août 2012, à Villefranche-du-Périgord (Dordogne), nous entrons, mon épouse et moi, dans une petite boutique de livres d’occasion et de restauration d’ouvrages. Il y a relativement peu de volumes à vendre. Un large regard circulaire puis deux ou trois inspections de haut en bas et j’ai à peu près compris ce que propose le bouquiniste. La phrase rituelle tombe dans mon dos : « Vous cherchez quelque chose de particulier ? ». Martine ne peut se retenir, elle éclate de rire. Cette phrase, elle sait que je ne la supporte pas, je la répète chaque fois que je veux me moquer, et la voici qui nous est servie avec sérieux. Je ne m’agace pas et réponds : « Je regarde, merci ».
Ce n’est pas fini – le libraire, à qui je tourne toujours le dos puisque ce sont les livres que je suis venu voir, non lui, poursuit : « C’est pour vous expliquer le classement ». Il est bien aimable, en vérité ; le classement, toutefois, je suis en train de l’assimiler à grande vitesse. Je suis en train de le lire. Eh oui, un classement se lit, c’est pourtant vrai.
Le bougre, devant mon refus poli réitéré, se tait un instant, puis, n’y tenant plus : « Vous voulez un peu de lumière ? ». Non, je n’en veux pas… Il insiste : « Avec cette chaleur, on n’allume pas ». Soit, soit… Je continue mon exploration des deux modestes parois couvertes de rayonnages. Soudain, la femme du bouquiniste, qui jusque-là se tenait assise devant sa porte, lisant… Télé 7 jours, entre et déclare : « Mon mari vous a expliqué le classement ? »
Toutes ces interruptions se font dans mon dos, elles tombent sur mes reins comme un épuisement. Je sens un chatouillement très désagréable au bas de l’épine dorsale et réponds, toujours amène, pourtant : « Je le découvre, merci ». Ce n’est décidément pas suffisant pour avoir la paix : « Ah, vous le découvrez ? », insiste-t-elle.
Voici une troisième paroi, proposant quelques collections dépareillées : « Vous ne voulez vraiment pas de la lumière ? », demande l’homme, décidément bien bon. Mon déni ne l’empêche pas de poursuivre sur le thème de la chaleur et de l’ombre maintenue. Il conclut : « C’est la moindre des choses que vous puissiez voir ce qu’il y a sur les étagères, quand même ». Certes, mais je ne réponds plus.
On l’aura compris, il n’y a rien à lire dans cette échoppe. On y trouve moins de livres que chez moi et les seuls ouvrages qui seraient ici susceptibles de m’intéresser, je les ai déjà lus depuis quelques décennies. Pour la forme, nous acquérons pour trois euros une anthologie de nouvelles parue autrefois chez France-Loisirs, dans un volume cartonné tout roussi. La merveilleuse trouvaille ! Sans doute avais-je mal compris le classement…
15:09 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
Café au lait
Au bout du compte, où aurais-je pu travailler pour gagner ma vie, sinon à l’Éducation nationale et à la Culture ? Je me le demande. À moins que, a contrario, ces postes, ces domaines m’aient façonné ? Saura-t-on jamais faire la part des choses ? L’écriture, toujours, aura été présente, évidemment : corollaire, il y eut la librairie, le revuisme, la publication. Toutefois, je sais aujourd’hui que je n’aurais pas pu travailler dans l’édition parce que cela ne m’intéresse pas du tout. C’est à force de mieux connaître le milieu qui, certes, ne m’agrée point, mais aussi le fonctionnement et les méthodes de travail, le jargon, l’état d’esprit, bref, ce qu’on nomme aujourd’hui, entièrement à tort, la culture, que j’ai acquis cette certitude, car, autrefois, j’aurais été attiré par ce domaine si, d’aventure, s’était présentée une quelconque occasion. J’aurais été évidemment très déçu, comme je le fus en librairie. Bien entendu, j’aurais préféré ne faire qu’écrire, exclusivement. Cela n’aura pas été possible et, finalement, tout est bien. Je suis en effet dégagé de toute contrainte commerciale, indissociable de la librairie et de l’édition. Je ne suis pas un homme qui vend, ce n’est pas mon métier, ce n’est pas mon domaine, ce n’est pas la corde de mon arc. Je me rappelle cette remarque que me fit, sans malice d’ailleurs, le directeur littéraire d’une maison d’édition parisienne : « Personne ne vit du livre, à part les éditeurs ».
La rédaction est demeurée ce qui me retient le plus. Professionnellement, j’écris des lettres, des notes et rédige des comptes rendus. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est encore ce qui m’ennuie le moins parce que, dès l’instant où il s’agit d’assembler des mots pour en faire des phrases, d’ordonner le tout selon les meilleurs désirs de la grammaire et de la syntaxe, c’est parfait. Rédiger me plaît, même s’il ne s’agit que de travaux administratifs. Je suis un manieur de mots, un plasticien de l’expression. Alors que j’étais assis, au travail de ma mère, devant l’énorme machine à écrire des services postaux d’Alger (c’était le grand immeuble alors moderne dénommé Mauretania, que j’entendais Morétagna sans en comprendre la précise signification), l’aspect définitif que prenaient les mots, dans leur livrée de dactylographie, me fascinait déjà. L’imprimerie, très vite, m’ouvrit des horizons, me permettant de lire café au lait où j’avais toujours compris cafolait. J’avais trois ans, elle fut libératrice, émancipatrice, porteuse d’audace. Ce café au lait fut réellement une très grande découverte, si bien qu’il a effacé les autres primes découvertes d’ordre typographique. « Ah, c’est ça » : ce fut quelque chose de ce genre qui se dit dans ma tête, la première fois que je vis ces mots imprimés. Le café au lait me fit grandir d’un coup, rattachant définitivement à l’enfance première son avatar cafolait qui, sans doute, devait beaucoup à la prononciation familière. Dans le même ordre d’idées, je découvris vite ce que pouvait bien signifier réellement le mot trédugnon qui me faisait penser à grognon, trognon, oignon : je vis un petit trait qui, amicalement, unissait deux mots. Et le rideau s’ouvrit : un trait d’union, mais oui, mais bien sûr… Cet envol de l’esprit – les mots prenaient sens et le langage, ce sourire, devenait un serment d’amour – m’attacha définitivement à la chose imprimée.
14:23 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 15 février 2013
De mon journal de 1998
Avril. En retournant au bureau, j’ai emprunté l’ascenseur avec un couple. La femme était fine, avait l’air intelligent ; surtout, elle avait des yeux sombres et brillants à la fois, absolument adorables. Je l’ai longuement regardée dans les yeux, elle aussi ; nous n’avons pas détourné notre regard (moi si, à la fin, parce que ça devenait indécent, pour son compagnon surtout). Nous avons fait l’amour avec les yeux. Je ne la reverrai sans doute jamais. C’est cela, la vie. C’est très injuste et cependant délicieusement fugace.
15:11 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 14 février 2013
De mon journal de 2009
21 septembre. Dans le hall du cinéma, une jeune femme, très jeune, vêtue de blanc, distribuait des échantillons d’un nouveau parfum. J’ai évidemment oublié le nom d’icelui, étant, comme on le sait, parfaitement étranger à toute manipulation publicitaire, quelle qu’elle soit. Il reste que, comme elle expliquait à Martine que ce parfum se déclinait en trois fragrances et qu’elle en portait elle-même, j’ai dit spontanément : « Vous permettez ? » et me suis penché vers elle. Avec le sourire, elle a dit « oui » et m’a tendu son cou, sans autre forme de procès. Je l’ai donc sentie publiquement et, remarquant que cette odeur était manifestement verte, lui ai dit que cela allait avec ses yeux vert-olive. Elle fut ravie et j’avoue que je ne reviens pas moi-même de cette aisance avec laquelle elle m’a autorisé à sentir son intimité. Cela s’est produit comme nous achetions les billets, à l’avance. Nous sommes ensuite allés au café d’en face et, revenant à l’heure de la séance, j’eus droit à de nouveaux sourires agrémentés d’un : « Je peux vous en donner d’autres, si vous voulez ». Elle parlait d’échantillons, naturellement. À l’issue du film, comme nous sortions, elle m’en mit encore un dans les mains. Quelle curieuse fille ! Ou bien alors mon charme est-il incommensurable… et à même de durer plusieurs heures.
11:08 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 06 février 2013
Un article actuellement particulier
Parmi les tics qui rendent hirsute le langage de nos contemporains et me donnent des boutons dans les oreilles, « dispositif » remplaçant « dispositions », « expertise » ayant pris la place d’« expérience », et autres cochonneries, scories d’un vocabulaire déjà pauvre, « particulier » tient, depuis bien trop de temps maintenant, une place importante.
Désormais, tout est particulier, singulièrement lorsque l’on n’a rien à dire. Une personne demeurant muette devant une œuvre, un document, une situation, dira, après un temps de réflexion : « C’est très particulier », ce qui, à proprement parler, ne signifie absolument rien.
Cet adjectif représente de nos jours le nec plus ultra du néant. Dire de quoi que ce soit que c’est particulier n’a pas de sens. Le langage du vide devient de plus en plus insupportable. Sur le site de la Cinémathèque française, une rétrospective de Guédiguian est ainsi présentée : « Avec ses dix-sept films réalisés à ce jour, Robert Guédiguian, révélé par le succès de Marius et Jeannette en 1997, est l’auteur d’une œuvre à la fois personnelle mais aussi particulière dans le cinéma français ». Avec ça, on est renseigné. Quelques lignes plus loin, l’excellent chroniqueur rempile : « Bref, c’est un endroit particulier où se vivent des choses universelles ». Impossible de s’exprimer d’une manière plus générale, donc plus vide, plus répétitive, donc plus idiote.
L’adverbe « actuellement » se tient bien, lui aussi. « Untel vit actuellement à tel endroit ». Certes. Pourquoi donc nous renseignerait-on sur l’adresse qui était celle d’Untel il y a dix ans ? « Où habitez-vous, actuellement ? », me demanda un jour un policier. C’était il y a de nombreuses années, et l’adverbe automatique sévissait déjà. « Il est en réunion actuellement ». Diantre, dire : « Il est en réunion » n’aurait sans doute pas suffi. Le mot maudit ne décote pas.
Les tics de langage m’ont toujours insupporté, mais ceux-là me mettent littéralement hors de moi. Je ne comprends pas qu’on puisse se laisser aller au parler commun sans recul, sans réflexion, sans distance, qu’on puisse aller répétant ce que tout le monde dit, sans ironie, sans désir d’autres chemins. Le panurgisme est haïssable.
11:28 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (4)
jeudi, 31 janvier 2013
Les deux Thérèse

Le chef d’œuvre de Mauriac, Thérèse Desqueyroux, adapté par Franju en 1962, avec des éclairages somptueux, un montage irréprochable et des plans très intéressants – voilà la supériorité définitive du noir et blanc sur la couleur.
La distribution est impeccable de bout en bout : Emmanuelle Riva, Philippe Noiret, Sami Frey, Édith Scob… La direction d’acteurs est parfaite.
L’adaptation a reçu le concours de Mauriac lui-même, assisté de son fils Claude, et c’est également Mauriac qui a écrit les dialogues, ainsi que le monologue intérieur de son héroïne.

Autant dire qu’on touche à la perfection et que le remake de Claude Miller, sorti en 2012, ne présente aucun caractère d’indispensabilité. D’autant moins que Miller a choisi la narration chronologique la plus bête quand le roman – et Franju avait conservé cela – s’ouvre sur Thérèse sortant du palais de justice en ayant bénéficié d’un non-lieu. Il ne faut pas se tromper de choix narratif car ici, le retour arrière a un sens authentique. On revient d’ailleurs au présent de l’action, à partir de l’arrivée de Thérèse chez elle. Miller a fait une erreur et je crois que c’est cela qui m’empêche d’aller voir son film, outre le fait que le réalisateur paraît, si j’en crois les images et la bande-annonce, être tombé dans tous les pièges de la reconstitution léchée et pourléchée. Cette reconstitution pour laquelle je choisis toujours un critère un peu sot, certes, mais irréfutable : les voitures. Dans la quasi-totalité des cas, les voitures, louées fort cher à des collectionneurs pointilleux, sont toujours rutilantes. Il n’y avait pas de voitures sales ou cabossées, du temps de Thérèse ? Jamais ? Au moins, chez Franju, la 403 de la famille (il a transposé l’action en 1962, au temps présent des spectateurs d’alors), après avoir roulé dans des chemins de campagne par temps de pluie, est sale. Ça n’a l’air de rien, mais cela évite de donner à l’image l’aspect d’un catalogue de constructeur automobile ou celui d’un journal de mode.

11:40 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 29 janvier 2013
Quand ils ne meurent pas, les aventuriers vieillissent mal
Je ne sais plus si j’avais vu Les Aventuriers lors de sa sortie, en 1967, mais je me rappelle avoir pris un grand plaisir à le regarder, il y a plusieurs années, à la vidéothèque des Halles. Je l’ai revu hier soir à la télévision. Je n’ai pas ressenti la même chose.
Les artifices techniques, aujourd’hui, sautent aux yeux. La descente en rase-mottes des Champs-Élysées par Delon pilote de monoplace est sans appel : on ne voit que la transparence, trucage alors habituel. La foule qui proteste sur l’aérodrome africain, que l’on découvre en retour arrière, narrée par Reggiani, cette foule mécontente que doivent contenir des militaires, demeure ce qu’elle est : des figurants obéissant scrupuleusement aux consignes et réagissant au signal. La vision censée être celle de Delon et Ventura, qui, tout en marchant, observent l’intérieur d’un atelier où travaillent des ouvrières, ne laisse voir aujourd’hui qu’un travelling sur rails, trop « lisse » qu’elle se trouve être, cette vision, et pas assez « heurtée » pour être celle de deux hommes qui se déplacent. La technique est vraiment ce qui, dans un film, vieillit le plus vite et, hélas, le plus mal.
L’histoire est toujours sympathique : deux aventuriers généreux comme il n’est pas permis, gamins grandis qui s’amusent à vivre leurs rêves et qui, seuls avec une femme dans un bateau pas très grand, ne la touchent pas, ne tentent rien, se comportent en amoureux transis ; deux aventuriers qui distribuent la part du trésor, revenant à la fille décédée, à son cousin, un gamin fils d’épiciers aux sentiments minables, seule famille de la disparue qu’ils se sont donnés un mal fou à retrouver. Bref, des aventuriers extrêmement improbables, comme on ne disait pas alors, mais attachants. À la fin, un beau combat dans un fort désaffecté, sur une île, où les héros se battent avec des armes abandonnées là, autrefois, par les nazis, Delon tué et Ventura qui descend les assassins à coups de grenades allemandes, ces grenades qu’on appelait des « tampons à soupe ». Ça a « de la gueule », comme on dit, mais sur un écran de télévision, ça ne donne pas grand-chose. Une belle histoire, donc – une esthétique de bande dessinée, une interprétation, faut-il le dire, impeccable – mais l’histoire étant ce qui m’intéresse le moins dans un film, je n’ai pas retrouvé la joie ressentie lors de la première vision.

10:01 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
jeudi, 24 janvier 2013
Il y aura autre chose
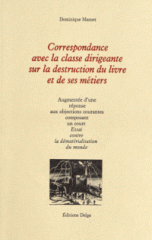 Je lis le bref libelle de Dominique Mazuet, libraire à Paris, qui s’élève contre le livre numérique et contre les ventes en ligne d’ouvrages. Il a voulu lui donner un titre de forme classique, Correspondance avec la classe dirigeante sur la destruction du livre et de ses métiers, augmentée d'une réponse aux objections courantes composant un court Essai contre la dématérialisation du monde. Bien que beaucoup de choses soient proches de moi dans ce petit ouvrage qui se veut pamphlétaire (mais ne l’est guère, Mazuet écrivant vraiment très mal et très lourdement), je pense que son auteur se trompe du tout au tout. Il y a de la place pour tout le monde.
Je lis le bref libelle de Dominique Mazuet, libraire à Paris, qui s’élève contre le livre numérique et contre les ventes en ligne d’ouvrages. Il a voulu lui donner un titre de forme classique, Correspondance avec la classe dirigeante sur la destruction du livre et de ses métiers, augmentée d'une réponse aux objections courantes composant un court Essai contre la dématérialisation du monde. Bien que beaucoup de choses soient proches de moi dans ce petit ouvrage qui se veut pamphlétaire (mais ne l’est guère, Mazuet écrivant vraiment très mal et très lourdement), je pense que son auteur se trompe du tout au tout. Il y a de la place pour tout le monde.
On sait ici l’intérêt que je porte au papier imprimé. J’ai été employé de librairie, documentaliste, bibliothécaire, revuiste, archiviste, je suis auteur et, évidemment, lecteur. Je suis extrêmement attaché au livre.
Sont arrivées les tablettes, les liseuses et, comme chaque fois qu’une nouveauté apparaît, on s’étripe. Les partisans du livre en appellent à six siècles d’imprimerie, les autres avancent que le lire est plus important que le livre – ce qui non seulement n’est pas idiot mais est bien formulé, il faut le reconnaître. Le lecteur tranchera, comme toujours, et lui seul.
Je ne crois pas que disparaîtront les libraires, pas plus que le livre, qui n’a été tué ni par la radio, ni par le disque, ni par la télévision, ni par la cassette audiographique, ni par la cassette stéréo-8, ni par la cassette vidéographique, ni par le disque compact, ni par le vidéodisque, ni par le DVD, ni par Internet, ni par le mp3, ni par... Pourquoi serait-il mis à bas aujourd’hui, alors que la liseuse est tout de même ce qui se rapproche le plus possible de lui ?
Je lisais Mazuet ce matin dans le métro quand, levant les yeux, j’aperçus devant moi un homme jeune, porteur d’une liseuse. C’était amusant. J’ai jeté un œil : il s’agissait d’un roman policier. Au passage, je signale que l'ouvrage du libraire protestataire est en vente en ligne, y compris chez son ennemi déclaré Amazon, ce qui constitue un insolent pied-de-nez.
Amis libraires, organisez-vous et faites-vous une place nouvelle tandis que le livre numérique trouve la sienne sans vous demander votre avis. S’il faut vous rassurer contre je ne sais quelle peur, dites-vous que le numérique lui-même sera détrôné un jour. Pourquoi le mouvement cesserait-il ? Après le livre numérique, il y aura autre chose, évidemment. Quoi ? La vie.
15:39 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 21 janvier 2013
Qu’on me décharge de Témoin à charge
 Je n’avais jamais vu jouer Marlène Dietrich. Je reconnais qu’à soixante ans et quelques malencontreuses poussières, ce n’est pas très flatteur. Au vrai, en y réfléchissant, j’ai vu, si l’on peut dire, L’Ange bleu lorsque j’étais petit, dans les années 50. Mon père mettait sa main sur mes yeux, chaque fois qu’il estimait, certainement à raison, que la scène à l’écran n’était pas indiquée pour un enfant. Autant dire qu’il ne me reste rien de L’Ange bleu.
Je n’avais jamais vu jouer Marlène Dietrich. Je reconnais qu’à soixante ans et quelques malencontreuses poussières, ce n’est pas très flatteur. Au vrai, en y réfléchissant, j’ai vu, si l’on peut dire, L’Ange bleu lorsque j’étais petit, dans les années 50. Mon père mettait sa main sur mes yeux, chaque fois qu’il estimait, certainement à raison, que la scène à l’écran n’était pas indiquée pour un enfant. Autant dire qu’il ne me reste rien de L’Ange bleu.
J’ai regardé l’autre soir, à la télévision, Témoin à charge, film de 1957, sans intérêt. Les rebondissements d’une intrigue molle, adaptée de la pénible Agatha Christie, sont classiques. Le final à double ou triple détente est un procédé trop connu pour ajouter quelque chose à ce film considérablement vieilli et très impersonnel, sentant le studio à deux kilomètres. Aucun effet de montage, de filmage, aucun coup de caméra, aucune beauté plastique.
Il ne peut être sauvé de cela que l’interprétation impeccable de tous les acteurs et, bien évidemment, celle de Marlène Dietrich elle-même, magnifique, excellente. Pour le reste, quel ennui.
16:41 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 16 janvier 2013
Pia est un fleuve sans fin
 En 2013, mis en appétit, j’ai écrit aux éditions du Lérot pour leur demander s’ils envisageaient de procéder à la publication en volume des articles de Pascal Pia parus dans La Quinzaine littéraire et le Magazine littéraire. Il m’a été répondu que cela n’était pas prévu à cause de problèmes de droits, mais que, toutefois, il demeurait encore « un important ensemble d’articles inédits en volume et toujours parus dans Carrefour », ce qui m’a laissé sans voix. L’histoire, par conséquent, se poursuivra.
En 2013, mis en appétit, j’ai écrit aux éditions du Lérot pour leur demander s’ils envisageaient de procéder à la publication en volume des articles de Pascal Pia parus dans La Quinzaine littéraire et le Magazine littéraire. Il m’a été répondu que cela n’était pas prévu à cause de problèmes de droits, mais que, toutefois, il demeurait encore « un important ensemble d’articles inédits en volume et toujours parus dans Carrefour », ce qui m’a laissé sans voix. L’histoire, par conséquent, se poursuivra.
16:15 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
Un faux Baudelaire
 Je possède un exemplaire du pastiche de Baudelaire, À une courtisane, que Pascal Pia publia et préfaça en 1925, avec les huit eaux fortes originales de Pierre Creixams. Il est relié cuir bleu-nuit et papier, titres dorés, les couvertures conservées. Lorsque mon ancien beau-père, qui l’avait acquis en 1976, me l’offrit en 1979, je ne pense pas qu’il savait de quoi il s’agissait. Moi-même, en tout cas, ignorant tout de ce faux, que Gallimard avait admis dans le premier Baudelaire de la collection « La Pléiade », j’étais allé vérifier, dans Les Fleurs du mal : le texte n’y figurait pas, évidemment, et j’avais imaginé qu’il s’agissait vraiment d’une œuvre libre, comme on disait autrefois, parfaitement indépendante du recueil sublime que des imbéciles condamnèrent en 1857. Lorsque, en 2012, j’ai commencé à m’intéresser de près aux travaux de Pia – au vrai, j’avais lu, quelque vingt ans plus tôt, son Apollinaire, comme j’avais apprécié les souvenirs de Nadeau à son sujet –, j’ai connu cette histoire, j’ai brusquement réalisé que je possédais ce texte depuis longtemps. Le cuir du dos a été partiellement usé par le temps : il est comme rongé par endroits, alors que j’ai reçu l’exemplaire en très bon état et que je ne l’ai jamais abîmé moi-même.
Je possède un exemplaire du pastiche de Baudelaire, À une courtisane, que Pascal Pia publia et préfaça en 1925, avec les huit eaux fortes originales de Pierre Creixams. Il est relié cuir bleu-nuit et papier, titres dorés, les couvertures conservées. Lorsque mon ancien beau-père, qui l’avait acquis en 1976, me l’offrit en 1979, je ne pense pas qu’il savait de quoi il s’agissait. Moi-même, en tout cas, ignorant tout de ce faux, que Gallimard avait admis dans le premier Baudelaire de la collection « La Pléiade », j’étais allé vérifier, dans Les Fleurs du mal : le texte n’y figurait pas, évidemment, et j’avais imaginé qu’il s’agissait vraiment d’une œuvre libre, comme on disait autrefois, parfaitement indépendante du recueil sublime que des imbéciles condamnèrent en 1857. Lorsque, en 2012, j’ai commencé à m’intéresser de près aux travaux de Pia – au vrai, j’avais lu, quelque vingt ans plus tôt, son Apollinaire, comme j’avais apprécié les souvenirs de Nadeau à son sujet –, j’ai connu cette histoire, j’ai brusquement réalisé que je possédais ce texte depuis longtemps. Le cuir du dos a été partiellement usé par le temps : il est comme rongé par endroits, alors que j’ai reçu l’exemplaire en très bon état et que je ne l’ai jamais abîmé moi-même.
Je suis ahuri de constater, au lu des notices présentes sur Internet, que certains libraires d’anciens proposent aujourd’hui encore ce livre comme un inédit de Baudelaire. Pas tous, certes, mais cela arrive. Lorsque Pia commit ce faux, il était âgé de vingt-deux ans à peine. Dans son introduction qu’avec culot il intitula Notes en marge d'un poème, il avançait que le poème s’était retrouvé chez un viticulteur de l’Hérault, où il avait pu en prendre copie.
Un des exemplaires en vente à l’heure où j’écris, le n° 257, porte cette dédicace admirable de Pia : « À Robert Chatté, son ami Charles Baudelaire – ou plus modestement P. P. ». Robert Chatté, libraire à Montmartre, était spécialisé dans les livres érotiques. Il avait une clientèle d’initiés et demandait, pour leur ouvrir, qu’ils fissent un signal précis. Il fut l’éditeur de Bataille, en 1941. Chatté donna plus tard le volume à M. A. Drouet, et se fendit à l’occasion de cet excellent ex-dono : « Toujours de la part de Baudelaire, empêché. R. C. ». Ironique et superbe, Pia se permettra plus tard d’écrire, dans sa somme bibliographique Les Livres de l’enfer : « Quoique ce pastiche de Baudelaire (...) ne soit pas des plus réussis, quelques exégètes du poète des Fleurs du mal l’ont pris au sérieux. Nous n’aurons pas la cruauté de les nommer ».
10:46 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 15 janvier 2013
L'Apollinaire de Pia
De l’Apollinaire de Pia, un des livres les plus attachants qu’il m’ait été donné de lire, il peut être dit la même chose que de son Baudelaire. Paru en 1954, il connut aussi de multiples présentations, avec cet avatar : un passage dans la collection « Points », puis il sombra en même temps que le Seuil. Aujourd’hui encore, des exemplaires en très grand nombre sont disponibles partout. Il se dit cependant que Mme Apollinaire, « la jolie rousse » comme la nommait le poète, se montra irritée par ce livre. Elle l’écrivit, aux alentours de sa parution, dans des lettres adressées à Bernard Poissonnier. Cette correspondance est passée en vente en 2006, mais, ne l’ayant jamais lue, j’ignore les raisons du courroux de Jacqueline Kolb, épouse Apollinaire.

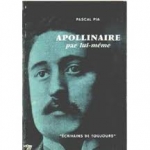
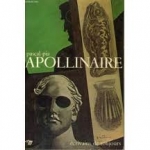
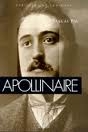
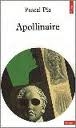
14:01 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
Le Baudelaire de Pia
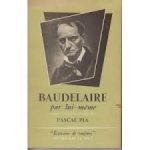 Le Baudelaire de Pascal Pia a le même âge que moi. Tous deux, nous avons été publiés en 1952. Il est vraiment remarquable qu’une monographie soit considérée, après plusieurs décennies, comme toujours recevable : seule la bibliographie fut, au cours des nombreuses réimpressions, remise à jour. Ce livre serait certainement encore réimprimé si le Seuil existait toujours, autrement que comme une simple marque commerciale du groupe la Martinière. On trouve toujours, d’occasion, des exemplaires nombreux, dans les présentations successives que connut l’ouvrage.
Le Baudelaire de Pascal Pia a le même âge que moi. Tous deux, nous avons été publiés en 1952. Il est vraiment remarquable qu’une monographie soit considérée, après plusieurs décennies, comme toujours recevable : seule la bibliographie fut, au cours des nombreuses réimpressions, remise à jour. Ce livre serait certainement encore réimprimé si le Seuil existait toujours, autrement que comme une simple marque commerciale du groupe la Martinière. On trouve toujours, d’occasion, des exemplaires nombreux, dans les présentations successives que connut l’ouvrage.
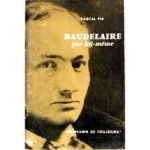 C’est certainement que Pia, fidèle en cela à l’esprit de la collection, traite Baudelaire « par lui-même », ainsi que le recommandait le sous-titre. C’est en effet dans son œuvre qu’il va chercher le poète et, s’il ne s’interdit pas l’allusion biographique, il se garde bien de tout biographisme (le mot, au vrai, n’existait pas alors).
C’est certainement que Pia, fidèle en cela à l’esprit de la collection, traite Baudelaire « par lui-même », ainsi que le recommandait le sous-titre. C’est en effet dans son œuvre qu’il va chercher le poète et, s’il ne s’interdit pas l’allusion biographique, il se garde bien de tout biographisme (le mot, au vrai, n’existait pas alors). Bien entendu, toute lecture de Pia donne l’occasion d’une moisson de mots peu usités et savoureux : vulgivague, par exemple.
Bien entendu, toute lecture de Pia donne l’occasion d’une moisson de mots peu usités et savoureux : vulgivague, par exemple.

10:01 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 14 janvier 2013
Mariage homosexuel, une fois de plus
Ainsi donc, ce que la France, pays des Lumières et des Droits de l’Homme, compte de plus ringard, de plus passéiste, de plus médiéval, de plus obscurantiste, a défilé hier contre le mariage homosexuel, déjà instauré dans de nombreux pays dont la très catholique Espagne, pays qui, tous, ont survécu à ce que l’on nous présente comme une apocalypse qui ne serait pas de Saint-Jean.
Naturellement, toutes ces forces du passé et de l’ordre moral se défendent de toute accusation d’homophobie (comme ça y ressemble, cependant) et prétendent défendre (contre qui ?) les valeurs traditionnelles de la France (lesquelles, vraiment ?) et de la famille, alors que la famille « classique » n’est nullement menacée et qu’il s’agit uniquement de faire vivre légalement, à ses côtés, de nouvelles familles, lesquelles existent déjà, d’ailleurs. Il n’est question que de leur conférer un cadre légal.
L’archevêque de Paris a fait savoir qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation de l’Église contre le gouvernement (comme ça y ressemble, cependant). Il n'empêche que l’Église, totalement manipulée par l’UMP, n’a pas craint de marcher main dans la main avec le Front national. L’hypocrisie des cortèges et des points de départ différents ne saurait tromper personne, le lieu d’arrivée étant le même et les buts identiques.
Les chrétiens de gauche, étrangement étouffés depuis quelques semaines, hormis une prise de position parue dans Témoignage chrétien, souffrent d’être assimilés au troupeau bêlant et à la crétinerie avancée dont témoignent leurs frères en Christ qui, après avoir chanté l’amour, la charité, l’égalité de tous dans le cœur de Dieu, sont allés, à la sortie de la grand-messe dominicale, manifester.
Le nombre de participants, si l’on établit une cote mal taillée entre les chiffres avancés par les organisateurs et ceux délivrés par la préfecture de police, doit se situer aux alentours de cinq à six cent mille, ce qui est fort peu pour un soi-disant enjeu vital, historique, séculaire.
J’espère de tout mon cœur que le gouvernement ne se dégonflera pas et que, d’ici quelques semaines, cette loi sera adoptée et s’imposera à la République. Dans peu d’années, on se demandera comment on a pu seulement en parler, tant le mariage dit « pour tous » sera entré dans les mœurs, tant les enfants élevés par deux hommes ou par deux femmes seront intégrés dans la société. Faut-il encore, en 2013, l’assurer : les homosexuels doivent jouir des mêmes droits que l’ensemble de la population, ou bien alors, qu’on les dispense d’avoir les mêmes devoirs et, pour commencer, de payer l’impôt sur le revenu, par exemple.
D’ores et déjà, nos amis des pays du Nord se penchent à leur balcon septentrional et soulignent d’un rictus amusé le sentiment de désuétude que leur inspire notre vieux, indécrottable pays latin.
10:12 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (4)
mercredi, 09 janvier 2013
Petit volatile et petit baiser
Comme je l’ai dit, j’ai découvert chez Pascal Pia des mots goûteux, savoureux, piquants, imprévus, peu usités : cant, petite-oie, pataphar, oaristys… J’ajoute, pour le plaisir, puffiste, sotadique et l’extraordinaire chastie-musart. Évidemment, on n’emploie pas ce vocabulaire à la télévision, mais tout le monde ne parle pas TF 1.
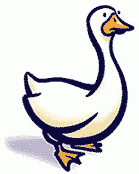
Toutefois, c’est petite-oie qui me séduit le plus. Consulté, mon vieil ami Littré, venu déjeuner avec moi, m’a informé qu’il s’agissait des petits morceaux de l’oie (le cou, les pattes) que l’on découpait avant de préparer la bête elle-même. Connaissant sa malice, je lui ai demandé s’il n’existait pas un sens plus familier. Le cher Émile m’avoua donc que, d’une dame ne concédant à son amant qu’un simple baiser, sans daigner poursuivre, on disait qu’elle ne lui accordait que la petite-oie.
Charmant, tout de même, n’est-ce pas ?
12:11 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 07 janvier 2013
Lecture immense
Je poursuis la lecture de Pascal Pia. Chez lui, j’ai appris de nombreux mots : cant, petite-oie, pataphar, oaristys… Je regrette de ne pas les avoir tous notés, c’est une erreur. On ne peut pas, cependant, lire trois mille pages en gardant en permanence un crayon à la main.
J’ai entrepris cette traversée des chroniques littéraires parues dans Carrefour au printemps dernier et, si je ne suis toujours pas parvenu au bout du voyage, j’ai tout de même lu, dans l’intervalle, quatre autres ouvrages (de deux auteurs d’ailleurs découverts grâce à Pia et d’un autre, qui n’a rien à voir) et, dans le même temps, d’autres livres de Pia : sa correspondance avec Camus, puis celle qu’il échangea avec Hellens.
Lecture immense, océanique, que ces articles hebdomadaires répartis sur près d’un quart de siècle.
12:22 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 01 janvier 2013
Un sujet éculé
 Alain Corneau nous a offert, avec Crime d’amour que je viens de voir, bien tardivement, mais cela n’a pas empêché la terre de tourner, un mélange de son cru. Une histoire dans la veine de Police Python 357 et de La Menace, ses excellents premiers films, mais il a travaillé cette fois dans une écriture proche de l’adaptation qu’il avait faite de Stupeur et tremblements, dont j’ai parlé précédemment. On entend d’ailleurs, au cours du film, un petit air dans la manière japonaise.
Alain Corneau nous a offert, avec Crime d’amour que je viens de voir, bien tardivement, mais cela n’a pas empêché la terre de tourner, un mélange de son cru. Une histoire dans la veine de Police Python 357 et de La Menace, ses excellents premiers films, mais il a travaillé cette fois dans une écriture proche de l’adaptation qu’il avait faite de Stupeur et tremblements, dont j’ai parlé précédemment. On entend d’ailleurs, au cours du film, un petit air dans la manière japonaise.
La direction d’acteurs est presque inexistante et il ne suffit pas d’avoir recours à des décors systématiquement glacés pour que la glace du propos prenne suffisamment et que le spectateur s’en trouve refroidi. Tous les intendants le disent : on n’abuse pas des surgelés.
Le sujet est éculé (La Tourneuse de pages de Denis Dercourt, film que j’ai aussi évoqué, ressemble à celui-ci par bien des côtés, ainsi que, d’une certaine manière, l’angoissant Jeune fille partagerait appartement) et cela se sent dès la première scène : une femme, Isabelle, vampirisée par une autre, Christine, laquelle fait finalement les frais de la vengeance de celle qu’elle a détruite, moquée et publiquement humiliée, lorsque Isabelle s’avère finalement plus forte qu’elle. On ne sait même pas ce que veut vraiment l’affreuse Christine, qui possède déjà tout. Plus que tout ? C’est une des faiblesses du récit.
Pas une once de critique sociale, ici, quand le sujet l’appellerait, au moins en passant. Cette entreprise qui nous est montrée est un prétexte et, comme il faut bien que, de loin en loin, soit évoquée son activité, on en fait une multinationale de l’agroalimentaire, qui fabrique de la mal-bouffe en gagnant énormément d’argent, mais chut, cela ne doit pas se dire expressément. Le policier ressemble à un droguiste ou à un patron de bar et, logiquement, il devrait, tout en faisant son travail, se défier considérablement de ce monde qui n’est pas le sien, opposant son salaire de fonctionnaire à cette Christine achetant sans l’avoir vu un immense appartement à New York. Rien de cela. Le juge d’instruction n’est pas sûr de lui, il est fort mal campé. Les métiers, dans ce film, n’existent pas, ils sont faux, théoriques. Ils sont dits. On nous dit que ce juge est un juge, mais rien ne le montre ni ne le prouve.
J’attendais l’inévitable double détente, celle sans laquelle le film, aux effets téléphonés et aux surprises fort affadies (il est évident, dès qu’ils apparaissent, que les médicaments d’Isabelle sont des placebos), n’eût même pas pu être regardé. Elle survient à quelques brefs instants de la fin ; elle est, il est vrai, relativement inattendue, et plaisante. Cependant, elle ne suffit pas, c’est regrettable, à sauver l’ensemble de l’œuvre.
Il s’agit du dernier film de Corneau et c’est dommage pour lui. Décidément, le pauvre aura bien mal vieilli sur le plan de ses facultés créatrices. Conservons de lui Police Python 357, La Menace et Le Choix des armes. Ce sera bien suffisant (même le célèbre Série Noire est mauvais). Crime d’amour ne laissera pas un souvenir inoubliable.
17:49 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 21 décembre 2012
Une fable prémonitoire
 J’avais vu ce film en 1973, lors de sa sortie. Il avait à l’époque causé une très vive émotion. On recommandait à ses amis d’y assister et j’avais fait de même envers mes parents. Tout le monde en parlait, bouleversé.
J’avais vu ce film en 1973, lors de sa sortie. Il avait à l’époque causé une très vive émotion. On recommandait à ses amis d’y assister et j’avais fait de même envers mes parents. Tout le monde en parlait, bouleversé.
Je l’ai revu hier soir, pour la première fois. La chaîne Arte, qui le proposait, a cette déplorable manie de nous infliger des versions françaises au motif qu’il s’agit d’une heure de grande écoute, et c’est insupportable : ces voix fausses, au débit modifié pour « coller » le plus possible au mouvement des lèvres d’acteurs américains, voix qu’on a déjà entendues, sortant de la bouche d’autres comédiens, parce que les doubleurs sont les mêmes. Bref, c’est hideux, quand une version en anglais avec sous-titres eût été mille fois préférable.
Que reste-t-il de ce film ? Techniquement, pas grand-chose. Quand il nous en avait mis plein la vue, on n’aperçoit aujourd’hui que des foules de figurants extrêmement mal dirigées, des studios qui sentent le studio, des bagarres mal chorégraphiées et l’on n’entend que des bruitages ratés. Aucun effet de montage, aucun coup de caméra original, un filmage sans style, une direction d’acteurs inexistante.
Et pourtant… La surpopulation, la pollution, l’absence de nourriture, la raréfaction de l’eau, l’élévation des températures, les émeutes urbaines, les vieux qu’on estime inutiles, la corruption, les toujours plus riches et les toujours plus pauvres, les gens sans logement qui vivent dans leur voiture immobilisée ou dorment dans des escaliers, ça ne vous rappelle rien ?
Certes, il n’y a pas encore de « dégageuses » pour réduire les manifestants et les femmes ne font pas partie des logements mis en vente ; on ne les appelle pas « mobilier » (furniture). Quoique…
Soleil vert ? On y est.
10:39 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 17 décembre 2012
Au zinc
Au Départ Saint-Michel, grignotant au comptoir mon sempiternel sandwich, j’observe les allées et venues des serveurs, le travail des cuisiniers, celui du caissier. C’est un café où le nombre de consignes écrites est effarant. La moindre boîte de plastique est étiquetée, le plus petit dossier aussi. Cela, je ne peux pas ne pas le remarquer : ce qui est écrit m’aveugle toujours. Au passage, sur une boîte contenant des biscuits salés destinés, je suppose, à accompagner l’apéritif, je relève : « Six bretzels, une personne. Deux personnes, dix bretzels », décompte qui me paraît singulièrement mesquin. Près du robinet, je lis : « Consommer l’eau avec modération » ; ce n’est pas une plaisanterie, mais un rappel à l’économie. Surtout, sur un banc de service, à peu près à hauteur d’yeux, je déchiffre, de loin, l’inscription que voici, dont je rétablis l’orthographe fort défaillante : « L’élocution est forcément prononcée avec parcimonie et gentillesse envers le barman et les officiers ; le personnel de salle n’est pas un supérieur dans la voie hiérarchique ». En résumé, et en bel et bon langage françois, les garçons doivent s’adresser courtoisement à l’employé du bar comme aux cuisiniers, instruction qui me semble juste et bienvenue. Je pense alors à cette phrase de Montherlant, qui écrivait (je cite malheureusement de mémoire) : « Le garçon qui lance à l’adresse du barman : “Un café, un !”, est heureux parce qu’il commande ». Montherlant habitait quai Voltaire, fût-il venu manger un sandwich au zinc du Départ Saint-Michel, il eût appris quelque chose et, par surcroît, nous eussions conversé.
14:36 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 13 décembre 2012
Errements typographiques
Comme c’est étrange. Depuis plusieurs années, je peste, râle et fulmine contre les livres que l’on publie aujourd’hui, qui ne sont pas corrigés. Coquilles, bien sûr, mais aussi erreurs, redondances, anacoluthes, bref, quelque chose de typographiquement et grammaticalement désastreux. Je regrette que les maisons d’édition aient fait disparaître le poste de correcteur, depuis que la micro-informatique a – dit-on – rendu désuet cet emploi, pourtant hautement spécialisé. Désormais, le directeur littéraire ou l’un de ses collaborateurs corrige, fort mal en général, en deux coups de traitement de texte. Comme si le progrès technique, évidemment indéniable, pouvait dispenser du savoir-faire et de la connaissance des règles en usage dans ce domaine.
Naturellement, j’ai tendance à dire que c’était mieux avant, tendance ô combien humaine, à laquelle personne n’échappe, travers dans lequel chacun tombe un jour ou l’autre. Je repense à Bernard Dee, qui corrigea chez Laffont mon premier ouvrage publié. Un champion de la langue française, de la grammaire, de la syntaxe, mais aussi de la disposition graphique, de la distribution d’une page, de la conception esthétique d’une couverture où la titraille doit trouver sa place sans nuire à l’illustration, depuis longtemps devenue obligatoire.
C’était mieux avant ? Voire… En effet, Pascal Pia écrivait dans Carrefour, en 1959 : « Dommage qu’une édition établie avec autant de soin ait été imprimée sans que les épreuves en fussent corrigées. Les éditeurs font appel, de nos jours, à des “maquettistes” qui ne seraient pas toujours indispensables, et qui souvent résolvent assez mal de petits problèmes typographiques devant lesquels un prote n’eût pas éprouvé le moindre embarras. Mieux vaudrait ne pas disputer ces étalagistes aux grands magasins et s’assurer le concours d’un correcteur consciencieux, fidèle aux principes de Théotiste Lefèvre ».
Il faut croire que certains errements sont décidément plus anciens que je ne le croyais. Ou bien alors, que dirait aujourd’hui Pia, devant les calamités que concoctent les éditeurs avec le traître appui de la presse Cameron ?
Pour qui l’ignorerait, Théotiste Lefèvre est l’auteur d’une Nouvelle classification de la casse française, combinée d’après l’exact emploi des lettres (1832), d’un Recueil complet d’impositions, exécutées en caractères mobiles (1848), d’un Guide pratique du compositeur d’imprimerie (1855), et de quelques autres publications techniques comme l’Instruction pour diviser les mots à la fin des lignes, à l’usage des sourdes-muettes qui se destinent à la composition typographique.
15:56 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 12 décembre 2012
Mariage homosexuel, toujours
J’ai évoqué ici le mariage homosexuel, en un temps où il ne s’appelait pas encore « mariage pour tous ». Plus que jamais, puisqu’il semble qu’enfin, on approche du but, il convient de défendre le droit au mariage pour les homosexuels qui le désirent. On y arrive, on y vient. Une pétition est présentée à votre paraphe par le Parti socialiste. On sait que, depuis 1983-1984 environ, je n’aime plus beaucoup les socialistes, mais cela n’empêche pas de signer.
14:27 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 06 décembre 2012
Trois fois vingt ans
Il y a donc aujourd’hui soixante ans que ce monde me fait l’honneur de m’héberger et qu’il a le bon goût de ne pas exiger de moi le paiement d’un loyer. Encore qu’il me soit arrivé plus d’une fois de devoir régler en nature.
16:17 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)


