jeudi, 22 novembre 2012
Un Janus jauni

Ainsi donc, l’UMP se donne le ridicule public d’étaler ses dissensions, jalousies et rivalités. À son aise. Tant que se mangeront entre eux ces loups grotesques, on ne regrettera pas ce gaspillage de barbaque avariée. Car au vrai, qui imagine encore qu’il puisse exister, entre Copé et Fillon, la moindre différence authentique ? Ces deux hommes représentent les deux faces d’un Janus jauni dont nous ne voulons pas, les deux aspects des mêmes intérêts, qui ne sont pas les nôtres. L’un joue les provocateurs populistes et tente de séduire sur sa dextre par des sornettes et des vulgarités. L’autre se pose en bon élève sérieux, « gendre idéal » quoique un peu décrépit. La peste soit de ces gens comme de ceux qui les entourent, et que leur égo les étouffe.
Zundapp Janus, modèle 1958
16:17 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 20 novembre 2012
Pascal Pia tel qu’on l’habille
Cette note complète et développe celle publiée ici-même, le 24 avril 2012, sous le titre Pia s’habille chez le Lérot. Elle traite, du point de vue de la conception éditoriale, de l’ensemble des articles publiés par l’excellent chroniqueur littéraire dans l’hebdomadaire Carrefour.
Pascal Pia est certainement le plus grand critique littéraire de son temps, en tout cas celui dont les articles sont, aujourd’hui encore, les plus goûteux. Écrivant cela, je n’apprendrai rien à personne, et certainement pas à ceux qui ont lu, par exemple, son Apollinaire, qui fait toujours autorité.
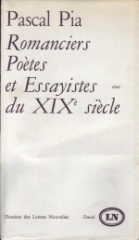

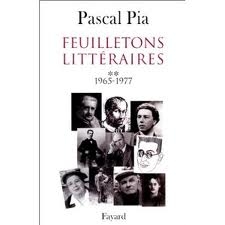 Deux nouveaux tomes ont en effet paru, longtemps plus tard, en 1999 et 2000, chez Fayard, avec l’aide du Centre national du Livre (CNL). Cette fois, on constate avec plaisir que l’édition est correcte : ordre chronologique de parution initiale des feuilletons, claire indication de la livraison d’origine. Et puis, voici une surprise : si l’on trouve ici des articles consacrés à des auteurs du XIXe siècle parus après 1971 et n’ayant donc pu être compilés dans l’édition précédente, on en lit aussi, qui eussent dû logiquement en faire partie et ont été oubliés, ou non retenus. Les deux préfaces sont de l’inévitable Nadeau. Hélas, il suffit de tenir ces volumes en main pour s’apercevoir que leur réalisation est une hérésie : papier trop blanc, police de caractères d’un corps insuffisant, poids considérable et cartonnage souple qui ne résiste pas au nécessaire temps de lecture (chaque ouvrage compte quelque neuf-cents pages au format 16 x 24, 5 cm). On n’a pas prévu de table des matières, et flanqué chaque tome de quatre index mal faits : présentés à l’identique quand ils sont d’usage différent, ils prêtent à confusion et comportent, de plus, des omissions. Il y avait matière à proposer quatre tomes au lieu de deux, ou bien aurait-on dû employer un papier-bible, infiniment plus léger et d’une exquise matité. Lire ces livres autrement qu’assis à une table est une gageure. Dans les transports en commun, cela relève de la provocation. Les emporter avec soi tient du pari athlétique et d’un entraînement de longue durée. Surtout, ils s’avèrent moins solides que celui édité en 1971, ce qui en dit long sur ce qu’est devenu le traitement physique, matériel, de la chose imprimée. Au bout du compte, on peut penser que ces livres ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits pour être vendus.
Deux nouveaux tomes ont en effet paru, longtemps plus tard, en 1999 et 2000, chez Fayard, avec l’aide du Centre national du Livre (CNL). Cette fois, on constate avec plaisir que l’édition est correcte : ordre chronologique de parution initiale des feuilletons, claire indication de la livraison d’origine. Et puis, voici une surprise : si l’on trouve ici des articles consacrés à des auteurs du XIXe siècle parus après 1971 et n’ayant donc pu être compilés dans l’édition précédente, on en lit aussi, qui eussent dû logiquement en faire partie et ont été oubliés, ou non retenus. Les deux préfaces sont de l’inévitable Nadeau. Hélas, il suffit de tenir ces volumes en main pour s’apercevoir que leur réalisation est une hérésie : papier trop blanc, police de caractères d’un corps insuffisant, poids considérable et cartonnage souple qui ne résiste pas au nécessaire temps de lecture (chaque ouvrage compte quelque neuf-cents pages au format 16 x 24, 5 cm). On n’a pas prévu de table des matières, et flanqué chaque tome de quatre index mal faits : présentés à l’identique quand ils sont d’usage différent, ils prêtent à confusion et comportent, de plus, des omissions. Il y avait matière à proposer quatre tomes au lieu de deux, ou bien aurait-on dû employer un papier-bible, infiniment plus léger et d’une exquise matité. Lire ces livres autrement qu’assis à une table est une gageure. Dans les transports en commun, cela relève de la provocation. Les emporter avec soi tient du pari athlétique et d’un entraînement de longue durée. Surtout, ils s’avèrent moins solides que celui édité en 1971, ce qui en dit long sur ce qu’est devenu le traitement physique, matériel, de la chose imprimée. Au bout du compte, on peut penser que ces livres ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits pour être vendus.
 Enfin, le solde (le solde ?) des chroniques que Pia rédigea pour Carrefour – il en restait à colliger ! – fut présenté en 2012 par un éditeur artisanal connaissant son métier. Ce livre est incontestablement le plus beau et le plus réussi des quatre et, pour cela, il mérite qu’on s’y attarde.
Enfin, le solde (le solde ?) des chroniques que Pia rédigea pour Carrefour – il en restait à colliger ! – fut présenté en 2012 par un éditeur artisanal connaissant son métier. Ce livre est incontestablement le plus beau et le plus réussi des quatre et, pour cela, il mérite qu’on s’y attarde.
Plus de cinq cents pages d’assez grand format (18 x 24 cm), de petits caractères serrés, des cahiers cousus et collés, non massicotés, une couverture rempliée, une impression en offset. S’agirait-il d’un volume d’il y a plusieurs décennies ? Point du tout, on est ici dans la maison dite « du Lérot », chez Étienne Louis, cet éditeur de Tusson (Charente) qui persiste dans l’érudition et le beau livre de conception traditionnelle.
Si l’on en croit Jean-Jacques Lefrère qui a préparé l’édition et l’a préfacée, d’aucuns s’abonnaient à Carrefour uniquement pour les articles de Pia. La période considérée s’étend de 1954 à 1977. On nous assure qu’il n’existe ici aucun doublon avec le contenu des trois parutions antérieures. C’est dire l’extraordinaire quantité de livres que Pia a pu chroniquer en plus de vingt ans d’exercice.
On observe que chaque feuilleton a sensiblement la même longueur que les autres, Pia ayant bénéficié, dans le journal, d’une rubrique fixe. Quatre pages, la dernière n’étant pas toujours entièrement pleine. Il arrive néanmoins que l’article soit plus long, atteignant cinq pages. Chacun traite d’une œuvre, parfois de deux, plus rarement de trois ou quatre. Dans ce cadre bien délimité, Pia use de phrases qui pourront paraître longues au lecteur d’aujourd’hui – elles sont pourtant simples, bien articulées, construites solidement : c’est notre regard qui a changé, pas en bien, et les habitudes de lecture.
On est frappé par l’érudition du critique, sa bienveillance qui cependant ne censure jamais le regret d’une faiblesse ou d’une insuffisance de l’auteur considéré, son humour léger, permanent, et même par un brin d’ironie arboré à fleur de sourire, comme à la boutonnière. Tout cela est servi par une langue, faut-il le dire, impeccable.
Une iconographie abondante est reproduite en fin de volume, et non au milieu comme la vogue des biographies en a généralisé la pratique. Ceci, encore, qui n’existe plus : un papillon encarté dans le livre signale deux minimes errata dans les légendes.
Et si cinquante euros, c’est une somme, il reste que cela ne représente pas plus – voire moins – que les deux tomes typographiquement « gonflés » qu’on n’aurait pas manqué de nous imposer, si ce livre avait été réalisé par un éditeur commercial sur l’immonde papier d’une presse Cameron, cette erreur historique, cette monstruosité de l’imprimerie.
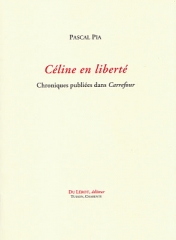
Est-ce terminé ? Non, car, parallèlement, en 2011, les éditions du Lérot ont repris, sous le titre Céline en liberté, qu’elles ont choisi, les dix articles que Pia avait consacrés dans Carrefour aux œuvres de l’écrivain. Quatre de ces textes sont des doublons, six autres complètent les ouvrages dont j’ai parlé, si bien que ce volume de quatre-vingts pages de format 15 x 21 cm, présenté par Jean-Paul Louis, vient encore s’ajouter aux précédents. On peut le comprendre puisqu’il s’agit en quelque sorte d’une anthologie thématique. Ce recueil souffre, inévitablement, des mêmes maux que celui de 1971. Rapprocher des textes parus à des écarts importants aboutit ici et là à créer des redondances. On ne s'arrêtera pas à cela.
Au total, cette œuvre, car le mot convient qui se présente seul sous la plume, représente environ trois mille pages, souvent grandes et toujours serrées. Le fait qu’il ne s’agisse ici que des « papiers » donnés à Carrefour laisse songeur : on n’a pas encore recueilli ceux du Magazine littéraire ou de La Quinzaine littéraire.
Bien que Pia n’ait jamais conçu ses articles selon un plan d’ensemble – tout au contraire, il chroniquait les ouvrages qu’il recevait, ce qui aurait dû interdire le regroupement factice effectué par Nadeau – il est devenu banal d’affirmer que l’ensemble de ces feuilletons forme, par-delà la critique au riche sens du mot, une véritable histoire de la littérature d’expression française, au travers de ce qui fut, durant de longues années, proposé en librairie. Cependant, la chose est réelle et cela constitue une raison supplémentaire de regretter la disparate de sa publication.
Il conviendrait de refaire une édition complète, qui serait repensée et réimprimée dans un esprit unique, en six ou sept volumes sur bible, par exemple, car, dans l’immédiat, on jurerait une construction dont nombre d’architectes successifs auraient repris les plans d’origine, en les modifiant à leur guise. Ne rêvons pas, cela n’existera pas.
16:49 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 09 novembre 2012
Skyfall, une parfaite réussite
JE DOIS PRÉCISER, SELON LA FORMULE HABITUELLE, QUE CET ARTICLE DÉVOILE UN GRAND NOMBRE DE POINTS-CLÉS DU FILM.
Cet article a été précédemment publié sur trois forums consacrés à Bond.
Contexte
J’ai vu Skyfall samedi 27 octobre après-midi, vingt-quatre heures après sa sortie, en version originale sous-titrée. À Paris, avenue des Gobelins, à 13 h. Dans les premiers rangs, se tenaient des gamins de douze ou treize ans, et je me suis dit que j’avais cet âge lorsque j’allais découvrir Bons baisers de Russie. À ceci près que j’étais avec mes parents, eux étaient entre eux, formant un petit groupe. Les temps changent. Il n’en reste pas moins que, dans la salle, se pressaient quatre générations, ce qui m’a amusé.
Genre du film
La presse l’avait dit et répété à satiété : on se situe entre un film d’action et un film d’auteur, et ce tout au long de ce nouvel opus. C’est précisément ce qui m’a enchanté. Tous les codes habituels sont respectés, sans appuyer trop, sans artifice, et pourtant, c’est un film d’auteur, à l’esthétique incontestable : filmage, montage, photographie, tout est très bon. Sam Mendès signe à la fois un Bond et un Mendès, je trouve cela très bien. Il faudrait vraiment faire la fine bouche pour ne pas reconnaître que le film des cinquante ans est réussi, de haut niveau, et marquera l’histoire de la série.
Les journaux l’avaient aussi répété : le film joue en permanence sur l’opposition entre les anciens et les modernes, balançant de l’un à l’autre. Bond est-il un personnage ancien qui ne peut plus servir à rien puisque Q peut tout faire, de son bureau, avec une machine et quelques écrans, ou même de chez lui, en pyjama et avant son thé, comme il l’affirme lui-même ? Ou bien se révèle-t-il indispensable, lorsqu’il faut se battre ou dépasser la technologie dans la recherche de l’humain ? Tout au long de l’œuvre, les scénaristes jonglent avec cette opposition, adoptant tantôt un point de vue, tantôt l’autre, mais justifiant Bond au bout du compte, évidemment. Je pense que, s’agissant du cinquantenaire de la série, ce débat ne pouvait être évité. C’était une bonne façon de la remettre sur les rails, après quatre années de silence.
Bien évidemment, il ressort de cela qu’il n’y a pas lieu d’opposer l’ancien et le moderne, qui sont complémentaires.
Gunbarrel
Oui, il est à la fin et cela n’a effectivement pas de raison d’être, sinon que ça annonce la mention habituelle, la formule magique : James Bond will return.
Je n’ai aucune preuve de ce que j’avance, c’est très intuitif, mais quelque chose me dit que ce sera désormais toujours comme ça. De toute façon, nous n’y pouvons rien, nous pourrons toujours le regretter mais, dans quelques années, les plus jeunes, qui auront toujours connu le gunbarrel à la fin, se demanderont comment on a bien pu le supporter, placé au début.
Générique
Magnifique générique, enchaînant parfaitement avec le pré-générique et la chute. Bond coule, et place au graphisme magnifique et luxurieux. Évidemment, on passe abruptement de la couleur au noir et blanc (sauf à considérer le noir et blanc comme une couleur, je veux dire : comme un choix). Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans ce générique, on peut avoir l’impression d’un fouillis, mais ce n’est pas la mienne ; il faudra d’ailleurs le revoir pour en étudier la composition de plus près.
Craig
Quand je pense qu’il y aura encore des spectateurs pour ne pas apprécier Craig dans le rôle de Bond… Il est incontestable, il l’était déjà depuis Casino Royale, mais comment, désormais, lui nier la pleine possession du personnage, en même temps que la création de quelque chose de profondément personnel, qui s’impose et s’imposera sans coup férir ? Il est impeccable. Rien à ajouter.
M Sans conteste le personnage principal du film. Depuis longtemps, elle prenait de plus en plus d’importance dans les scénarios et, sur un autre forum, je m’en étais félicité, quand d’autres le regrettaient. Ici, c’est le summum et comme ça ne pouvait pas aller plus loin, elle disparaît à la fin.
Sans conteste le personnage principal du film. Depuis longtemps, elle prenait de plus en plus d’importance dans les scénarios et, sur un autre forum, je m’en étais félicité, quand d’autres le regrettaient. Ici, c’est le summum et comme ça ne pouvait pas aller plus loin, elle disparaît à la fin.
Elle disparaît intelligemment, c’est-à-dire qu’on n’a pas l’impression que tout a été conçu dans le but de lui fournir une sortie sur mesures, après une série de films étalée sur plusieurs années, durant lesquelles elle a tenu le rôle avec une autorité et une justesse incontestables.
Faire de M une femme n’avait rien d’évident. Elle est passée par là et aujourd’hui, on se demande si Mallory sera à la hauteur pour lui succéder (je pense que oui, bien sûr).
Plus que jamais, ses rapports avec Bond relèvent de la relation mère-fils. Ça, c’était déjà dans Fleming, où Bond avait pour M (Sir Miles Messervy) une considération importante, un respect profond. Ce qui transparaissait d’ailleurs dans les premiers films où M (Bernard Lee) était le seul devant qui Sean Connery se faisait parfois petit garçon –- et ça marchait très bien.
Cette fois, Bond a perdu sa mère, c’est évident. Pas Monique Delacroix, l’épouse d’Andrew Bond, mais M. Elle meurt dans ses bras, il pleure. Qui plus est, cela se passe sur les lieux de son enfance, dans cette maison où, justement, il a appris autrefois la mort de ses parents et s’est caché durant deux jours dans le souterrain. « Quand il est ressorti, il n’était plus un enfant », dit le vieux garde-chasse, personnage secondaire admirable, interprété magnifiquement et porteur d’une très grande capacité de sympathie.
M lègue à Bond son chien de porcelaine horrible et ridicule avec le drapeau anglais sur le dos, symbole de leur complicité toujours un peu tendue, mais toujours fidèle.
Je crois que nous pouvons remercier Judi Dench pour ce qu’elle a fait du rôle depuis qu’elle l’a pris en charge. C’était vraiment excellent.
Silva
Un fou malade, magistralement interprété. Pour une fois, il ne veut pas conquérir le monde, ni, sans doute, s’enrichir. Son organisation, dont on ne sait pas à quoi elle sert, il l’a montée on ne sait pourquoi. En attendant, ce film est l’histoire de sa vengeance. Il a avec M, lui aussi, un rapport mère-fils. Il ne lui pardonne pas de l’avoir « trahi » lorsqu’elle l’a échangé contre six autres agents. Il a été détruit par cet abandon maternel. À la fin, d’ailleurs, il veut mourir avec elle et de sa main. Il l’appelle « maman », et la scène d’homosexualité, qui ne me choque pas du tout, montre, à mon avis, qu’il considère un peu tous les agents comme ses frères (comme étant tous des enfants de M, en quelque sorte). Donc, Bond est vécu comme son frère et Silva devient incestueux. Je ne veux pas faire de psychanalyse de bazar, je ressens vraiment cela comme ça. Silva est bisexuel, ça existe, pourquoi cela n’aurait-il pas sa place dans un Bond ?
Séverine
Le personnage est envoyé à la mort très vite. À la limite, on se demande pourquoi il existe. C’est vrai, il n’est pas suffisamment exploité, voire pas du tout. Je me demande donc ce qu’on peut en dire vraiment : on ne sait pas à quoi sert Séverine.
Q Quand on a annoncé, il y a plusieurs mois déjà, que Q serait un si jeune homme, j’ai été extrêmement sceptique. Je me trompais. Non seulement, Q est devenu un champion de l’informatique, mais il est interprété à la perfection. D’avance, je savoure le moment où on le retrouvera parce qu’il est vraiment bien, et solide dans son rôle.
Quand on a annoncé, il y a plusieurs mois déjà, que Q serait un si jeune homme, j’ai été extrêmement sceptique. Je me trompais. Non seulement, Q est devenu un champion de l’informatique, mais il est interprété à la perfection. D’avance, je savoure le moment où on le retrouvera parce qu’il est vraiment bien, et solide dans son rôle.
Eve
Ainsi donc, Eve est bien Moneypenny, alors que, depuis un an, tout le monde s’employait à faire taire la rumeur qui lui attribuait le rôle. Mais on ne l’apprend qu’à la fin, lorsqu’elle se glisse derrière un bureau qui, curieusement, et comme celui du nouveau M, retrouve l’aspect d’antan, alors que tout le film joue de la toute-puissance de l’informatique et de la technologie. On est effectivement dans une nouvelle forme de recommencement. Bah, ce n’est pas la première fois que la chronologie est bousculée dans la série, ni la vraisemblance. J’ai énormément apprécié le jeu de l’actrice, je l’ai trouvée vivante, active, subtile. Naturellement, comme tous se le demandent, était-il indispensable qu’elle fût noire ? Reste qu’on va la revoir dans les épisodes futurs.
Reste aussi une question : après la scène du rasage, dit « à l’ancienne », est-ce qu’elle couche ou pas avec Bond ? Si oui – et c’est vraisemblable –, alors, Bond a couché avec Moneypenny, ça, c’est vraiment une première.
Mallory
Je crois que Ralph Fiennes va être un excellent M. En tout cas, il est un très bon Mallory, tout au long du film. Il est blessé lors de la scène du tribunal, à laquelle il prend une part active. Finalement, comme M, il est, dans cet épisode, lui aussi sur le terrain, au moins durant un moment, lorsque la salle d’audience est prise d’assaut par Silva et ses sbires.
Clins d’œil
Innombrables et toujours fins et discrets, heureusement.
Défauts
Le scénario laisse en plan quelques problèmes sans solution.
En premier lieu, cette histoire de disque non récupéré à la fin du film. Il est totalement invraisemblable que M ait pu perdre un tel disque. Mais il est encore plus invraisemblable qu’un tel disque ait pu exister. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on le sait : au minimum, les informations ultra-confidentielles qu’il contient auraient dû être scindées en plusieurs disques, détenus, par exemple, l’un par le Premier ministre, l’autre par le ministre de la Défense, le troisième par M elle-même. En aucun cas, un service secret ne fera une bourde pareille. Cela dit, c’est le point de départ de l’histoire. Il n’y aurait pas eu de film, sans cela.
En deuxième lieu, pourquoi Patrice abat-il l’acheteur du Modigliani ? Je n’ai qu’une hypothèse à avancer. La formidable organisation de Silva, dont on ignore la raison d’être, doit bien être financée d’une manière ou d’une autre. J’imagine qu’il doit recourir au blanchiment d’argent, au trafic de drogue, bref, le b-a-ba du métier. Et également à la vente de tableaux volés. En tuant l’acheteur qui est sans doute venu avec la somme demandée, on peut prendre l’argent et « vendre » le tableau plusieurs fois. Qui voit une autre explication ?
Le cyanure n’a pas réussi à tuer Silva, mais a détruit sa mâchoire et ses dents. Curieusement, il n’a pas détruit sa langue, on se demande pourquoi.
14:05 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (6)
mercredi, 20 juin 2012
Jean-Marie Girardey, 1934-1971

Pour la première fois depuis sa disparition en 1971, je trouve une photographie de Jean-Marie Girardey, ici durant l’année scolaire 1967-1968, au lycée Victor-Hugo de Marseille. On pourra lire, non loin, une « apostrophe insolite » que je lui avais consacrée. J’ai aussi fait paraître un ouvrage, évidemment plus complet, au sujet duquel Sylvie Huguet a bien voulu rédiger un article.
Professeur de lettres, Girardey était aussi un grand joueur d’échecs. Président du club l’Échiquier marseillais 1872, il était également président de la ligue d’échecs de Provence FFE et vice-président de la fédération française des échecs FIDE – 3e région.
17:07 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 09 mai 2012
Les varices de la langue
« Privilégiez les transports en commun », nous enjoint une affiche de la RATP, vantant je ne sais quelle manifestation à laquelle nous sommes supposés désirer assister. On mesure ici combien les mots ont été gaspillés, galvaudés. Rappelons-nous ce qu’étaient autrefois les privilèges réels. Et voici qu’aujourd’hui, c’est à un simple mode de déplacement urbain que s’applique ce vocable. On ne sait plus parler avec l’efficacité qu’assure pourtant la simplicité : « Empruntez les transports en commun », ou bien encore : choisissez, préférez, optez pour, décidez-vous pour. À l’extrême rigueur, « prenez », qui est parfaitement impropre, mais immédiatement compréhensible dans son humilité quotidienne. Eh bien non, on doit « privilégier ». Voilà ce qu’est devenue la langue française, dans ce monde au parler télévisuel. L’usage qu’on en fait aujourd’hui rend la langue variqueuse : on ne s’étonnera pas si elle a mal aux jambes.
09:51 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 24 avril 2012
Pia s’habille chez le Lérot
 Plus de cinq cents pages d’assez grand format (18 x 24 cm), de petits caractères serrés, des cahiers cousus et collés, non massicotés, une couverture rempliée, une impression en offset. S’agirait-il d’un volume d’il y a plusieurs décennies ? Point du tout, on est ici dans la maison dite « du Lérot », chez Étienne Louis, cet éditeur de Tusson (Charente) qui persiste dans l’érudition et le beau livre de conception traditionnelle.
Plus de cinq cents pages d’assez grand format (18 x 24 cm), de petits caractères serrés, des cahiers cousus et collés, non massicotés, une couverture rempliée, une impression en offset. S’agirait-il d’un volume d’il y a plusieurs décennies ? Point du tout, on est ici dans la maison dite « du Lérot », chez Étienne Louis, cet éditeur de Tusson (Charente) qui persiste dans l’érudition et le beau livre de conception traditionnelle.
La publication dont il s’agit est un recueil des chroniques que Pascal Pia signa autrefois pour l’hebdomadaire Carrefour auquel, si l’on en croit Jean-Jacques Lefrère qui a préparé l’édition et l’a préfacée, d’aucuns s’abonnaient uniquement pour les articles de Pia. La période considérée s’étend de 1954 à 1977 et l’ouvrage succède à un premier, initialement publié par Maurice Nadeau, ainsi qu’à deux autres, édités chez Fayard. On nous assure qu’il n’existe ici aucun doublon avec le contenu de ces trois parutions. C’est dire l’extraordinaire quantité de livres que Pia a pu chroniquer en plus de vingt ans d’exercice.
On observe que chaque feuilleton a sensiblement la même longueur que les autres, Pia ayant bénéficié, dans le journal, d’une rubrique fixe. Quatre pages, la dernière n’étant pas toujours entièrement pleine. Il arrive néanmoins que l'article soit plus long. Chacun traite d’une œuvre, parfois de deux, plus rarement de trois ou quatre. Dans ce cadre bien délimité, Pia use de phrases qui pourront paraître longues au lecteur d’aujourd’hui – elles sont pourtant simples, bien articulées, construites solidement : c’est notre regard qui a changé, pas en bien, et les habitudes de lecture.
 On est frappé par l’érudition du critique, sa bienveillance qui cependant ne censure jamais le regret d’une faiblesse ou d’une insuffisance de l’auteur considéré, son humour léger, permanent, et même par un brin d’ironie arboré à fleur de sourire, comme à la boutonnière. Tout cela est servi par une langue, faut-il le dire, impeccable.
On est frappé par l’érudition du critique, sa bienveillance qui cependant ne censure jamais le regret d’une faiblesse ou d’une insuffisance de l’auteur considéré, son humour léger, permanent, et même par un brin d’ironie arboré à fleur de sourire, comme à la boutonnière. Tout cela est servi par une langue, faut-il le dire, impeccable.
Une iconographie abondante est reproduite en fin de volume, et non au milieu comme la vogue des biographies en a généralisé la pratique. Ceci, encore, qui n’existe plus : un papillon encarté dans le livre signale deux minimes errata dans les légendes.
Et si cinquante euros, c’est une somme, il reste que cela ne représente pas plus – voire moins – que les deux tomes typographiquement « gonflés » qu’on n’aurait pas manqué de nous imposer, si ce livre avait été réalisé par un éditeur commercial sur l’immonde papier d’une presse Cameron, cette erreur historique, cette monstruosité de l’imprimerie.
Étude pour un portrait de Pascal Pia, stylo à bille, 2012
15:25 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 14 avril 2012
Gide en ses carnets
 Pour l’anniversaire de la collection « Folio » (quarante ans), le Journal de Gide a paru sous une jaquette spéciale. Il s’agit uniquement d’une anthologie, hélas difficilement lisible dans cette édition, compte tenu de ma vue, mais il n’existe que la Pléiade ou ça, ce texte n’étant pas, à ce jour, disponible autrement.
Pour l’anniversaire de la collection « Folio » (quarante ans), le Journal de Gide a paru sous une jaquette spéciale. Il s’agit uniquement d’une anthologie, hélas difficilement lisible dans cette édition, compte tenu de ma vue, mais il n’existe que la Pléiade ou ça, ce texte n’étant pas, à ce jour, disponible autrement.
Dans ses carnets, Gide raconte cette soirée de 1943 où, à Alger, il a dîné avec de Gaulle. J’aurais aimé que la relation qu’il fit de ce moment peu fréquent – la rencontre de deux hommes comme eux, mon Dieu ! – soit plus longue. Dommage. Voilà le genre de soirée que j’aurais aimé vivre : un dîner avec le Général et Gide…
Il est vraiment merveilleux lorsqu’il narre un moment passé avec tel ou tel littérateur. Par exemple, deux rencontres successives avec Claudel sont magnifiquement résumées, parfaitement peintes, c’est une gourmandise pour l’intelligence. On en redemande. Je lui en veux donc d’autant plus d’avoir écrit, dans sa jeunesse : « Visite à Verlaine », point final. Le bougre n’aurait-il pu nous faire un croquis sur le vif du poète alité à l’hôpital Broussais ?
Voici encore une belle peinture de Claudel, le récit d’une rencontre avec Paul Bourget, celui d’une visite à Proust. Toujours passionnants, ces portraits paraissent trop brefs à mes désirs de délices. Gide aurait dû écrire des volumes entiers sur ses contemporains. Ce n’aurait pas été au détriment de son œuvre, puisque c’eût été une part de celle-ci, justement.
Et puis, qui est fort amusant : l’expression « rien plus », d’usage courant dans le Lot où nous séjournons souvent, Martine et moi, je la retrouve, par deux fois, sous sa plume. Nous n’y verrons donc plus une faute de langue (attestée par Gide, même une erreur voguerait vers le beau). Au vrai, il ne s’agit pas d’une erreur, pas du tout, mais d’une forme ancienne devenue, en Quercy, une manière fréquente.
18:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 16 mars 2012
Une histoire dessinée authentique
 L’Hiver du dessinateur est une bande dessinée traduite de l’espagnol (catalan), parue chez Rackham, qui a cet avantage de narrer une histoire rigoureusement authentique, celle d’un groupe de dessinateurs célèbres qui voulurent, dans les années 50, quitter leur éditeur trop conformiste et qui les exploitait, pour fonder un magazine à eux, en auto-édition. Cela n’a pas marché et ils sont revenus dans le giron de leur maison d’origine. La présence du franquisme est constante. Le livre est documenté et des annexes expliquent qui étaient (sont encore, pour certains d’entre eux) ces personnes.
L’Hiver du dessinateur est une bande dessinée traduite de l’espagnol (catalan), parue chez Rackham, qui a cet avantage de narrer une histoire rigoureusement authentique, celle d’un groupe de dessinateurs célèbres qui voulurent, dans les années 50, quitter leur éditeur trop conformiste et qui les exploitait, pour fonder un magazine à eux, en auto-édition. Cela n’a pas marché et ils sont revenus dans le giron de leur maison d’origine. La présence du franquisme est constante. Le livre est documenté et des annexes expliquent qui étaient (sont encore, pour certains d’entre eux) ces personnes.
Je suis heureux d’avoir découvert, dans le même temps, un dessinateur et un fragment d’histoire de la bande dessinée ibérique. Par ailleurs, l’ouvrage est beau (c’est un 17 x 24 cm, proche de mon cher 18 x 24 cm), cousu, avec une couverture à rabats, et les cahiers sont de différentes couleurs, selon les périodes de l’histoire racontée. La chronologie est d’ailleurs bousculée, c’est un choix narratif, l’esprit du lecteur devant rétablir et y parvenant.
Je lis sur le site de l’éditeur : « L’Hiver du dessinateur est l’histoire d’un combat pour la dignité et la liberté ; une bataille perdue par un petit groupe d’artistes qui se battent pour être maîtres de leurs choix, de leurs œuvres et de leur destin ». J’ai bien fait d’acheter ce livre. L’auteur se nomme Paco Roca. Il est né à Valence en 1969.
17:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 09 mai 2011
Le taulier se manifeste

Quarante ans après sa disparition prématurée, le portrait d'un professeur inoubliable. Un personnage que de nombreux témoignages montrent admiré ou rejeté ; des documents retrouvés ; la peinture d'un quartier ; le lycée Victor-Hugo de Marseille ; soit, en filigrane, le « roman », entièrement authentique, d'une génération.
Voici ce que dit la quatrième de couverture, en un texte honnête, qui décrit, sans exagérer, le contenu de l’ouvrage. C'est moi qui l’ai rédigé : c’est un exercice que je n’aime pas, mais au moins, le résultat n’est pas outrancier.
« Jean-Marie Girardey était professeur de lettres au lycée Victor-Hugo, à Marseille. Personnage hors du commun, il est décédé accidentellement dans sa trente-septième année.
Jacques Layani, qui fut son élève en classes de première et terminale, témoigne ici, dans une écriture à la fois précise et évocatrice, de l’affection admirative qu’il n’a jamais cessé de lui vouer. En même temps qu’un portrait, voici le journal de la recherche sans fin, menée par l’auteur, pour retrouver les traces d’un homme résolument différent. Un jeu de piste, voire une enquête, dont, quelquefois, les résultats sont inattendus.
Grand joueur d’échecs, Jean-Marie Girardey exerçait dans ce domaine plusieurs responsabilités. Cet aspect est traité au travers de passionnants documents d’archives.
De nombreux souvenirs d’anciens élèves, de collègues enseignants ou de mères, apportent à cet ouvrage la richesse de regards autres. Ces multiples témoignages fondent un récit aux mille facettes, toujours rigoureusement authentique.
Enfin, quelques brefs écrits du professeur ont été regroupés dans ce volume. Entre autres, un traité de dissertation, des énoncés d’exercices et un choix d’appréciations exprimées dans un registre fort personnel.
Quarante ans après sa disparition, ces textes étonnent encore. »
15:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 09 juin 2009
La léga-monnaie, par Martine Layani-Le Coz
Jamais nous n’avons connu l’heureux temps des pièces d’argent ou d’or. Bien sûr, tous n’en avaient pas. La création des assignats n’est qu’un souvenir de notre histoire. Et malgré l’imprimerie, la bourse restait plate. Depuis le siècle dernier, la vertu de l’argent ne cesse de cascader de dévaluation en dévaluation pour transformer le peu qui reste en transcriptions d’écritures. Le nerf de la paix est devenu fantôme.
Aujourd’hui, dès qu’un problème se pose, le gouvernement fait un projet de loi. Celui qui a la main sur le trésor n’est pas près de changer sa place.
14:52 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 08 avril 2009
Coup gueule
Depuis un bon quart de siècle, on assiste à une disparition lente mais certaine de « de » et « du ». Cela a dû commencer par le congé maladie et le congé maternité, se poursuivre par le congé longue durée. On a ensuite assisté à une révolution dans le domaine de la couture : la poche poitrine ; à une autre, dans l’automobile : le siège passager. Je veux bien que la langue évolue. Ce qui m’ennuie, c’est le fait de la dépouiller pour la réduire à son aspect utilitaire. C’est un peu l’anglo-saxonnerie de la langue française.
Aussi, allons jusqu’au bout. Que le commandant bord attende, pour décoller, l’autorisation de la tour contrôle. Que le chef rayon cesse de martyriser les employés magasins. Que les directions envoient des notes service.
Ce sera enfin l’âge or.
09:56 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (8)
vendredi, 03 avril 2009
Une information
S’il existe d’aventure quelques promeneurs entêtés pour arpenter encore les trottoirs désertés et non entretenus depuis si longtemps de cette malheureuse rue Franklin, qu’ils sachent que paraîtra prochainement le tome XVI des œuvres complètes du taulier.
Il s’agit du recueil Apostrophes insolites, dont on a pu lire ici quelques pièces. L’ensemble a été repris, corrigé, augmenté et se trouve agrémenté d’un avant-propos et d’une table des matières. Bref, tout cela a été mis en livre, à la différence de simples textes figurant sur la Toile.
L’ouvrage est publié, une fois de plus, par l’Harmattan qui est à l’origine du sous-titre « Une correspondance imaginaire avec… »
15:38 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (4)
jeudi, 11 décembre 2008
Produit et coproduit
Chacun aura remarqué, je suppose, combien les jingles sonores ou visuels s’accumulent désormais. On ne peut plus s’apprêter à regarder une émission de télévision, un film en DVD, sans que défilent, accompagnés en général d’une musique aussi laide qu’assourdissante, les logos des différentes sources de financement, des producteurs et coproducteurs. Or, ils sont toujours plus nombreux puisque le coût d’une réalisation ne cesse d’augmenter et qu’il faut multiplier les participations. Le malheureux spectateur doit donc supporter parfois trois ou quatre animations qui lui signalent que ce qu’il va voir, il le doit, heureux homme, à telle et telle maison de production. Le spectateur, bien évidemment, n’en a cure. Rien à faire, il aura droit à tout. Le pire est que ces avertissements publicitaires sont neuf fois sur dix d’une laideur repoussante, très souvent stupides et presque toujours graphiquement ratés. Bien sûr, il suffit de ne pas regarder, mais il est presque plus contraignant de devoir jeter un rapide coup d’œil de loin en loin pour voir si « c’est fini » ou non.
11:22 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 05 décembre 2008
Immondices immondes
Au hasard des informations glanées sur la Toile, j’apprends que, durant les cinq dernières années, le nombre de sacs jetables distribués dans les magasins a été réduit de 80 %. Il s’agit uniquement du commerce alimentaire : rien n’est précisé des « autres secteurs de distribution », comme on dit aujourd’hui. De dix milliards en 2002, on serait passé à deux milliards en 2007. Dont acte. On a finalement décidé de supprimer, dans les trois ans qui viennent, ces fameux sacs dont la spécialité est de se retrouver dans les rues balayées de vent ou dans les cours d’eau. Cela concernera les grandes surfaces comme le petit commerce.
Parfait. Cette décision, il me semble, était autant attendue que nécessaire.
Pourquoi patienter trois ans ? Selon Jérôme Bédier, président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), il s’agit de « convaincre les clients de prévoir à l’avance un cabas ou un sac réutilisable ». Soit. Encore que cela suppose qu’on ne pourra plus effectuer de courses d’une façon impromptue (sauf à ne plus se déplacer sans cabas, comme le faisaient les petites vieilles des années 50 et 60) ou à transporter en permanence, plié dans sa poche… un sac de plastique.
Mais le même Bédier veut maintenir les sacs réservés aux fruits et légumes. Il argue que « les commerçants ont besoin de sacs pour vendre des fruits et des légumes ». Certes. « Il n’y a pas d’alternative », assure-t-il.
Si. Les fruitiers ont toujours vendu des légumes et des fruits – et même des œufs, parfois – dans de petits sachets de papier kraft qu’on peut détruire sans difficulté. Beaucoup le font encore. Pourquoi ne pas généraliser leur emploi ? Ce ne serait qu’un retour à ce qui s’était toujours fait avant l’apparition puis la généralisation du sac jetable, tellement entré dans les mœurs qu’on en est venu à l’appeler sakanplastic avant, l’usage fautif se généralisant, de le dénommer sakplastic.
15:39 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 17 novembre 2008
Incompréhensible
La vente des papiers et du mobilier de Gracq a donc eu lieu.
La correspondance que lui avait adressée Breton était estimée entre 30 et 35. 000 euros. Le lot était important. Le catalogue décrivait trente-deux lettres autographes signées (dont huit cartes postales) et une lettre signée, portant sur la période 1939-1966. Cela représentait environ quarante-deux pages de formats divers, avec quelques en-têtes de Medium et d’Arcy galleries, International Surrealiste Exhibition…). Les enveloppes étaient conservées.
À cet ensemble, étaient joints : une copie autographe par Gracq de la lettre du 10 juin 1939 ; trois télégrammes ; deux cartons d’exposition annotés et signés par Breton, avec enveloppes ; une lettre autographe signée de Gracq à Breton en date du 30 mai 1946 (renvoyée à l’expéditeur) ; le faire-part de décès de Breton ; une lettre autographe signée d’Aube Elléouët à Gracq, de l’année 1958.
C’est dire que, sans difficulté, le lot a trouvé preneur à 75. 000 euros… et a été immédiatement préempté par l’État. Ce fonds a donc rejoint les collections de la bibliothèque Jacques-Doucet, laquelle possédait déjà les lettres de Gracq adressées à Breton. Il était logique, nécessaire, évident, que les deux fonds fussent rassemblés.
Compte-tenu du prestige du scripteur, de celui du destinataire, et vu le grand nombre de documents, il était clair comme le jour que les enchères atteindraient un tel montant, en ce monde où la valeur marchande prime sur l’intérêt artistique, littéraire, historique. Gracq ne pouvait ignorer que les choses se passeraient ainsi. Il avait eu soin de léguer ses manuscrits à la Bibliothèque Nationale. Que n’en a-t-il fait autant pour sa correspondance ? L’État aurait pu recevoir le fonds par testament. Au lieu de cela, il acquiert les mêmes documents pour 75. 000 euros. Je ne comprends pas l’attitude de Gracq.
11:13 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 03 novembre 2008
Les curieuses réactions des critiques
Voilà encore un article curieux publié sur la Toile, à propos de mon Fleming. À première vue, il est peu favorable. À la seconde lecture, il l’est davantage. Mais ce n’est pas là ce qui m’étonne.
On évoque mon « ton légèrement pontifiant », mais j’ai l’habitude. C’est un des premiers reproches qu’on me fait, quel que soit le sujet. Je ne sais pas très bien pourquoi. Quand on me connaît, on comprend que ce n’est pas du tout le cas ; c’est uniquement ma façon d’être sérieux et rigoureux qui donne au lecteur cette impression.
On dit que je me montre « fort de [m]on statut de pionnier hexagonal ». Du diable si j’ai eu ce sentiment, en composant ce livre. Effectivement, il n’y a pas d’équivalent sur ce sujet en langue française, mais je n’avais pas l’impression de concourir pour un titre quelconque. Je ne suis le premier que par hasard.
On parle d’ « une énorme erreur factuelle ». Je ne comprends pas pourquoi. J’ai vérifié le passage incriminé et n’ai pas trouvé d’erreur. Ce que relève le critique, je l’ai dit. J’admets bien volontiers l’avoir dit trop légèrement, trop succinctement, mais je ne vois toujours pas où est l’erreur factuelle.
On assure que j’ai « un intérêt limité pour les prolongements de l’œuvre littéraire de Fleming » : c’est exact et comme mon sujet était ailleurs, je ne vois pas pourquoi j’aurais poursuivi dans cette voie. Ce n’est pas la première fois qu’on m’oppose ce raisonnement curieux, qui consiste à contester non pas la façon dont j’ai pu traiter mon sujet, ce qui serait légitime, mais le sujet lui-même. En résumé, cela donne : « Vous avez traité tel sujet, soit. Mais pourquoi n’avez-vous pas plutôt traité tel autre ? » Eh, c’est parce que tel autre n’était pas à l’ordre du jour. Les éditeurs me font très souvent ce coup-là : je n’oublierai jamais cette fois où, proposant le projet de ma vie d’Albertine Sarrazin, je m’entendis demander d’écrire plutôt une biographie de Raymond Devos. Je dois à l’honnêteté de dire que l’éditeur en question accepta tout de même le livre sur Albertine et que, sept ans plus tard, c’est aussi lui qui publia celui consacré à Fleming. Il n’en demeure pas moins que cette réaction me laisse toujours sans voix.
Je m’attarde « complaisamment sur des questions de traduction qui pourraient être réglées en deux pages ». Ça alors ! Justement, le but de ce chapitre, intitulé « Questions de traduction », était précisément de détailler le plus possible les problèmes rencontrés par Fleming lorsqu’on a établi les premières versions françaises de ses œuvres. Je commence cet examen en disant qu’on ne peut évoquer des livres traduits comme s’ils avaient été rédigés directement en français et que, par conséquent, il importe d’y aller voir de plus près. Si je m’étais écouté, ce chapitre eût été encore plus long ! Rien à faire, un autre critique recommandait aux lecteurs de sauter ces passages. Celui-ci voudrait les réduire à deux pages. Il insiste : « Faut-il se pencher à ce point-là sur des éditions françaises des années soixante que le pékin moyen ne risque absolument pas de trouver aujourd’hui en librairie et dont le seul intérêt est l’absolue kitschitude ? » Passons sur le « pékin moyen » que je trouve bien méprisant (le critique est professeur de classes préparatoires et reste élitiste) quand il aurait pu dire « le lecteur », tout simplement. Il reste que les éditions « kitsch » et extrêmement fautives dont il est question sont toujours disponibles sur les sites de vente d’ouvrages d’occasion, où elles sont présentées comme des traductions originales et des objets de collection, très précieux. Il convenait donc de mettre en garde le lecteur, précisément.
« Il oublie peut-être le plus important, à savoir le statut mythique de James Bond », poursuit l’auteur de l’article. Des livres sur le mythe, il en existe de nombreux, dont le dernier vient à peine de paraître. Le mythe n’était pas mon propos, mais comment faire comprendre que je ne désire traiter que mon sujet et rien d’autre ?
16:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 29 octobre 2008
Grakavendre
On parle ici, quelquefois, des ventes concernant tel artiste, tel écrivain. La succession Julien Gracq va se jouer à Nantes, le 12 novembre prochain. Ses papiers, bien entendu, ses livres et, ce qui m’embête le plus, sa correspondance (dont, naturellement, des lettres et cartes postales de Breton)… Tout, on vend tout : un bureau, une bibliothèque et même un téléphone, un cendrier… Les corbeaux, ce sont ses cousins puisque Gracq n’avait pas de descendance directe. On vend tout, vous dit-on, messieurs-dames (à part les manuscrits, légués à la Nationale). À vendre ! À vendre ! De l’argent ! De l’argent ! Ironie, l'hôtel des ventes se trouve... rue de Miséricorde.
Le catalogue complet est en ligne. Il comprend les sottises habituelles : « Elsa (sic) et André Breton », par exemple. Ou bien un « tirage d’époque colorisé » (re-sic) : on ne sait plus dire « rehaussé » ou tout simplement « colorié ». « Colorisé » est non seulement un anachronisme, mais, de plus, une erreur de vocabulaire : qu’on y soit favorable ou non, la colorisation est un procédé technique bien précis, qui n’a rien à voir avec le fait de rehausser de couleur une photographie en noir et blanc.
16:32 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 28 octobre 2008
Sauter des pages
Aujourd’hui, et toujours sur internet, un des seuls véritables articles concernant le Fleming. C’est-à-dire un texte qui ne se contente pas de reprendre le communiqué de presse ou la quatrième de couverture. Comme chaque fois, ce qu’on me reproche, c’est ce que je suis, ce qui est moi, ce qui, dans le livre, est du Layani pur et simple. Une façon de voir les choses, de les affirmer en les étayant, de creuser des situations, d’analyser, de donner un point de vue détaillé. Voilà que, pour la première fois, le plumitif de service recommande à ses lecteurs de sauter purement et simplement certains passages au motif qu’ils seraient trop ardus – ces mêmes passages auxquels, évidemment, j’ai apporté le plus de soin, le plus de rigueur, pensant qu’ils étaient infiniment nécessaires et ne désirant qu’une chose : partager ce que je savais ou découvrais au fur et à mesure de mon travail. Bien sûr, tout cela n’a aucune importance.
14:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 17 octobre 2008
La disparition de l’allure
La société a évolué d’une façon incroyable. Il est courant à présent de voir des gens – hommes et femmes, parfois âgés, en bonne santé, habillés correctement, raisonnablement nourris, fouiller dans les poubelles pour y récupérer Dieu sait quoi. Souvent, il s’agit d’y prendre un de ces « journaux » pourtant distribués gratuitement partout… Le reste du temps, je n’imagine même pas ce qu’ils peuvent bien chercher là. Ces fouilles se font sans honte, sans pudeur, sans gêne. Elles sont devenues monnaie courante. On ne considère plus que fouiller dans les détritus des autres soit déchoir, à tout le moins : soit triste, déplorable.
Autre chose. Comme j’attendais hier ma fille devant la fontaine Saint-Michel, j’ai vu une dame qui attendait aussi – c’est habituel, à cet endroit. C’était une dame plus âgée que moi. Elle s’était purement et simplement assise par terre et appuyée au poteau d’un lampadaire. La clochardisation est en marche ou, plus précisément : la notion même de clochardisation a disparu. Et, avec elle, le maintien, la tenue, l’allure. Même jeune, je ne me rappelle pas m’être jamais assis par terre ; au pire, l’ai-je fait sur des marches d’escalier, ce qui est entièrement différent. Mais à même le trottoir !
J’ai encore relevé que, dans un ascenseur, les gens, désormais, s’appuyaient systématiquement contre la paroi de la cabine : hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux ne peuvent plus se tenir debout, fût-ce le temps de quelques étages. Ils s’appuient. L’avachissement est devenu la norme.
Ces remarques sont fondées sur une observation de plusieurs mois, des mois qui, peut-être, forment maintenant quelques années. Je trouve tout cela consternant.
14:58 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 15 octobre 2008
Conditionnement
Vous avez certainement remarqué comme moi que, désormais, un objet à vendre n’est plus en état, mais en condition. On parle de la condition d’un livre d’occasion, par exemple. Jusqu’à il y a peu, on parlait de conditions d’existence, de condition pénitentiaire (ou autre), de bonne condition physique, mais un objet était, lui, en bon état, en piteux état, voire « en l’état » comme disent les bouquinistes désireux de vendre très cher un ouvrage abîmé en laissant entendre que le prix tient déjà compte de cela. Désormais, les descriptions, dans les sites de vente sur internet et partout ailleurs, évoquent tranquillement la condition de l’objet. Cela ne m’ennuierait que très relativement puisque le sens demeure clair et la phrase intelligible, si je n’avais le sentiment qu’il s’agit d’une traduction immédiate, littérale et stupide de l’anglais condition, c’est-à-dire, finalement, d’un retour aux origines. Car au vrai, ceux qui usent de ce terme me paraissent agir sous une influence anglo-saxonne non pas subie, mais parfaitement acceptée. Un conditionnement, en quelque sorte.
16:28 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 13 octobre 2008
Des lettres inédites
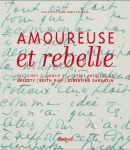 Je signale la parution du livre collectif Amoureuse et rebelle aux éditions Textuel. Ce sont des lettres inédites d’Artletty, Édith Piaf et Albertine Sarrazin, présentées par des personnes considérées comme spécialistes, y compris, en ce qui concerne Albertine, l’immonde taulier.
Je signale la parution du livre collectif Amoureuse et rebelle aux éditions Textuel. Ce sont des lettres inédites d’Artletty, Édith Piaf et Albertine Sarrazin, présentées par des personnes considérées comme spécialistes, y compris, en ce qui concerne Albertine, l’immonde taulier.
C’est un beau volume de grand format, sur papier fort et teinté, en quadrichromie, avec jaquette et signet. Il ne coûte que cinquante euros. J’ai été agacé, en le regardant en détail, de constater qu’un certain nombre d’erreurs de transcription demeurent. Pourtant, l’écriture d’Albertine est parfaitement lisible.
J’ai été amené à participer à cette réalisation par un message reçu cet été, dans lequel on me demandait de remplacer Jean-Jacques Pauvert au pied levé. Il avait paraît-il donné mon nom, en se retirant du projet. Naturellement, c’était urgent. Les transcriptions qui m’ont été communiquées au mois de juillet comprenaient de nombreuses erreurs, que j’avais rectifiées au lu des fac-similés des lettres originales. Je m’aperçois, hélas trop tard, que des fautes ont subsisté : non seulement des coquilles, mais – c’est plus grave – quelques mots mal lus, qui annulent partiellement le sens de certaines phrases. Il est toujours ennuyeux de prendre les choses en marche. Je pense que j’aurais pu éviter bien des bêtises en transcrivant moi-même les lettres dès le départ. C’est dommage. Mais enfin, dans l’ensemble, ce bel album vaut d’être lu.
11:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 11 octobre 2008
L’entretien du siècle
S’il vous plaît de voir et d’entendre le taulier, plus horrible que jamais, répondre stupidement à une bête interview à propos de son livre consacré à Fleming, c’est ici. Rassurez-vous, cela ne dure que six minutes.
23:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 07 octobre 2008
Questions
En-dehors du fait que, régulièrement, on m’arrête dans la rue pour me demander l’heure, voici qu’un fait nouveau est apparu. Dans les couloirs de la Sorbonne, on vient en permanence me demander où se trouvent telle salle, tel amphithéâtre, tel bureau – la plupart du temps, je n’en sais rien, mais là n’est pas la question. Hier, trois étudiants en l’espace de trente secondes (je n’exagère pas) m’ont posé ces questions. Je me demande pourquoi. En fait, je le sais. La raison est la même que celle qui pousse les jeunes me croisant à me saluer avec déférence. J’ai les cheveux gris, je suis pour eux certainement professeur, à tout le moins quelqu’un à l’université. Étonnant comportement qui a, de plus, l’exécrable particularité de me rappeler que je n’ai plus leur âge. Enfin, c’est ce qu’ils croient. Hier, dans l’ascenseur de mon immeuble, j’ai convaincu sans peine une fillette de trois ans que j’avais le même âge qu’elle : la preuve, je portais un cartable pour aller à l’école.
09:50 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 02 octobre 2008
Encore une pétition
Une fois de plus, le taulier doit relayer une pétition. Elle est ici.
19:11 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 01 octobre 2008
Encore un coup du taulier

Cet ouvrage, parfaitement inutile, sera en librairie dans quelques jours. Je vous déconseille formellement sa lecture, qui vous ferait perdre votre temps.
11:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 27 septembre 2008
De mon journal de 2005
19 août
L’été se casse lentement. Il a passé une chemise de vent et s’est curieusement coiffé. Il lui arrive de pleurer pour ce qu’il pressent de son avenir. Les murs de son appartement de collines seront à repeindre l’an prochain. Il faudra aussi, au printemps, changer la moquette. Son souffle est moins ample, il respire à plus petites bouffées, s’économise. Il devient raisonnable. De pamphlétaire, il vire au feuilletoniste.
Sur le plateau du tourne-disques, un enregistrement de poèmes libertins du XVIe siècle. De magnifiques blasons. Ce qu’il ne fallait pas faire pour amener la belle au déduit, tout de même. C’est charmant – et quel talent ! Dans les verres, un bordeaux très honnête, sinon grand. Le pain s’ouvre sous le couteau, le fromage sent le fromage. Fichu pays de France…
Dans les sous-bois déjà, des morceaux d’or chutent gracieusement et forment au sol la litière des dieux. La fougère, cette barbe de trois jours des coteaux mal rasés, brunit rapidement. Il semble que les routes tortillonnent vers l’oubli. Sur le bas-côté, les gravillons et l’herbe folle ont scellé leurs destins.
23 août
Rien à faire, l’été s’obstine à s’éteindre. Il conserve une peau douce et quelques traits de mascara vert, mais une sueur froide a pris son front et le ceint d’abandon. Ses lauriers ternissent. Il semble qu’une main gigantesque l’attire sinistrement vers un gouffre sombre et qu’il n’ait guère le goût de résister. Le vent donne la parole au feuillage des chênes que leur seul nom de « vert » paraît garantir du naufrage. Leurs glands tombés s’embrument de vieillesse. Dans les branches, un bruit régulier signale la présence d’une bête invisible. Ce n’est pas un oiseau, peut-être un écureuil, cet enfant de rousseur aux yeux d’outre-monde. Sous le pas du promeneur, des feuilles mortes déjà craquent sensiblement, comme la mémoire d’une force enchaînée, éteinte. Les mûres ont noirci, mais pas toutes. Chaque journée en fera rougir puis foncer de nouvelles. Parfois, d’immenses ronces recourbées en protègent les grappes. Certains ronciers sont stériles. À quoi peut bien servir un roncier stérile ? Dans les pierriers, les ronces s’agrippent au temps qui passe.
21:32 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 24 septembre 2008
En longue préparation
Dans le catalogue 2008 de la collection « La Pléiade », que j’ai pris chez Gibert simplement parce qu’un beau portrait de Breton figurait en couverture, j’observe que le second tome des Essais de Montherlant est toujours « en préparation ». Cela fait quelques vingt-cinq ans que je l’attends. À dire vrai, je ne l’attends plus. Tant pis.
Je sais bien que ces volumes sont de référence et qu’une édition comme celle-là doit être préparée longuement et scrupuleusement, d’autant qu’elle fera autorité durant des années, parfois des décennies. Tout de même, quel sens cela a-t-il de préparer une édition durant un quart de siècle ? Pour qui travaille-t-on ? Pour les enfants des lecteurs ? Pourquoi pas leurs petits enfants ? Il n’est pas de raison de s’arrêter, après tout… Certes, « la science peut attendre », comme on dit. Jusqu’à quand ? La lenteur éditoriale est-elle forcément gage de qualité ?
15:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 22 septembre 2008
Feu à volonté
« Tirez sur la porte, merci ».
Telle était l’expression figurant sur une feuille de papier collée à l’entrée du magasin « Beaux-Arts » de la librairie-papeterie Joseph Gibert, boulevard Saint-Michel à Paris.
Obéissant, discipliné, je sortis mon arme et fis feu.
Jugez de ma désolation lorsque, sortant de la boutique, j’avisai le même écriteau, enjoignant cette fois : « Poussez sur la porte, merci ». Je poussai si fort sur elle, qu’elle chuta.
Dira-t-on jamais suffisamment que le langage, arbitré par la grammaire et discipliné par la syntaxe, est destiné à se faire comprendre d’autrui et doit être porteur de sens ? Oserai-je ajouter qu’un emploi maîtrisé de la langue peut même permettre de faire passer des nuances ? Et qu’enfin, il est loisible d’en faire, plus qu’un simple moyen, une source de plaisir ? En ces temps, on ne peut plus tirer simplement la porte ni la pousser, il faut que, par surcroît, cela se fasse sur.
16:28 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (11)
vendredi, 19 septembre 2008
Illimitez votre player addict
Qu’est-ce que cela veut dire ? Je n’en ai pas la moindre idée. C’est en tout cas ce qui est écrit sur les murs du métropolitain parisien, là où figurent les affiches publicitaires. C’est également indiqué dans les vitrines des officines de télécommunications. J’en déduis que cela entretient un rapport quelconque avec les téléphones cellulaires, communément dénommés « portables ». Je n’en possède pas et n’en aurai nullement. D’ailleurs, je ne vois pas à quoi cela me servirait, puisque je ne téléphone jamais, ayant cela en sainte horreur. Il reste que je n’ai pas la réponse à la phrase (oui, c’est une phrase, semble-t-il) dont j’ai jugé bon de faire un titre.
15:44 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (5)
vendredi, 12 septembre 2008
Du cahier d’illustrations dans l’édition contemporaine
Je me suis battu, avec tous les arguments possibles, pour que le cahier d’illustrations du Fleming (seize pages) ne soit pas trop horrible. Une présentation très à la mode, et très laide, avait été choisie. Tous les clichés de la mise en pages « moderne » (qui vieillit le plus vite) étaient présents. Après force tergiversations, j’ai argué de mon droit moral, en martelant que ces seize pages, telles qu’elles étaient prévues, disaient d’une certaine manière le contraire de mon texte, donnant de la littérature populaire une image dégradée qu’elle ne méritait pas. L’argument était sincère, mais juridiquement spécieux. Étonnamment, c’est ce qui a porté.
Le cahier, dans l’état où il paraîtra, est donc le compromis entre la volonté commerciale de l’éditeur et la mienne, de discrétion et de pudeur, empreinte d’un désir de classicisme et de rigueur. C’est-à-dire que j’ai accepté les photographies présentées en diagonale, voire pêle-mêle, se chevauchant ; le faux bord dentelé dont on les a affublées ; la différence d’échelle entre les reproductions de couvertures d’ouvrages. J’ai refusé (et obtenu qu’on y renonce) : le fond bicolore (sable et vert bronze) aux teintes réparties gratuitement et aléatoirement ; les photographies en noir et blanc virées en bleu ; de supposés impacts de balles (!) en divers endroits du fond.
On sait que le titre, la couverture, les illustrations et le texte de quatrième sont du domaine exclusif de l’éditeur, de sa compétence et de sa décision pleine et entière. On mesure par conséquent les difficultés de l’auteur à obtenir que le commerce ne prime pas tout.
14:08 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 08 septembre 2008
Des demandes étonnantes
Je reçois, à intervalles réguliers, par téléphone ou par courrier électronique (plus jamais par voie postale), des demandes de journalistes, d’étudiants, portant sur telle ou telle personnalité à qui j’ai pu quelque jour consacrer un travail. Le plus curieux est que cela ne prévient pas, ça arrive ainsi ; c’est la plupart du temps lié à l’actualité, quelquefois pas.
Cet été, j’étais, lors de la commande reçue de Textuel, plongé dans l’univers d’Albertine Sarrazin, mais attendant également des nouvelles d’Écriture à propos de Ian Fleming. Le téléphone sonne, m’apportant des questions d’une pigiste sur Léo Ferré. Aujourd’hui, je suis dans l’attente d’ultimes détails concernant le livre consacré à Fleming ; et le téléphone me présente des demandes concernant Albertine Sarrazin. Quelquefois, on m’interroge à propos de Maurice Pons, bien plus rarement hélas sur Vailland. D’autres fois, je suis sollicité pour des colloques, comme, récemment, celui qui sera l’an prochain consacré à Madeleine Bourdouxhe.
C’est curieux. Peut-être très naturel mais, pour moi, fort étonnant. Je ne me suis jamais dit spécialiste de tous ces auteurs. J’ai proposé des études les concernant, mais cela ne signifie pas nécessairement que je sois le plus à même de répondre aux demandes. S’il suffit de mettre en librairie un ouvrage pour aussitôt, des décennies durant, s’entendre poser des questions (parfois pointues), alors je serai bientôt un correspondant attitré en ce qui concerne Fleming.
J’aurais mauvaise grâce à dire que cela m’ennuie. Je ne suis pas mécontent de recevoir ces questionnaires. Simplement, cela me surprend beaucoup, et je n’en rajoute pas.
16:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)


