samedi, 24 décembre 2005
Les poètes conseilleurs
On sait, de Ronsard, l’attention absolue qu’il portait au temps qui passe et flétrit inexorablement, avec la mort au bout. Il a, de cette matière désespérée, modelé plusieurs magnifiques poèmes, tous très connus, à la fin desquels il ne manquait pas de conseiller à « mignonne » de se hâter. Se hâter de quoi, en fait ? De le rejoindre au déduit, bien sûr.
Corneille, nul ne l’ignore, a repris, un siècle plus tard, la manière, conseillant à Marquise – c’était son nom, je crois, pas un titre – de ne pas croire en sa jeunesse éternelle et de lui céder.
Deux siècles plus tard, ce fut au tour de Baudelaire, l’immense Baudelaire, de tarauder le cœur de la « belle ténébreuse » par un Remords posthume, lui conseillant de connaître très vite « ce que pleurent les morts ».
Un siècle après, Queneau a suivi la même voie, conseillant à la « fillette » de ne pas s'imaginer trop de choses et de se dépêcher de cueillir les roses dont parlait déjà Ronsard.
On peut se demander si toutes ces belles ne furent pas effrayées par les noirceurs que leur décrivaient ces hommes pour qui les mots n’avaient pourtant aucun secret. J’ignore s’il eurent gain de cause, mais la poésie française y a gagné des splendeurs.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11)
vendredi, 23 décembre 2005
Au café du coin, 4
Il a l’air sombre, Fleming, aujourd’hui. Je l’interroge du regard. Je ne veux pas le forcer à s’exprimer, mais je sens un grand désarroi. « Je suis un minable », finit-il par lâcher. Je m’insurge immédiatement : « Sir ! » Il reprend, la voix tristement insistante : « Si si. Vous comprenez, Jacques, la pénicilline, c’était un jeu d’enfant, n’est-ce pas ? On peut être bienfaiteur de l’humanité à peu de frais. Le Nobel, pensez ! ». Mon étonnement ne l’arrête pas. « Mais à présent ? Vous vous rendez compte, je ne peux rien faire ! Je ne peux pas trouver le vaccin définitif contre le sida ! Je n’y arrive pas ». Il se tait, consterné. Je laisse couler un silence pudique mais prends garde qu’il ne s’installe. « Alexandre ». J’ai parlé tout bas, il lui faut un murmure d’amitié compréhensive. « Tout est de ma faute », ajoute Fleming. Il tripote son nœud papillon, bafouille, se reprend, puis : « Si j’appelais Pasteur ? Ah, ça m’embête... » Il ne prête attention à rien et Christelle le regarde ébahie, verser le contenu de son verre de vin dans la sauce de son pavé au poivre.
C’est au solstice d’hiver que Michel-Ange est venu déjeuner avec moi au Campo. Il s’était légèrement blessé à l’œil, certainement à cause d’un éclat de marbre de Carrare, tandis qu’il sculptait. Je lui en fis bêtement la remarque et, très méprisant, il répondit : « Tu ne veux pas que je travaille le plastique, par hasard ? » Je me le suis tenu pour dit. Il louchait sur Valérie, je comprenais qu’il était en train de la réinventer, de la modeler à sa manière, mentalement. Valérie par Michel-Ange, c’est du nanan. En attendant d’être servi, il regardait le plafond, obstinément. J’ai compris. À mon avis, le Campo ne tardera pas à être en travaux. Si c’est ça, les tarifs vont augmenter.
César m’écoute attentivement. Je lui demande ce qu’il pense des événements actuels et son opinion sur les dissensions existant entre Villepin et Sarkozy. Il s’exclame : « Nous sommes en pleine guerre des Gaules ! » et, mâchonnant son carpaccio de saumon accompagné de pommes sautées, grogne : « Je vais récrire des Commentarii ». Tout de même, Chirac et Sarkozy… Je tente de mieux connaître son opinion mais il est aujourd’hui peu loquace. Il marmonne, j’entends vaguement : « Hein ! Brutus, voilà… Tu quoque, filii… » Son téléphone sonne, il ne décroche pas mais jette un regard au cadran lumineux : « C’est Salluste, il m’ennuie ». Et il termine le gamay.
Il est là, le regard exigeant, la chevelure ample, le verbe définitif. En même temps, je sens une tendresse assurément, derrière le geste magnifique. « Votre blog est faible », me dit-il. Je m’y attendais. Je sais qu’il a raison, que puis-je donc dire ? « Oui, c’est exact ». Il paraît satisfait de ma réponse. « Vous en êtes conscient, parfait. Il vous reste deux solutions : vous relevez le niveau ou vous fermez ». Diable, que puis-je faire d’autre, en effet ? Je tente une timide sortie : « Pourtant, on ne cesse de me dire qu’il est difficile, ardu… » Il tranche sans appel : « Plaisanterie. Il est inepte. Fermez-le ». Je me tais, écrasé. Et soudain, son regard s’illumine, il se lève, il doit partir. Déjà, il regarde loin, il n’a même pas dû s’apercevoir que Christelle était totalement subjuguée par son allure, sa prestance, sa voix. Je le raccompagne jusqu’à la porte : « Au revoir, André ». Nous nous serrons la main. Tout en majesté, Breton s’éloigne vers le bas du boulevard.
À suivre
07:00 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (1)
jeudi, 22 décembre 2005
Ramuz
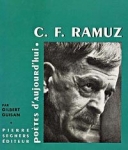 À l’instigation de Dominique Autié, je découvre Ramuz (1878-1947) à cinquante-trois ans. Il n’est jamais trop tard, dit-on. Il peut être tard, tout simplement. Car rencontrer un écrivain, une langue, une écriture en un temps où l’on ne supporte plus de lire des romans est ennuyeux. Il est vrai qu’il est aussi l’auteur d’essais.
À l’instigation de Dominique Autié, je découvre Ramuz (1878-1947) à cinquante-trois ans. Il n’est jamais trop tard, dit-on. Il peut être tard, tout simplement. Car rencontrer un écrivain, une langue, une écriture en un temps où l’on ne supporte plus de lire des romans est ennuyeux. Il est vrai qu’il est aussi l’auteur d’essais.
Dans Derborence, par conséquent, je ne suis l’anecdote que de très loin mais je succule la langue et me repaîs des tournures et du rythme. On parle beaucoup de Giono mais Ramuz le vaut très largement.
L’ennui est que, décidément, je ne puis plus entrer, simplement entrer dans une matière romanesque. Je vois les coutures, la fabrication, j’ai le regard trop expérimenté pour que le cœur se laisse aller, pour que l’esprit soit emporté. Il ne faut voir là nulle outrecuidance, moins encore de prétention. C’est technique. Lorsque je vais au cinéma, c’est la même chose. Je ne vois plus l’image mais l’emplacement de la caméra, les lumières, l’équipe, j’imagine le micro tenu hors-champ, là-haut, prompt à recueillir les propos des acteurs. Je vois les ourlets du scénario.
Est-ce donc qu’il est un âge malheureux où l’âme ne s’émerveille plus guère ? Je ne sais pas. En tout cas, lisez Ramuz pour le goût des mots dans la bouche, le rythme de la phrase mené de main de maître ou artistiquement cassé.
Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence, roman, Grasset, 1936 (rééd. collection Les Cahiers rouges). Illustration : Gilbert Guisan, C. F. Ramuz, collection « Poètes d’aujourd’hui », n° 154, Seghers, 1966.
Le Centre de recherches sur les lettres romandes parle de Ramuz.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10)
mercredi, 21 décembre 2005
À vos souhaits
À Paris où l’on est aimable – chacun le sait depuis (au moins) Villon, « il n’est bon bec que de Paris » – on souhaite les meilleures choses à son prochain. C’est, tout au long du jour, un festival de « Bon courage », « Bonne chance », « Bonne journée », « Bon après-midi », « Bonne soirée », « Bon week end », « Bon retour ».
Quand l’Éducation nationale me nomma en banlieue parisienne, il y a mille ans au moins, je fus frappé, installant mes pénates, de la quantité de « Bon courage » que se disaient les gens autour de moi. Diable, la vie était-elle donc si difficile en ces lieux, la moindre tâche paraissait-elle si insurmontable à qui devait l’accomplir qu’elle nécessitât de si conséquents encouragements ? Je compris rapidement que le souhait n’avait aucune réalité, relevant la plupart du temps du tic de langage, à tout le moins de la considération routinière.
Ce qui continue de m’étonner, c’est le nombre de fois où l’on s’entend dire « Bonne journée ». Peut-être le souhait en question est-il formulé si machinalement qu’on se demande si son auteur prête seulement attention à ce qu’il dit. Par ailleurs, l’accélération grotesque de la vie urbaine conduit à des excès dont on ne relève même pas le ridicule. L’an dernier je crois, j’ai cru mourir d’un grand rire intérieur en entendant préciser : « Bonne fin de journée »… à neuf heures du matin.
Le comble est atteint depuis quelques années. La manie technocratique qui consiste à découper la journée en fractions de fractions – manie singulièrement colportée par les malfaiteurs langagiers qui sévissent dans l’audiovisuel : première partie de soirée (en français : prime time), deuxième partie de soirée – s’est répandue partout. J’ai entendu dire : « On verra ça en deuxième partie d’après-midi » sans savoir précisément ce que cela pouvait bien signifier. En fait, c’était après seize heures. S’agissait-il d’une survivance de l’heure, inscrite en notre tréfonds, du goûter ?
Dans le même ordre d’idées, on commence maintenant à se souhaiter un bon week end le vendredi matin. Ce n’est pas grave : personne n’y croit.
10:40 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (18)
mardi, 20 décembre 2005
La collection « Passion »
 La collection « Passion » que publie Textuel est élégante et très intéressante. Ce sont de grands livres au format 28 x 25, 5 cm, illustrés (environ trois-cent cinquante images par volume) contenant des biographies simples, relativement peu fouillées (pas réellement scientifiques) mais toujours honnêtes – et surtout présentées selon un éclairage particulier, l’auteur mettant l’accent sur des points bien définis, en général annoncés par le sous-titre. Cette optique fait qu’on peut lire ces textes même si l’on connaît très bien le sujet ; on découvrira forcément quelque chose.
La collection « Passion » que publie Textuel est élégante et très intéressante. Ce sont de grands livres au format 28 x 25, 5 cm, illustrés (environ trois-cent cinquante images par volume) contenant des biographies simples, relativement peu fouillées (pas réellement scientifiques) mais toujours honnêtes – et surtout présentées selon un éclairage particulier, l’auteur mettant l’accent sur des points bien définis, en général annoncés par le sous-titre. Cette optique fait qu’on peut lire ces textes même si l’on connaît très bien le sujet ; on découvrira forcément quelque chose.


 Une des originalités de cette série est que les illustrations sont de deux sortes : « directes » – en rapport avec le sujet – et « indirectes » – images d’ambiance recréant un contexte. Le texte renvoie à toutes, systématiquement, si bien que rien n’est gratuit (encore une de mes obsessions : éviter la gratuité du propos).
Une des originalités de cette série est que les illustrations sont de deux sortes : « directes » – en rapport avec le sujet – et « indirectes » – images d’ambiance recréant un contexte. Le texte renvoie à toutes, systématiquement, si bien que rien n’est gratuit (encore une de mes obsessions : éviter la gratuité du propos).


 Une autre particularité : ces livres en noir et blanc paraissent être en couleurs. Rêve visuel à l’explication fort aisée. Les maquettistes, très talentueux, choisissent pour chaque sujet une dominante colorée et une seconde couleur de contrepoint. Ces deux teintes sont utilisées en surimpression de certains documents en noir et blanc, mais pas de tous. Le résultat est que les images sont parfois en noir et blanc, d’autres fois en bichromie (couleur choisie et noir). Les titres sont aussi imprimés dans la dominante. Si bien que le lecteur a vraiment le sentiment de lire un livre… en quadrichromie. Le papier légèrement teinté ajoute aussi, évitant l’indécente blancheur artificielle et usante pour les yeux, à cette impression.
Une autre particularité : ces livres en noir et blanc paraissent être en couleurs. Rêve visuel à l’explication fort aisée. Les maquettistes, très talentueux, choisissent pour chaque sujet une dominante colorée et une seconde couleur de contrepoint. Ces deux teintes sont utilisées en surimpression de certains documents en noir et blanc, mais pas de tous. Le résultat est que les images sont parfois en noir et blanc, d’autres fois en bichromie (couleur choisie et noir). Les titres sont aussi imprimés dans la dominante. Si bien que le lecteur a vraiment le sentiment de lire un livre… en quadrichromie. Le papier légèrement teinté ajoute aussi, évitant l’indécente blancheur artificielle et usante pour les yeux, à cette impression.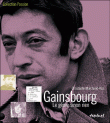
 Le choix des sujets s’effectue dans plusieurs domaines. Des musiciens (Bach), des personnages historiques (Napoléon, de Gaulle), des artistes (Piaf, Ferré), des poètes (Rimbaud, Baudelaire, Hugo, Apollinaire), des architectes (Le Corbusier), des écrivains (Sartre, Simenon, Colette)… Il est vrai que c’est sans risque mais l’originalité, précisément, tient dans l’optique de l’auteur, comme il a été dit au début.
Le choix des sujets s’effectue dans plusieurs domaines. Des musiciens (Bach), des personnages historiques (Napoléon, de Gaulle), des artistes (Piaf, Ferré), des poètes (Rimbaud, Baudelaire, Hugo, Apollinaire), des architectes (Le Corbusier), des écrivains (Sartre, Simenon, Colette)… Il est vrai que c’est sans risque mais l’originalité, précisément, tient dans l’optique de l’auteur, comme il a été dit au début.

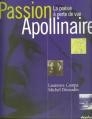 Cependant, tout n’est pas parfait. J’ai attendu longtemps le volume consacré à Apollinaire et, l’ayant feuilleté, je ne l’ai pas acheté, un peu déçu. Les documents d’ambiance ne valent qu’en complément de ceux, plus « directs ». S’agissant d’Apollinaire, je connaissais déjà toutes les images « directes », le reste alors n’avait plus le même intérêt. C’est que l’entreprise a ses limites iconographiques : on ne peut pas inventer des documents qui n’existent pas.
Cependant, tout n’est pas parfait. J’ai attendu longtemps le volume consacré à Apollinaire et, l’ayant feuilleté, je ne l’ai pas acheté, un peu déçu. Les documents d’ambiance ne valent qu’en complément de ceux, plus « directs ». S’agissant d’Apollinaire, je connaissais déjà toutes les images « directes », le reste alors n’avait plus le même intérêt. C’est que l’entreprise a ses limites iconographiques : on ne peut pas inventer des documents qui n’existent pas.
 J’écris cette note d’autant plus librement que les éditions Textuel m’ont joué, il ya deux ans et demi, un très sale tour, si bien que je ne les porte pas dans mon cœur. J’ai donc un réel plaisir à présenter, avec beaucoup d’indépendance, cette collection. Je le fais sans intérêt personnel aucun, faut-il le préciser ?
J’écris cette note d’autant plus librement que les éditions Textuel m’ont joué, il ya deux ans et demi, un très sale tour, si bien que je ne les porte pas dans mon cœur. J’ai donc un réel plaisir à présenter, avec beaucoup d’indépendance, cette collection. Je le fais sans intérêt personnel aucun, faut-il le préciser ? Malheureusement, ces livres coûtent cher : quarante-neuf euros.
Malheureusement, ces livres coûtent cher : quarante-neuf euros.


10:25 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (3)
lundi, 19 décembre 2005
La collection « Poètes et chansons »
 Je vous recommande, une fois de plus (et vous savez que je ne fais jamais de prosélytisme, c’est donc sincère et désintéressé),
Je vous recommande, une fois de plus (et vous savez que je ne fais jamais de prosélytisme, c’est donc sincère et désintéressé),

la collection « Poètes et chansons » que publie EPM. Si tous les enregistrements ne sont pas égaux, c’est cependant une incontestable réussite artistique et didactique.

Ensembles de poèmes chantés par un ou plusieurs interprètes, 
 groupant des enregistrements parfois anciens
groupant des enregistrements parfois anciens  et d’autres réalisés spécialement pour la collection, disques consacrés à un auteur, d’autres à un groupe, les CD de « Poètes et chansons » (plusieurs dizaines de volumes figurent déjà au catalogue) sont présentés dans une pochette à
et d’autres réalisés spécialement pour la collection, disques consacrés à un auteur, d’autres à un groupe, les CD de « Poètes et chansons » (plusieurs dizaines de volumes figurent déjà au catalogue) sont présentés dans une pochette à  trois volets de belle facture.
trois volets de belle facture.
Ils comprennent la plupart du temps un livret contenant les textes eux-mêmes. Une notice intelligemment conçue présente chaque auteur. Viennent de paraître Tristan Corbière et Jean Richepin ; pour suivre, Seghers, Senghor et Le Corbusier. Je rêve d’un Paul Fort (je crois qu’il est prévu mais il y a je pense des problèmes de droits), d’un Breton et d’un Toursky.  Chaque disque coûte dix-sept euros.
Chaque disque coûte dix-sept euros.

Je les achète systématiquement, même s’il s’agit de poètes que j’aime moins comme Max Jacob, par exemple.
Je pense aujourd’hui que cette collection peut devenir, pour le disque, ce qu’était autrefois, pour le livre, la légendaire série « Poètes d’aujourd’hui » publiée chez Seghers. Ce n’est pas rien. Parmi les titres que j’ai trouvés très réussis, j’écoute toujours avec plaisir Luc Bérimont.

Puisqu’on doit, paraît-il, offrir des présents en cette saison, faites des cadeaux littéraires et artistiques au contenu indémodable et magnifique. Le catalogue est riche si vous ne l’êtes guère et le dédicataire de votre offrande ne perdra pas son temps.



15:20 Publié dans Art | Lien permanent | Commentaires (3)
Décembre
Décembre s’écoule, s’en va, que je n’aime pas. J’aime novembre, pas décembre, à cause des « fêtes » tout d’abord, qui sont une chose sinistre, poisseuse, gluante. Pas à cause de la lumière toujours plus rare, non, d’ailleurs, la proche survenue du solstice d’hiver nous promet le recommencement, l’allongement, l’étirement minute après minute d’une flambée nouvelle. Je n’aime pas décembre qui pourtant m’a vu naître parce que c’est un mois d’attente, quelques semaines mises entre parenthèses – et je n’aime pas l’attente, je n’aime pas ce qui s’étend entre des parenthèses. C’est un mois sans consistance, impalpable, qui échappe des doigts parce que tout en lui est dédié aux « fêtes » ; si l’on veut vivre autre chose, on ne peut pas. Je n’aime pas les lieux qu’on ne peut pas habiter parce qu’ils sont universellement dédiés et qu’il faut faire sienne cette dédicace. Il suffit qu’on veuille m’imposer quelque chose pour que je me rebelle immédiatement. Décembre est un mois sans courage, décembre s’échappe, on ne peut pas le prendre aux épaules et le regarder dans les yeux. Décembre me plairait s’il n’était vendu.
10:20 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (15)
vendredi, 16 décembre 2005
La « présentification » selon Sartre
Je relance aujourd’hui un débat fréquent en ce lieu, celui de l’écriture et de ses exigences. Après une série d’échanges sur le style, nous étions convenus il y a quelques semaines de nous arrêter sur l’expression « justesse de l’énonciation » (Barthes).
On peut ici compléter les conclusions, toutes provisoires, auxquelles nous étions parvenus par ces propos de Sartre définissant la fonction du style comme faisant dire au texte « ce qu’il ne dit pas ou n’a pas à dire ». Le style est « une manière de dire trois ou quatre choses en une », déclare Sartre qui baptise cela « présentification », afin de « viser la signification tout en l’alourdissant de quelque chose qui doit vous donner des présences ».*
Ce style-là – je veux dire : cette définition du style et de son rôle – j’y adhère entièrement. C’est celui que j’espère approcher sinon atteindre quelque jour, en travaillant beaucoup et en m’abreuvant d’humilité, car je pense – on reconnaîtra là une de mes obsessions – qu’il est le meilleur moyen de rendre littéraire l’écriture non romanesque.
* Jean-Paul Sartre, Situations, IX, Gallimard, 1987. Cité par Bernard Pingaud, « Le Génie de la famille », in catalogue de l’exposition Sartre (ss. dir. Mauricette Berne), Bibliothèque nationale de France et Gallimard, 2005.
14:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15)
Au café du coin, 3
Évidemment, connaissant la modestie du lieu, j’ai hésité à inviter Louis XIV au Campo. Le Roi-Soleil, pourtant, est un homme simple. Il me parle de Mme de Maintenon en avalant un pavé cuit à point et m’entretient des soucis que lui donne La Fontaine. Le poète n’a pas hésité à le moquer publiquement par une fable intitulée Les Animaux malades de la peste. « Je n’ai pas cillé », ajoute Sa Majesté. J’ai souri car j’ai bien vu que Valérie, elle, le faisait ciller en lui apportant, au dessert, un tiramisu aux fruits rouges.
Lorsque Richelieu, de son large manteau vêtu, m’a rejoint à ma table, il a produit un certain effet, il faut bien le dire. « Éminence », l’ai-je salué en l’accueillant. Ses bottes étaient poudreuses : il arrivait de loin et ne voulut pas couper son téléphone portable car il attendait des informations politiques. « Vous voyez bien, Jacques, c’est important, je joue ma réputation ». Je l’ai assuré que je le comprenais. En mangeant une cuisse de canard à l’orange et aux navets, il m’a proposé d’entrer à son service, j’ai réservé ma réponse. À ce moment, Valérie tout à son travail, prenant un virage sur les chapeaux de roues, nous désigna du doigt : « Coffee ? » demanda-t-elle, déjà partie vers l’office. « Cette jeune personne est charmante », a estimé le cardinal.
Comme il y a beaucoup de monde au Campo, on est un peu serré. Heureusement, Jeanne d’Arc est menue. Je la regarde, en face de moi, grignoter un morceau de pain en mangeant une salade. Cette pauvre fille qu’on s’acharne à représenter blonde sous prétexte qu’elle vient de Lorraine, est brune en réalité. Une fois, elle est arrivée à cheval, ce qui n’a pas beaucoup d’importance, mais il a été difficile de l’installer à une toute petite table : elle était en armure. Je crois bien que, lorsque je déjeune avec Jeanne, Christelle est un peu piquée au vif. Il faudra que je m’en assure.
Le général de Gaulle est lui aussi très simple, comme Richelieu, comme Louis XIV, comme l’Empereur, comme tous mes amis qui déjeunent au Campo avec moi lorsque leurs occupations le leur permettent. Quand sa DS noire le dépose boulevard de l’Hôpital et qu’il entre dans l’établissement, Christelle est impressionnée, qu’elle l’avoue ou pas. Spontanément, d’ailleurs, tout le monde se lève et un grand silence s’établit. Cependant, chacun reprend vite ses esprits et son repas. Le général m’entretient ensuite des affaires de la France. Il fait mine d’ignorer mon amitié avec Sartre, l’indéfectible affection qui me lie à Cohn-Bendit, il est au-dessus de ces contingences. « La France libre, Layani ! Il n’y a que ça » me dit-il quelquefois en s’en allant. À son chauffeur, il lance : « Nous rentrons, Marroux. Direction Colombey ». J’ajoute qu’au rebours de Léonard de Vinci, le général paie toujours l’addition.
Je prends quelquefois des leçons de grandeur avec Victor Hugo, lorsque ses multiples tâches l’autorisent à déjeuner en ma compagnie d’une brochette accompagnée de tagliatelles. Valérie, qui se permet tout – elle pourrait être sa petite fille, mais j’ai comme l’impression qu’il ne la regarde pas du tout comme telle – l’appelle « Mon Totor chéri », comme le faisait Juliette Drouet. Le poète, grand séducteur devant l’Éternel, ne désapprouve pas. Hugo peut regarder bouger les hanches de Christelle tout en évoquant pour moi sa prochaine œuvre de géant. Je lui demande : « Maître, pourquoi ne sanctionnez-vous pas Chirac de traits vengeurs, altiers, ainsi que vous le fîtes pour Napoléon-le-Petit ? » Hugo me regarde fixement et, au bout d’un temps de silence, me dit : « Je suis trop vieux. Je n’ai plus de temps à perdre avec la misère intellectuelle ».
(À suivre)
07:00 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (12)
mercredi, 14 décembre 2005
Quelques chiffres
Pour information :
Ce blog vit maintenant depuis un peu plus de trois mois. Il compte 80 notes (celle-ci est la 81e) et 955 commentaires.
Entre ceux que j’ai conviés initialement et ceux qui sont venus s’ajouter depuis, trente personnes possèdent le code d’accès, même si peu s’expriment.
16:53 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (2)
L’histoire aujourd’hui
Voici le texte d’une pétition qui circule actuellement parmi les historiens. Qu’en pensez-vous ?
Émus par les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l’appréciation des événements du passé et par les procédures judiciaires touchant des historiens et des penseurs, nous tenons à rappeler les principes suivants :
L’histoire n’est pas une religion. L’historien n’accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabous. Il peut être dérangeant.
L’histoire n’est pas la morale. L’historien n’a pas pour rôle d’exalter ou de condamner, il explique.
L’histoire n’est pas l’esclave de l’actualité. L’historien ne plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains et n’introduit pas dans les événements d’autrefois la sensibilité d’aujourd’hui.
L’histoire n’est pas la mémoire. L’historien, dans une démarche scientifique, recueille les souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents, aux objets, aux traces, et établit les faits.
L’histoire tient compte de la mémoire, elle ne s’y réduit pas.
L’histoire n’est pas un objet juridique. Dans un État libre, il n’appartient ni au parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l’État, même animée des meilleures intentions, n’est pas la politique de l’histoire.
C’est en violation de ces principes que des articles de lois successives, notamment lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001, du 23 février 2005, ont restreint la liberté de l’historien, lui ont dit, sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et posé des limites.
Nous demandons l’abrogation de ces dispositions législatives indignes d’un régime démocratique.
Jean-Pierre Azéma, Élisabeth Badinter, Jean-Jacques Becker, Françoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René Rémond, Maurice Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet et Michel Winock.
Voici ce que précise Le Monde du 14 décembre 2005 : « Livrant une liste non exhaustive, ils [les signataires] visent la loi du 23 février 2005 (sur le "rôle positif" de la colonisation), mais aussi les lois du 13 juillet 1990 (dite loi Gayssot, réprimant la négation de crimes contre l’humanité), du 29 janvier 2001 (reconnaissance du génocide arménien) et du 21 mai 2001 (reconnaissance de l’esclavage et de la traite des Noirs comme crimes contre l’humanité). »
07:00 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (96)
mardi, 13 décembre 2005
Un peu d’ordre
Peut-être aurez-vous remarqué que j’ai créé deux nouvelles catégories, dont les liens figurent dans la colonne de gauche. « L’édition », comme son nom l’indique… Et « Cour de récréation » qui regroupe les petites bêtises comme les différents épisodes d’Au café du coin et les jeux du vendredi.
Ces classements nouveaux ne rendent pas mes notes plus intéressantes, je vous l’accorde volontiers, mais ils permettent d’éviter le fourre-tout qu’était devenue la catégorie « Humeur » et le bazar né de « Société ».
12:00 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (3)
Un livre de Bernard Grasset
J’ai acheté sur les quais de la rive gauche un volume de Bernard Grasset, La Chose littéraire, publié par Gallimard en 1929. Il s’agit d’un recueil d’articles parus auparavant dans Le Journal.
Outre que Grasset y apparaît tel qu’en lui-même, hautain, arrogant, élitiste, méprisant, péremptoire, misogyne, outre qu’il accumule les affirmations en prétendant démontrer avant de conclure : « Vous voyez bien que » alors qu’on n’a rien vu du tout – il reste une chose qui m’amuse quand elle ne me fait pas grincer des dents, c’est ce que Grasset raconte de l’état de l’édition au moment où il écrit. Nous sommes, je le redis, en 1929, au moment de la crise, dix ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale (quand il note : « Avant la guerre », c’est « Avant la Première Guerre mondiale » qu’il faut comprendre).
Eh bien, Grasset brosse alors un tableau que j’avais déjà vu avant de lire son livre. C’est celui qu’on me présente depuis ma toute première tentative éditoriale, en 1971. Les mêmes problèmes, les mêmes mots et la même fâcheuse tendance à lier ces questions à l’époque en ce qu’elle a de soi-disant particulier et d’exceptionnel.
Alors, quand les éditeurs vous parleront de la crise de l’édition et des difficultés inhérentes et du goût du public et des problèmes de stockage et des prétentions financières des auteurs et du coût des stocks et de la course aux prix et patati et patata, si m’en croyez, éclatez de rire. En 1929, Grasset, avec ses excès classiques, ses outrances d’expression, disait déjà tout ça. N’en croyez pas un mot.
07:00 Publié dans Édition | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 12 décembre 2005
« Le directeur de Centrale Lyon était un imposteur »
Je reproduis une brève parue dans La Lettre de l’étudiant du 5 décembre 2005.
Au lieu de laver son linge sale en famille, le recteur de l’académie de Lyon a choisi de divulguer la vraie raison du départ de Jacques Labeyrie. Directeur de l’école depuis mars dernier, ce dernier avait maquillé son CV : « Normalien », alors qu’il avait fait une école normale d’instituteurs, agrégation de mathématiques non répertoriée, habilitation partielle à diriger une recherche. Le procureur général de Lyon a demandé l’ouverture d’une enquête pour falsification dans le cadre d’un recrutement. Patrick Bourgin, le directeur-adjoint, devrait devenir administrateur provisoire de l’école.
Voilà une affaire peu banale. Si j’en fais le sujet de cette note, c’est pour vous demander votre avis. Il y a quelques années, une histoire comme celle-là n’aurait pas été rendue publique. L’imposteur eût été évidemment sanctionné (faux, usage de faux, abus de confiance, falsification, manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, tout ce qu’on voudra) mais on ne l’aurait certainement pas dit.
Était-il utile de faire savoir, au risque de jeter une fois de plus le discrédit sur la fonction publique en général et l’enseignement en particulier, que de tels agissements avaient eu lieu ? Je ne réponds pas, je ne juge pas, je n’en sais rien.
10:05 Publié dans Salle des professeurs | Lien permanent | Commentaires (41)
samedi, 10 décembre 2005
La cour d’appel de Paris bloque la vente de manuscrits d’Emil Cioran, par Clarisse Fabre
Je propose un article paru dans Le Monde du 4 décembre 2005. Il me paraît présenter un point de droit fort intéressant, en même temps qu’une énigme.
La vente aux enchères des trente-sept cahiers manuscrits du philosophe Emil Cioran, mort en 1995, n’a pas eu lieu. Prévue vendredi 2 décembre, à 14 heures, à l’Hôtel Drouot, la vente a été suspendue in extremis par une ordonnance de la 14e chambre, section B, de la cour d’appel de Paris, rendue vendredi, à 12 h 30 précises.
C’était une « affaire exceptionnelle » pour le commissaire-priseur qui a organisé l’opération, Me Vincent Wapler : les manuscrits en question comprennent cinq versions successives de l’un des ouvrages majeurs de Cioran, De l’inconvénient d’être né (1973) ; des cahiers de notes préparatoires à d’autres livres, Écartèlement (1979) et Aveux et anathèmes (1987) ; enfin, dix-huit cahiers inédits contenant des souvenirs et réflexions de Cioran, de 1972 à 1980 : son obsession de la mort, sa souffrance au quotidien... Ce sont de simples cahiers à spirales « Joseph Gibert », jaunis par le temps. « Kandinsky soutenait que le jaune est la couleur de la vie. C’est bien possible et, dans ce cas, on comprend mieux pourquoi cette couleur fait si mal aux yeux », lit-on sur l’un d’eux.
Le plus déroutant, dans cette affaire, est la façon dont ces manuscrits ont été découverts. Il faut revenir dix ans en arrière : quelques semaines avant la mort de Cioran, sa compagne, Simone Boué, dévoilait, dans une lettre datée du 25 février 1995, son « intention » de faire don à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet de « tous les manuscrits de Cioran en français comme en roumain ayant fait l’objet d’une édition ou inédits ». Le courrier était adressé à la chancellerie des universités, établissement public sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, qui gère la bibliothèque Jacques-Doucet.
Une « fouille » de trois jours
Cioran meurt en juin 1995 et, le 14 décembre 1995, la chancellerie accuse réception d’une « exceptionnelle donation » réalisée par Mme Boué. Celle-ci meurt en septembre 1997. Le 24 octobre 1997 a lieu l’inventaire notarié de l’appartement qu’occupait le couple, rue de l’Odéon, à Paris. Suit une nouvelle fouille de trois jours réalisée par le directeur de la bibliothèque Jacques-Doucet et « ami » des Cioran, Yves Peyré. Aucun manuscrit n’est mentionné à l’inventaire. En février 1998, le frère de Mme Boué, légataire universel, charge Simone Baulez, brocanteuse, de « débarrasser complètement » l’appartement des « meubles et objets » qui s’y trouvent encore. La dame ne sait alors pas qui est Cioran, dit-elle.
Elle récupère, entre autres, un buste en plâtre du philosophe, non signé, son bureau, etc. Elle met de côté une cruche en faïence où il est écrit « Cioran et Simone ». Il y a, surtout, « ces cahiers à spirales éparpillés au sol, dont certains ont les pages arrachées ». « J’ai dû en jeter certains... », avoue-t-elle aujourd’hui. Mais pas tous : elle fait le tri et stocke les meubles d’un côté, les manuscrits de l’autre. « Mon gendre a vu la cruche : tiens, Cioran, c’est un écrivain. Il faut peut-être garder les affaires..., m’a-t-il dit », raconte la brocanteuse. Elle connaît Me Wapler pour avoir effectué dans le passé d’autres successions prestigieuses. « Au printemps 2005, Me Wapler m’annonce qu’il va vendre des écrits de Céline. Je lui réponds : j’ai des manuscrits de Cioran. »
Les documents sont aussitôt authentifiés, et leur valeur estimée à environ 150 000 euros ; la vente aux enchères est annoncée dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, datée du 11 novembre. Alertée, la chancellerie des universités demande, en référé, l’interdiction de la vente, au motif que Mme Boué a fait une donation de l’oeuvre de Cioran à la bibliothèque Jacques-Doucet, en 1995, et que les trente-sept manuscrits relèvent de son « domaine public mobilier ».
Le 30 novembre, le tribunal de grande instance déboute la chancellerie des universités en estimant qu’elle n’a « aucun droit » sur les documents, comme l’a plaidé l’avocat de la brocanteuse, Me Roland Rappaport. Coup de théâtre, le 2 décembre : les juges de référé de la cour d’appel ordonnent, au contraire, le retrait de la vente aux enchères des manuscrits litigieux en vue de prévenir un « dommage imminent », et leur mise sous séquestre. La chancellerie des universités a deux mois pour saisir les juges du fond, faute de quoi l’ordonnance de la cour d’appel sera caduque. Mais il n’est pas exclu que l’affaire soit réglée à l’amiable.
Reste une question : comment le directeur de la bibliothèque Jacques-Doucet, qui a fouillé de fond en comble le deux-pièces de Cioran, a-t-il pu laisser passer les manuscrits ? « Ils n’y étaient pas ! Trente-sept manuscrits, ça ne se rate pas ! », a déclaré au Monde M. Peyré. La partie adverse rit sous cape, et maintient sa version : « Si la brocanteuse n’avait pas fait son travail, les manuscrits de Cioran auraient fini à la poubelle », grince son avocat.
07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (10)
vendredi, 09 décembre 2005
Au café du coin, 2
Apollinaire fait une exception pour moi. Il accepte de déjeuner à deux et d’être raisonnable. Je m’explique. Apollinaire est fort gourmand. Un de ses jeux consiste à se rendre au restaurant avec deux amis et à commander toute la carte. Le premier qui craque avant la fin paie l’addition. Jeu que je ne puis jouer, naturellement. Quand nous mangeons ensemble au Campo, donc (j’avais omis de vous dire que le bistrot en question se nomme le Campo), le cher Guillaume se contente d’un repas plus classique. Je prends garde, connaissant sa propension au désespoir amoureux, à ce que Christelle ne lui tape pas trop dans l’œil. Pourtant, en le regardant marcher à mes côtés boulevard de l’Hôpital, je peux lire sur son visage le souvenir du pont Mirabeau et de Marie Laurencin s’éloignant vers Auteuil.
J’ai raconté à Ravel, dernièrement, cette histoire vraie. Visitant une nouvelle fois sa maison de Montfort-l’Amaury, je me suis entendu répéter plusieurs fois par la personne chargée du lieu que je ressemblais au maire de la commune. J’eus beau la détromper, elle insista longuement et ne fut pas totalement persuadée par ma réponse. Ravel, ce jour-là, paraissait distrait et négligeait son plat du jour. Ni Christelle ni Valérie ne devaient l’intéresser, je suppose : on ne lui connaît aucune liaison. Peut-être pensait-il à quelque œuvre nouvelle ? Ou bien son horrible tumeur au cerveau…
Il m’est encore arrivé de partager mon repas avec Flaubert qui, ce jour-là, en avait contre Sartre. Il tonitruait : « L’idiot de la famille ! Moi ! Non mais… Pour qui se prend-il, ton Sartre ? Ton Popaul ? Comment peux-tu nous compter tous deux parmi tes amis ? » La serveuse qui, je l’ai dit, en pince pour Sartre se retenait à grand peine ; je crus qu’elle allait intervenir. Je risquai (je précise que, si Flaubert me tutoie, je continue de lui donner du « vous », c’est la moindre des choses) : « Vous savez, Gustave, Sartre s’en est pris aussi à Baudelaire ». Mais Flaubert aime Baudelaire et mes propos firent redoubler sa colère. Bref, je devais aller reprendre mon travail et nous sortîmes très vite, non sans qu’il se fût effacé et incliné devant une dame qui entrait à ce moment-là. Je l’interrogeai du regard : « C’est ma chère Emma » me répondit-il avant de remonter le boulevard.
Picasso est ennuyé chaque fois qu’il déjeune dans un restaurant. Le patron veut toujours lui offrir son repas et ne manque jamais de solliciter un petit dessin en échange. L’ami Pablo s’exécute fort gentiment. Le patron, alors : « Maître… Vous avez oublié de signer ». Et Picasso, fine mouche : « Je paie mon repas, je n’achète pas le restaurant ». Au Campo, pas de ça. On le connaît. Lorsqu’il lui laisse un chèque, Christelle se contente de ne pas l’encaisser. C’est du pareil au même.
(À suivre)
07:00 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (4)
jeudi, 08 décembre 2005
Leçon d’histoire
« Nous serons indépendants à l’époque où tous les journaux parlent de la liberté de la presse mais sont esclaves de leurs propriétaires, de la pub, d’un parti. Où il y a une crise des journaux : pub à la télé.
Nous ne connaîtrons pas cette crise. Nous n’aurons d’argent que celui qui viendra au départ d’une souscription populaire. Nous n’aurons de responsabilité qu’envers le peuple.
Cela veut dire : envers les ouvriers, les paysans, les intellectuels et la petite bourgeoisie commerçante.
C’est le peuple qui informera.
Comment l’entendons-nous ?
Le peuple fait l’histoire.
C’est auprès de ceux qui font l’histoire que nous nous informons. Nos journalistes jusqu’aux directeurs seront payés comme les OS avec quelques arrangements en cas de famille nombreuse : [illisible] en gros 1000. Ils iront sur les lieux (grèves, etc.), bistrots, etc. Ils n’interrogeront pas les chefs s’il y en a mais les grévistes.
Un journal démocrate. Ça veut dire que le peuple y est maître.
Pas comme les autres.
Il ne sera pas un journal politique (inféodé à un parti). Pas même à un groupe gauchiste. Il y aura des maos. Et il faut reconnaître que les maos l’ont inspiré. Mais il ne servira pas les maos : journalistes professionnels. Et puis Foucault, Gavi et moi : sans partis. D’autres. Les maos eux-mêmes demandent un renforcement des non-maos pour les luttes internes du journal.
Divergences.
Luttes qu’il ne cachera jamais.
Mettre en plein jour.
Pas d’investissements et de parts : l’argent vient du peuple. Souscriptions. Abonnements. Donc pas de capitalistes pour infléchir l’orientation du journal.
Pas de publicité. Journaux d’information vivent de la pub. Résultat : si un produit est nuisible, ne peuvent le dire. »
Pour aujourd’hui, un petite leçon d’histoire et de culture politique. À quoi se rapportent ces notes ? Qui en est l’auteur ? À quelle période furent-elles rédigées ?
14:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (15)
mercredi, 07 décembre 2005
Spectacle raté
Nous sommes allés l’autre soir, rue de Nesle, au théâtre de Nesle, assister à une représentation des Années Saint-Germain, spectacle musical joué chaque lundi.
Nous avons vu et entendu une femme sans voix chanter (?) quelques chansons sans risque : un Trenet, un Gainsbourg, deux Brel, trois Gréco (dont un Queneau et un Sartre), un Caussimon-Ferré, un Frères Jacques, un Vian, trois Prévert et quelques autres succès attendus. C’était un spectacle très décevant et artistiquement nul. Dans les citations obligatoires de la fin, on nous fit saluer de nos applaudissements la responsable de la mise en scène (pardon : la « mise en espace », novlangue oblige). Cette mise en scène consistait à aller de gauche à droite puis de droite à gauche avec, quelquefois, deux pas vers l’avant-scène et deux pas vers le fond de scène. Autres plaisirs : enfiler un imperméable rouge puis l’enlever, l’enfiler puis l’enlever, l’enfiler puis l’enlever. Enfin, s’asseoir sur un banc ou bien sur une chaise. La « mise en espace », c’était ça.
J’ajoute que cette plaisanterie durait une heure dix, mettons quinze avec les applaudissements, ce qui est vraiment, à vingt euros le tabouret de bois vaguement recouvert de feutrine noire usée, se ficher du monde.
Naïf comme je sais l’être, je m’attendais à un spectacle exigeant comme j’en ai vu beaucoup, heureusement, mais il y a longtemps, hélas. Je pense à cette grande fresque historique et chantée que j’avais pu apprécier un soir de 1982 à Nanterre. Une histoire de France par les chansons, qui s’arrêtait je crois à l’orée du XXe siècle. La seconde partie du spectacle devait aller jusqu’à nos jours mais ne fut jamais montée faute de subventions alors que la première avait connu un succès considérable. Il ne s’agissait pas d’une accumulation de chansons, d’un « filage » chronologique ; il existait une « mise en perspective », une « problématisation » (ah, ces mots !) et un coryphée, le diable. L’argument de la fresque était en effet que la chanson était une invention du diable et c’était Satan qui en racontait l’histoire, depuis les pont-neufs et les mazarinades. D’où le titre de cet excellent moment : Que diable nous chantez-vous là ?
On pourrait en citer d’autres, de ces spectacles musicaux ancrés dans l’histoire, par exemple En revenant de l’expo ou les premiers spectacles du théâtre du Campagnol.
Au lieu de cela, nous avons vu à Saint-Germain-des-Prés une façon de revue déstructurée et piteuse, animée par une chanteuse (?) inexistante qui, comme souvent, n’a pas pu résister au désir de conclure par une chanson de sa composition avec incitation du public à taper dans ses mains et descente obligatoire dans la salle. Cette fille n’a rigoureusement rien compris à Saint-Germain-des-Prés, ni à l’art de la présentation scénique qui devrait conduire à préférer l’épure au geste paraphrasant systématiquement le texte, ni à l’histoire de la chanson qui a toujours scandé celle des idées. Elle évoque un Saint-Germain qu’elle n’a pas connu puisqu’elle doit avoir approximativement mon âge et le caricature à l’extrême. C’est une fantaisiste, une Annie Cordy sans notoriété.
Heureusement, il y avait deux bons musiciens, dont l’excellent Roland Romanelli qu’on vit jadis en scène avec Barbara. Que venait-il faire là ? Les lumières étaient de Rouveyrollis qui a tendance, semble-t-il, à vendre son nom car elles n’avaient rien d’extraordinaire, c’était une série d’éclairages classiques : des pleins feux, du rouge, du bleu et une « poursuite » classique. Pas de quoi se pâmer.
Il n’y a pas tellement de Parisiens ici, juste quelques uns. Pour eux, donc : si vous me faites confiance, n’y allez pas. Surtout, n’accordez aucun crédit à la presse unanimement positive.
Un spectacle de Corinne Cousin mis en scène par Dominique Conte, interprété par Corinne Cousin accompagnée par Roland Romanelli et Raoul Duflot.
07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (7)
mardi, 06 décembre 2005
À classer
Durant trois ans, de 2001 à 2004, j’ai classé les archives de l’ancienne université de Paris, celle que 1968 fit exploser et que la loi Edgar-Faure de novembre 1968 transforma en treize universités pluri-disciplinaires. Ces documents remontaient au XIXe siècle et le classement a demandé quelques vingt années, je crois. Je me suis également occupé des archives de l’ancienne école normale supérieure de jeunes filles de Fontenay-aux-Roses, devenue par la suite Fontenay-Saint-Cloud puis ayant émigré à Lyon. J’ai encore trié quelques fonds divers et j’ajoute que j’ai, durant ces trois années, contracté une solide allergie à la poussière de stockage, ce qui, pour un amoureux du (vieux) papier, est cruel. Tout cela se passait au rectorat de Paris, dans les locaux de la Sorbonne. C’était un local de pré-archivage, les cartons, avec leurs répertoires, étant ensuite versés aux archives nationales, plus précisément au centre des archives contemporaines (CAC) de Fontainebleau. Les chercheurs en histoire de l’éducation disposent ainsi de fonds considérables dont l’intérêt est triple : historique, pédagogique et administratif.
Cela représente des millions de feuilles de papier, quelques dossiers passionnants, d’autres moins intéressants. Cela représente surtout, et c’est pour cela que j’en parle ici, un usage (en même temps qu’une utilisation) de l’écrit qui laisse rêveur. En effet, une large part de ces documents n’existerait plus aujourd’hui, l’usage du téléphone et, par la suite, d’internet ayant réduit considérablement la production d’écrits. Au moins sur ce plan : tout ce qui se règle par téléphone, par exemple, ne laisse plus de traces ; plus de lettres demandant un rendez-vous, de réponses l’accordant, plus de correspondance du type : « Pense à prendre ton parapluie car il pourrait pleuvoir » (j’exagère à dessein). Tout ce qui se traite par courrier électronique ne figurera plus désormais dans les archives, sauf à imprimer le moindre message, ce qui n’aurait pas de sens.
Les dossiers d’aujourd’hui, archives de demain, seront plus légers mais je me demande ce que trouveront les chercheurs. Il ne seront plus encombrés de lettres sans intérêt autre que leur charme désuet, mais ils auront devant eux des dossiers pratiquement vides. De plus en plus de choses se traitent numériquement et ne sont pas toujours conservées dans des disquettes ou dans des CD. Il y a toujours, dans l’administration de l’Éducation nationale, beaucoup de papier, certes, mais tout de même moins qu’autrefois, vraiment beaucoup moins. Surtout – est-ce une habitude, contractée, de l’éphémère ? – on ne le conserve plus systématiquement, comme on le faisait. Il ne viendrait plus à l’idée de personne, à présent, d’archiver pour l’éternité, notre dérisoire éternité, un dos d’enveloppe sur lequel on peut lire : « À classer ».
07:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (8)
lundi, 05 décembre 2005
Une constatation
On m’a souvent dit que ce blog était difficile, d’un niveau élevé, ce qui m’a toujours étonné. Je n’ai pas du tout cette impression. J’avais parlé de cela le 14 octobre dernier, dans une note (Quelque chose m’échappe) qui s’achevait ainsi : « Il y a ici, dans la mesure où j’ai pu avoir connaissance du métier de chacun, des professeurs de toutes disciplines (pas seulement de lettres), des éditeurs, des étudiants, d’anciens libraires, des philologues, des littéraires en général, des cinéphiles. Beaucoup de participants se piquent d’écrire. Et ce sont ceux-là qui me disent à moi, presque entièrement autodidacte, qu’il est ardu de se promener rue Franklin ? Par exemple ! Quelque chose m’échappe. »
Lorsque je regarde ce qui s’est produit les trois vendredis précédents, je m’amuse beaucoup. J’ai publié ces jours-là : un petit jeu portant sur des pseudonymes d’auteurs (Au royaume des pseudonymes) ; un autre jeu consacré aux métaphores « canines » existant dans la langue (Un chien vaut mieux que deux tu l’auras) ; un récit sans importance, particulièrement fantaisiste et pas réellement écrit (Au café du coin).
Ces trois notes n’étaient pas difficiles à lire, à comprendre, à commenter. Or, ce sont ces trois billets qui ont le moins intéressé les participants. Je m’en réjouis beaucoup, mais je ne comprends pas très bien.
10:05 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (12)
vendredi, 02 décembre 2005
Au café du coin
Comme tout le monde, je déjeune quelquefois avec des amis. Je dispose de peu de temps lors de la pause méridienne – ah, cette expression technocratique ! – et nous nous rendons par conséquent dans un petit café du boulevard de l’Hôpital, non loin de l’endroit où je travaille. C’est un établissement où l’on mange plutôt bien, pour peu d’argent ; qui plus est, la serveuse est aimable et la patronne jolie.
L’autre jour, Léonard de Vinci est venu partager avec moi un travers de porc arrosé de merlot. Il louchait un peu sur la serveuse et m’a fait confidence, le vin sans doute ayant produit quelque effet, de la forte impression que lui faisait ce qu’il nomma son « tambourin ». J’étais ennuyé car j’avais espéré de Vinci un propos plus élevé, mais demeurait en moi l’espoir de voir naître bientôt une nouvelle Joconde. Il faut ce qu’il faut. Léonard, cependant, a le don de se déclarer en retard et obligé de partir au moment de régler l’addition. Je m’y suis fait, il est si charmant le reste du temps.
J’ai coutume d’inviter Einstein, également. Si je passe sur le fait qu’invariablement, il salit sa moustache, je ne suis pas mécontent de pénétrer dans le restaurant en sa compagnie. Même sans merlot, l’effet est garanti. Il faut dire qu’il a de l’allure et que son visage attire la sympathie. Enfin, l’autre jour, je n’étais pas très tranquille, à le voir griffonner des formules de physique et de mathématiques sur la nappe en papier (avec lui, on ne sait jamais ce qui peut advenir), s’absorbant de plus en plus dans ses pensées tandis que Christelle – la taulière – lui demandait s’il désirait un café : « Et pour monsieur Albert ? », s’impatientait-elle, le pied nerveux tapant du talon.
L’autre jour, déjeunant avec l’Empereur, j’ai commis une bévue. J’avais purement et simplement oublié l’anniversaire d’Austerlitz. Napoléon en fut attristé et son humeur s’assombrit encore lorsque la serveuse lui déclara qu’elle n’avait plus de mousse au café, son dessert préféré. Il devait se dire que ce n’était pas son jour. « Sire, ai-je tenté, peut-être qu’une île flottante… » La gaffe ! L’Empereur ne supporte plus les allusions aux îles. Il crut que je me moquais… Il est parti furieux. Devant le café, Las Cases l’attendait, qui lui ouvrit, l’air digne, la portière arrière de sa Mercédès noire puis s’installa au volant.
Christelle a compris qu’elle ne devait rien proposer à Beethoven, puisqu’il n’entend pas. Elle dépose donc l’ardoise sur la table, sous son regard. Il choisit et clame le nom du plat, très fort. Christelle n’a pas besoin de noter la commande, le cuisinier l’entend depuis ses fourneaux : « Et une raie, une ! » Impossible, toutefois, d’obtenir du serveur, au bar, qu’il ne salue pas mon ami, lorsqu’il entre, d’un très machinal « M’sieur Ludwig ».
J’hésite, chaque fois que Verlaine me téléphone, à l’accepter comme commensal. Il est trop vite ivre, c’est ennuyeux, surtout pour ma réputation, l’ensemble des clients de l’endroit provenant de l’antenne de l’université implantée sur le trottoir d’en face ou de la grande école qui m’emploie. J’ai même coutume de dire « L’annexe » en parlant du restaurant. Mais quoi ! La conversation de Lélian est passionnante et, chaque fois, le bougre m’émeut considérablement. Il ne s’est jamais remis du départ de Mathilde, de ne plus tellement voir son fils Georges, de l’abandon de Rimbaud : la dernière fois qu’il l’a croisé, à Stuttgart, l’Ardennais l’a roué de coups, l’ingrat, le laissant pour mort sur le bord du chemin. Le décès de Lucien Létinois a ensuite abattu le pauvre Verlaine. Alors, mon Dieu, je le laisse boire plus que de raison.
Je soupçonne la serveuse d’avoir un faible pour Sartre. Sait-elle qu’il est déjà couvert de femmes ? Il faut dire qu’il est extrêmement généreux et laisse en pourboire l’équivalent du prix du repas. Il me confie : « Robert Gallimard trouve toujours que j’exagère. Il me dit que c’est trop. Mais pourquoi ? » Entre nous, je ne suis pas certain que Sartre trouve très correct le « Popaul » que lui donne Christelle, lorsqu’elle l’accueille. Il sourit à moitié lorsqu’elle se permet cette familiarité mais c’est dans la moitié manquante que je sens son désaccord. Comme il est très gentil, il ne dit rien. Tout en mangeant, il lit un ouvrage au titre compliqué. Il ne perd pas un mot de notre conversation. Au dessert, il la résume puis me parle en détail de l’ouvrage qu’il vient de lire. Bref, c’est Sartre. Une intelligence rare. Oui… Il boit trop, lui aussi.
À suivre
12:05 Publié dans Cour de récréation | Lien permanent | Commentaires (11)
Assez
S’il est une expression qui me répugne, c’est bien celle-ci. Elle me rend malade et pourtant, elle est de plus en plus employée, même à tort et à travers.
Comme un roman.
La correspondance de Truc se lit comme un roman. Ce traité se lit comme un roman. C’est insupportable et dévalorisant, à la fois pour le roman dont on laisse supposer qu’il se lit facilement (et je ne demande pas à un livre de se lire facilement ; je n’attends pas de lui qu’il soit nécessairement abscons, certes, mais je ne veux pas qu’il se lise facilement) ; mais aussi pour l’autre livre, celui qu’on compare à un roman, en laissant entendre qu’il se lira facilement (ah, cette sainte horreur que j’ai de la facilité) et qu’ainsi, le lecteur ne se fatiguera pas. Pauvre lecteur, qu’il faut chouchouter, assurer sans cesse qu’il n’aura pas trop d’efforts à faire. C’est lamentablement honteux, honteusement lamentable.
Je n’aime pas, je déteste, je hais, j’exècre, j’abhorre cette expression.
Et puis, il est des romans qui ne se lisent pas comme un roman. Ils demeurent exigeants et ne s’avalent pas. Qui les écrivit ? Oh, des gens sans importance, des auteurs de trois fois rien, Vailland, Mauriac, Hugo, Gary, Hemingway, Flaubert... De ceux-là, je veux bien lire des romans. Ou bien, si j’en crois l’ami Dominique Autié qui nous parle de lui, et pourquoi ne le croirais-je pas ?, Ramuz.
Autrefois, on disait « comme le journal ». Oh, ça se lit comme on lit le journal, ça. C’était dévalorisant pour les journaux, mais les journaux méritent d’être dévalorisés, ils n’étaient déjà pas très bons et ils sont tous devenus très mauvais, il faut bien le dire. Seulement voilà, aujourd’hui, on respecte la presse (alors qu’elle est nulle), on la craint, on n’ose plus dire du mal des journalistes, on les admire nécessairement. Alors, on dit « comme un roman ».
Je n’aime plus beaucoup les romans, on le sait. Nous en avons parlé ici. Mais si on les associe à la facilité – et, pourquoi pas, à la détente, à la distraction, au loisir, trois mots hideux – alors, c’est la fin.
07:00 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (17)


