lundi, 08 juillet 2013
Apollinaire et Ronsard
 Dans une lettre qu’il adressait à Louise de Coligny-Châtillon, sa chère « Lou », Apollinaire écrivait sans rire :
Dans une lettre qu’il adressait à Louise de Coligny-Châtillon, sa chère « Lou », Apollinaire écrivait sans rire :
Lorsque mon nom sera répandu sur la terre
En entendant nommé Guillaume Apollinaire
Tu diras « il m’aimait » Et t’enorgueilliras.
 On n’est évidemment pas loin de ce que soutenait le cher Ronsard, qui assénait avec un culot monstre :
On n’est évidemment pas loin de ce que soutenait le cher Ronsard, qui assénait avec un culot monstre :
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle.
Cette assurance des grands poètes quant à leur valeur, dont ils ont conscience, m’amuse toujours beaucoup, d’autant plus qu’ils y croient et ont raison d’y croire. Cela me rappelle cette brève note que j’avais écrite ici-même, à propos des conseils que donnaient les poètes aux femmes qu’ils voulaient entraîner vers l’abîme de leur couche.
16:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)
vendredi, 05 avril 2013
Quand Géo parle de Fleming
 Au début de l’été – mais la date n’est pas, je crois, précisément arrêtée – devrait paraître un numéro hors-série du magazine Géo, consacré à Bond. Il contiendra notamment un article spécialement dévolu à Ian Fleming. L’auteur, Léo Pajon, m’a téléphoné hier soir durant quarante minutes, c'était sympathique. À suivre.
Au début de l’été – mais la date n’est pas, je crois, précisément arrêtée – devrait paraître un numéro hors-série du magazine Géo, consacré à Bond. Il contiendra notamment un article spécialement dévolu à Ian Fleming. L’auteur, Léo Pajon, m’a téléphoné hier soir durant quarante minutes, c'était sympathique. À suivre.
12:02 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 25 mars 2013
Lettre à Jérôme Michel
Je pensais adresser cette lettre à Jérôme Michel aux bons soins des éditions Pierre-Guillaume de Roux, comme je le fais habituellement lorsque j’écris à un auteur que je viens de lire. J’ai pensé ensuite que, paradoxalement, le fait de la découvrir en ligne serait sans doute, pour lui, plus doux que de la trouver un jour dans son courrier.
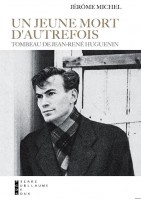
22 mars 2013.
Monsieur,
J’achève ce matin la lecture de votre Jeune mort d’autrefois.
Habituellement, lorsqu’on décide d’écrire à un auteur (je ne le fais pas souvent), c’est pour lui dire le plaisir qu’on a pris, l’intérêt qu’on a éprouvé à le lire. Cette lettre constituera une exception. Croyez bien, toutefois, que j’aurais préféré vous féliciter.
Le tombeau est un genre difficile. En premier lieu, il ne souffre pas la longueur et celui que vous avez composé est trop long, ce qui vous exposait à la redondance, à l’essoufflement, à la lassitude. Vous n’avez échappé à aucun de ces pièges. Votre Mauriac, déjà, m’avait lassé.
Votre style est plat, très plat, et lorsque vous risquez un trait que vous imaginez méprisant, une insolence, vous ne dépassez jamais la ridicule – parce que mesquine – perfidie. Ainsi, cette recherche d’Hemingway qui n’aboutit qu’à Sagan (p. 136). Voilà bien une vision ! L’opposition permanente : ou-ou. Eh bien, l’on peut aimer Hemingway et Sagan, sans pour cela (je devance votre objection probable) considérer que tout vaut tout. Loin de moi une telle idée. La vision et-et s’oppose à la vision ou-ou. Même si le premier détestait le second, on peut aimer, librement, Sartre et Mauriac. C’est mon cas. Vos piques permanentes contre Sartre sont grotesques.
Vous n’avez pas peur du cliché ni de la banalité la plus exténuante : « la lumière déclinante du soir » (p. 179) – cela vaut mieux que la lumière déclinante du matin, remarquez. Sérieusement, vous rendez-vous compte de ce que vous avez écrit là ? Clownesque ! Quant à citer Toulet (p. 174), évitez de donner son poème le plus connu, même s’il est admirable, et il l’est.
L’adoubement d’un jeune homme par Gracq et Mauriac ne suffit pas. Vous êtes parvenu à me dégoûter à jamais d’aller vers Huguenin. Sans doute, cela vous sera-t-il indifférent, mais je suppose que ce n’était tout de même pas votre but. Les extraits de La Côte sauvage (a-t-on vu titre plus banal ?) que vous citez m’ont paru d’un mortel ennui. Quant aux fragments du Journal que vous nous donnez à lire, quelle auto-complaisance de sa part ! Je sais bien qu’il était jeune, mais il est hors de question que j’en lise davantage. Je trouve que rater votre objectif à ce point constitue un échec considérable. Pourtant, vous avez bénéficié d’une édition propre, bien faite. Il y a fort peu de coquilles dans votre livre, qui est bien réalisé, bien imprimé. Ce n’est pas toujours le cas. Votre manuscrit a été relu, notez-vous dans les remerciements. Personne, donc, n’a su vous mettre en garde contre les défauts évidents de votre travail ? On n’a même pas, à vous lire, le sentiment d’une admiration, qui serait parfaitement légitime, même pour qui ne la comprendrait pas, pour Huguenin. Votre texte est si mauvais qu’au bout du compte, on se demande pourquoi vous aimez tant un écrivain que vous ne savez pas servir. Vous ne parvenez à le rendre humain que lorsqu’il prend la décision d’épouser la jeune femme qu’il aime. Il était temps. Avant la métamorphose de l’amour, qu’il n’est heureusement pas le premier à découvrir, il est tout simplement invivable, pour ne pas dire odieux. Si vous avez le sentiment d’être redevable à Huguenin, cela n’apparaît pas réellement. On peut trahir son modèle, mais il faut le faire avec talent.
Le lamentable portrait des soixante-huitards (je n’en suis pas) que vous brossez en fin d’ouvrage est tellement caricatural, et plein d’anachronismes, qu’il n’a plus aucune force, qu’il ne peut plus être considéré sérieusement. Et, mon Dieu, pourquoi vous – les suivants –, n’avez-vous pas inventé autre chose, puisque vos prédécesseurs avaient fait si mal, puisque leur action avait été si déplorable ? Je suis né en 1952, je suis dans ma soixante et unième année et j’ai le sentiment d’être plus jeune que vous. Ne comprenez-vous pas que c’est vous qui êtes vieux ?
Je trouve cependant une chose à sauver dans votre prose, pp. 180-181 : « paroisse morte et glacée gérée par des prêtres puritains en costumes anthracite servant la messe de la concurrence libre, saine et non faussée ». Parce que c’est exactement ça, très exactement. En cet endroit, le lecteur vous pardonne la tristesse, qui confine à l’amertume, de votre regard, puisqu’elle se justifie. Que n’avez-vous visé aussi juste en tous lieux !
Je ne vous aurais pas écrit si votre ton, si prétentieusement insupportable, ne m’avait convaincu qu’il n’y avait nulle raison de vous épargner. Écrire, c’est prendre des risques – vous serez d’accord avec cela, je le sais –, vous en avez pris. J’espère que vous accepterez ce retour. Votre personne n’est pas en cause, seul votre ouvrage l’est, et l’est beaucoup.
Il est bien entendu inutile de me répondre. Quand vous le souhaiteriez, votre lettre ne serait pas lue. Je ne désire pas aller plus avant et considère le sujet comme clos.
Je vous laisse à vos dérélictions et vous adresse mes sentiments littéraires.
Jacques Layani.
19:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 04 mars 2013
Bourrades
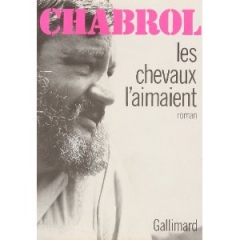 Je me souviens de Jean-Pierre Chabrol signant ses ouvrages à la fête du journal L’Humanité, à la Courneuve, en septembre 1972. Il me dédicace son roman, paru chez Gallimard, Les chevaux l’aimaient. Il note : « À Jacques Layani, avec une bourrade complice des vents rebelles ». Son écriture est à sa mesure : elle occupe la page entière. J’ai longtemps été très fier de cette dédicace. Quarante et un ans passèrent. La semaine dernière, j’avisai, vendu d’occasion chez Gibert, un autre exemplaire des Chevaux. Je l’ouvris et, l’espace d’un instant, me demandai ce que mon livre faisait là. Même écriture, évidemment, mais aussi même encre (un stylo-feutre bleu), pour cette dédicace, sans aucun doute rédigée le même jour : « À M. Untel, avec une bourrade complice de nos tramontanes rebelles ». Sacré Chabrol ! Je ne suis pas choqué, je comprends parfaitement qu’on s’autorise, lorsqu’on signe à tire-larigot, à écrire à peu près la même chose à chacun. Finalement, le plus étonnant est que, dans une agglomération de douze millions d’habitants, je tombe, moi, sur un livre revendu, porteur de ce texte de 1972, presque identique au mien, alors que nous sommes en 2013.
Je me souviens de Jean-Pierre Chabrol signant ses ouvrages à la fête du journal L’Humanité, à la Courneuve, en septembre 1972. Il me dédicace son roman, paru chez Gallimard, Les chevaux l’aimaient. Il note : « À Jacques Layani, avec une bourrade complice des vents rebelles ». Son écriture est à sa mesure : elle occupe la page entière. J’ai longtemps été très fier de cette dédicace. Quarante et un ans passèrent. La semaine dernière, j’avisai, vendu d’occasion chez Gibert, un autre exemplaire des Chevaux. Je l’ouvris et, l’espace d’un instant, me demandai ce que mon livre faisait là. Même écriture, évidemment, mais aussi même encre (un stylo-feutre bleu), pour cette dédicace, sans aucun doute rédigée le même jour : « À M. Untel, avec une bourrade complice de nos tramontanes rebelles ». Sacré Chabrol ! Je ne suis pas choqué, je comprends parfaitement qu’on s’autorise, lorsqu’on signe à tire-larigot, à écrire à peu près la même chose à chacun. Finalement, le plus étonnant est que, dans une agglomération de douze millions d’habitants, je tombe, moi, sur un livre revendu, porteur de ce texte de 1972, presque identique au mien, alors que nous sommes en 2013.
10:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 14 avril 2012
Gide en ses carnets
 Pour l’anniversaire de la collection « Folio » (quarante ans), le Journal de Gide a paru sous une jaquette spéciale. Il s’agit uniquement d’une anthologie, hélas difficilement lisible dans cette édition, compte tenu de ma vue, mais il n’existe que la Pléiade ou ça, ce texte n’étant pas, à ce jour, disponible autrement.
Pour l’anniversaire de la collection « Folio » (quarante ans), le Journal de Gide a paru sous une jaquette spéciale. Il s’agit uniquement d’une anthologie, hélas difficilement lisible dans cette édition, compte tenu de ma vue, mais il n’existe que la Pléiade ou ça, ce texte n’étant pas, à ce jour, disponible autrement.
Dans ses carnets, Gide raconte cette soirée de 1943 où, à Alger, il a dîné avec de Gaulle. J’aurais aimé que la relation qu’il fit de ce moment peu fréquent – la rencontre de deux hommes comme eux, mon Dieu ! – soit plus longue. Dommage. Voilà le genre de soirée que j’aurais aimé vivre : un dîner avec le Général et Gide…
Il est vraiment merveilleux lorsqu’il narre un moment passé avec tel ou tel littérateur. Par exemple, deux rencontres successives avec Claudel sont magnifiquement résumées, parfaitement peintes, c’est une gourmandise pour l’intelligence. On en redemande. Je lui en veux donc d’autant plus d’avoir écrit, dans sa jeunesse : « Visite à Verlaine », point final. Le bougre n’aurait-il pu nous faire un croquis sur le vif du poète alité à l’hôpital Broussais ?
Voici encore une belle peinture de Claudel, le récit d’une rencontre avec Paul Bourget, celui d’une visite à Proust. Toujours passionnants, ces portraits paraissent trop brefs à mes désirs de délices. Gide aurait dû écrire des volumes entiers sur ses contemporains. Ce n’aurait pas été au détriment de son œuvre, puisque c’eût été une part de celle-ci, justement.
Et puis, qui est fort amusant : l’expression « rien plus », d’usage courant dans le Lot où nous séjournons souvent, Martine et moi, je la retrouve, par deux fois, sous sa plume. Nous n’y verrons donc plus une faute de langue (attestée par Gide, même une erreur voguerait vers le beau). Au vrai, il ne s’agit pas d’une erreur, pas du tout, mais d’une forme ancienne devenue, en Quercy, une manière fréquente.
18:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 16 mars 2012
Une histoire dessinée authentique
 L’Hiver du dessinateur est une bande dessinée traduite de l’espagnol (catalan), parue chez Rackham, qui a cet avantage de narrer une histoire rigoureusement authentique, celle d’un groupe de dessinateurs célèbres qui voulurent, dans les années 50, quitter leur éditeur trop conformiste et qui les exploitait, pour fonder un magazine à eux, en auto-édition. Cela n’a pas marché et ils sont revenus dans le giron de leur maison d’origine. La présence du franquisme est constante. Le livre est documenté et des annexes expliquent qui étaient (sont encore, pour certains d’entre eux) ces personnes.
L’Hiver du dessinateur est une bande dessinée traduite de l’espagnol (catalan), parue chez Rackham, qui a cet avantage de narrer une histoire rigoureusement authentique, celle d’un groupe de dessinateurs célèbres qui voulurent, dans les années 50, quitter leur éditeur trop conformiste et qui les exploitait, pour fonder un magazine à eux, en auto-édition. Cela n’a pas marché et ils sont revenus dans le giron de leur maison d’origine. La présence du franquisme est constante. Le livre est documenté et des annexes expliquent qui étaient (sont encore, pour certains d’entre eux) ces personnes.
Je suis heureux d’avoir découvert, dans le même temps, un dessinateur et un fragment d’histoire de la bande dessinée ibérique. Par ailleurs, l’ouvrage est beau (c’est un 17 x 24 cm, proche de mon cher 18 x 24 cm), cousu, avec une couverture à rabats, et les cahiers sont de différentes couleurs, selon les périodes de l’histoire racontée. La chronologie est d’ailleurs bousculée, c’est un choix narratif, l’esprit du lecteur devant rétablir et y parvenant.
Je lis sur le site de l’éditeur : « L’Hiver du dessinateur est l’histoire d’un combat pour la dignité et la liberté ; une bataille perdue par un petit groupe d’artistes qui se battent pour être maîtres de leurs choix, de leurs œuvres et de leur destin ». J’ai bien fait d’acheter ce livre. L’auteur se nomme Paco Roca. Il est né à Valence en 1969.
17:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 09 mai 2011
Le taulier se manifeste

Quarante ans après sa disparition prématurée, le portrait d'un professeur inoubliable. Un personnage que de nombreux témoignages montrent admiré ou rejeté ; des documents retrouvés ; la peinture d'un quartier ; le lycée Victor-Hugo de Marseille ; soit, en filigrane, le « roman », entièrement authentique, d'une génération.
Voici ce que dit la quatrième de couverture, en un texte honnête, qui décrit, sans exagérer, le contenu de l’ouvrage. C'est moi qui l’ai rédigé : c’est un exercice que je n’aime pas, mais au moins, le résultat n’est pas outrancier.
« Jean-Marie Girardey était professeur de lettres au lycée Victor-Hugo, à Marseille. Personnage hors du commun, il est décédé accidentellement dans sa trente-septième année.
Jacques Layani, qui fut son élève en classes de première et terminale, témoigne ici, dans une écriture à la fois précise et évocatrice, de l’affection admirative qu’il n’a jamais cessé de lui vouer. En même temps qu’un portrait, voici le journal de la recherche sans fin, menée par l’auteur, pour retrouver les traces d’un homme résolument différent. Un jeu de piste, voire une enquête, dont, quelquefois, les résultats sont inattendus.
Grand joueur d’échecs, Jean-Marie Girardey exerçait dans ce domaine plusieurs responsabilités. Cet aspect est traité au travers de passionnants documents d’archives.
De nombreux souvenirs d’anciens élèves, de collègues enseignants ou de mères, apportent à cet ouvrage la richesse de regards autres. Ces multiples témoignages fondent un récit aux mille facettes, toujours rigoureusement authentique.
Enfin, quelques brefs écrits du professeur ont été regroupés dans ce volume. Entre autres, un traité de dissertation, des énoncés d’exercices et un choix d’appréciations exprimées dans un registre fort personnel.
Quarante ans après sa disparition, ces textes étonnent encore. »
15:28 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 03 novembre 2008
Les curieuses réactions des critiques
Voilà encore un article curieux publié sur la Toile, à propos de mon Fleming. À première vue, il est peu favorable. À la seconde lecture, il l’est davantage. Mais ce n’est pas là ce qui m’étonne.
On évoque mon « ton légèrement pontifiant », mais j’ai l’habitude. C’est un des premiers reproches qu’on me fait, quel que soit le sujet. Je ne sais pas très bien pourquoi. Quand on me connaît, on comprend que ce n’est pas du tout le cas ; c’est uniquement ma façon d’être sérieux et rigoureux qui donne au lecteur cette impression.
On dit que je me montre « fort de [m]on statut de pionnier hexagonal ». Du diable si j’ai eu ce sentiment, en composant ce livre. Effectivement, il n’y a pas d’équivalent sur ce sujet en langue française, mais je n’avais pas l’impression de concourir pour un titre quelconque. Je ne suis le premier que par hasard.
On parle d’ « une énorme erreur factuelle ». Je ne comprends pas pourquoi. J’ai vérifié le passage incriminé et n’ai pas trouvé d’erreur. Ce que relève le critique, je l’ai dit. J’admets bien volontiers l’avoir dit trop légèrement, trop succinctement, mais je ne vois toujours pas où est l’erreur factuelle.
On assure que j’ai « un intérêt limité pour les prolongements de l’œuvre littéraire de Fleming » : c’est exact et comme mon sujet était ailleurs, je ne vois pas pourquoi j’aurais poursuivi dans cette voie. Ce n’est pas la première fois qu’on m’oppose ce raisonnement curieux, qui consiste à contester non pas la façon dont j’ai pu traiter mon sujet, ce qui serait légitime, mais le sujet lui-même. En résumé, cela donne : « Vous avez traité tel sujet, soit. Mais pourquoi n’avez-vous pas plutôt traité tel autre ? » Eh, c’est parce que tel autre n’était pas à l’ordre du jour. Les éditeurs me font très souvent ce coup-là : je n’oublierai jamais cette fois où, proposant le projet de ma vie d’Albertine Sarrazin, je m’entendis demander d’écrire plutôt une biographie de Raymond Devos. Je dois à l’honnêteté de dire que l’éditeur en question accepta tout de même le livre sur Albertine et que, sept ans plus tard, c’est aussi lui qui publia celui consacré à Fleming. Il n’en demeure pas moins que cette réaction me laisse toujours sans voix.
Je m’attarde « complaisamment sur des questions de traduction qui pourraient être réglées en deux pages ». Ça alors ! Justement, le but de ce chapitre, intitulé « Questions de traduction », était précisément de détailler le plus possible les problèmes rencontrés par Fleming lorsqu’on a établi les premières versions françaises de ses œuvres. Je commence cet examen en disant qu’on ne peut évoquer des livres traduits comme s’ils avaient été rédigés directement en français et que, par conséquent, il importe d’y aller voir de plus près. Si je m’étais écouté, ce chapitre eût été encore plus long ! Rien à faire, un autre critique recommandait aux lecteurs de sauter ces passages. Celui-ci voudrait les réduire à deux pages. Il insiste : « Faut-il se pencher à ce point-là sur des éditions françaises des années soixante que le pékin moyen ne risque absolument pas de trouver aujourd’hui en librairie et dont le seul intérêt est l’absolue kitschitude ? » Passons sur le « pékin moyen » que je trouve bien méprisant (le critique est professeur de classes préparatoires et reste élitiste) quand il aurait pu dire « le lecteur », tout simplement. Il reste que les éditions « kitsch » et extrêmement fautives dont il est question sont toujours disponibles sur les sites de vente d’ouvrages d’occasion, où elles sont présentées comme des traductions originales et des objets de collection, très précieux. Il convenait donc de mettre en garde le lecteur, précisément.
« Il oublie peut-être le plus important, à savoir le statut mythique de James Bond », poursuit l’auteur de l’article. Des livres sur le mythe, il en existe de nombreux, dont le dernier vient à peine de paraître. Le mythe n’était pas mon propos, mais comment faire comprendre que je ne désire traiter que mon sujet et rien d’autre ?
16:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 28 octobre 2008
Sauter des pages
Aujourd’hui, et toujours sur internet, un des seuls véritables articles concernant le Fleming. C’est-à-dire un texte qui ne se contente pas de reprendre le communiqué de presse ou la quatrième de couverture. Comme chaque fois, ce qu’on me reproche, c’est ce que je suis, ce qui est moi, ce qui, dans le livre, est du Layani pur et simple. Une façon de voir les choses, de les affirmer en les étayant, de creuser des situations, d’analyser, de donner un point de vue détaillé. Voilà que, pour la première fois, le plumitif de service recommande à ses lecteurs de sauter purement et simplement certains passages au motif qu’ils seraient trop ardus – ces mêmes passages auxquels, évidemment, j’ai apporté le plus de soin, le plus de rigueur, pensant qu’ils étaient infiniment nécessaires et ne désirant qu’une chose : partager ce que je savais ou découvrais au fur et à mesure de mon travail. Bien sûr, tout cela n’a aucune importance.
14:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 13 octobre 2008
Des lettres inédites
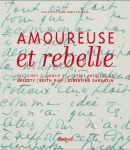 Je signale la parution du livre collectif Amoureuse et rebelle aux éditions Textuel. Ce sont des lettres inédites d’Artletty, Édith Piaf et Albertine Sarrazin, présentées par des personnes considérées comme spécialistes, y compris, en ce qui concerne Albertine, l’immonde taulier.
Je signale la parution du livre collectif Amoureuse et rebelle aux éditions Textuel. Ce sont des lettres inédites d’Artletty, Édith Piaf et Albertine Sarrazin, présentées par des personnes considérées comme spécialistes, y compris, en ce qui concerne Albertine, l’immonde taulier.
C’est un beau volume de grand format, sur papier fort et teinté, en quadrichromie, avec jaquette et signet. Il ne coûte que cinquante euros. J’ai été agacé, en le regardant en détail, de constater qu’un certain nombre d’erreurs de transcription demeurent. Pourtant, l’écriture d’Albertine est parfaitement lisible.
J’ai été amené à participer à cette réalisation par un message reçu cet été, dans lequel on me demandait de remplacer Jean-Jacques Pauvert au pied levé. Il avait paraît-il donné mon nom, en se retirant du projet. Naturellement, c’était urgent. Les transcriptions qui m’ont été communiquées au mois de juillet comprenaient de nombreuses erreurs, que j’avais rectifiées au lu des fac-similés des lettres originales. Je m’aperçois, hélas trop tard, que des fautes ont subsisté : non seulement des coquilles, mais – c’est plus grave – quelques mots mal lus, qui annulent partiellement le sens de certaines phrases. Il est toujours ennuyeux de prendre les choses en marche. Je pense que j’aurais pu éviter bien des bêtises en transcrivant moi-même les lettres dès le départ. C’est dommage. Mais enfin, dans l’ensemble, ce bel album vaut d’être lu.
11:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 11 octobre 2008
L’entretien du siècle
S’il vous plaît de voir et d’entendre le taulier, plus horrible que jamais, répondre stupidement à une bête interview à propos de son livre consacré à Fleming, c’est ici. Rassurez-vous, cela ne dure que six minutes.
23:31 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 01 octobre 2008
Encore un coup du taulier

Cet ouvrage, parfaitement inutile, sera en librairie dans quelques jours. Je vous déconseille formellement sa lecture, qui vous ferait perdre votre temps.
11:47 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 24 septembre 2008
En longue préparation
Dans le catalogue 2008 de la collection « La Pléiade », que j’ai pris chez Gibert simplement parce qu’un beau portrait de Breton figurait en couverture, j’observe que le second tome des Essais de Montherlant est toujours « en préparation ». Cela fait quelques vingt-cinq ans que je l’attends. À dire vrai, je ne l’attends plus. Tant pis.
Je sais bien que ces volumes sont de référence et qu’une édition comme celle-là doit être préparée longuement et scrupuleusement, d’autant qu’elle fera autorité durant des années, parfois des décennies. Tout de même, quel sens cela a-t-il de préparer une édition durant un quart de siècle ? Pour qui travaille-t-on ? Pour les enfants des lecteurs ? Pourquoi pas leurs petits enfants ? Il n’est pas de raison de s’arrêter, après tout… Certes, « la science peut attendre », comme on dit. Jusqu’à quand ? La lenteur éditoriale est-elle forcément gage de qualité ?
15:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 08 septembre 2008
Des demandes étonnantes
Je reçois, à intervalles réguliers, par téléphone ou par courrier électronique (plus jamais par voie postale), des demandes de journalistes, d’étudiants, portant sur telle ou telle personnalité à qui j’ai pu quelque jour consacrer un travail. Le plus curieux est que cela ne prévient pas, ça arrive ainsi ; c’est la plupart du temps lié à l’actualité, quelquefois pas.
Cet été, j’étais, lors de la commande reçue de Textuel, plongé dans l’univers d’Albertine Sarrazin, mais attendant également des nouvelles d’Écriture à propos de Ian Fleming. Le téléphone sonne, m’apportant des questions d’une pigiste sur Léo Ferré. Aujourd’hui, je suis dans l’attente d’ultimes détails concernant le livre consacré à Fleming ; et le téléphone me présente des demandes concernant Albertine Sarrazin. Quelquefois, on m’interroge à propos de Maurice Pons, bien plus rarement hélas sur Vailland. D’autres fois, je suis sollicité pour des colloques, comme, récemment, celui qui sera l’an prochain consacré à Madeleine Bourdouxhe.
C’est curieux. Peut-être très naturel mais, pour moi, fort étonnant. Je ne me suis jamais dit spécialiste de tous ces auteurs. J’ai proposé des études les concernant, mais cela ne signifie pas nécessairement que je sois le plus à même de répondre aux demandes. S’il suffit de mettre en librairie un ouvrage pour aussitôt, des décennies durant, s’entendre poser des questions (parfois pointues), alors je serai bientôt un correspondant attitré en ce qui concerne Fleming.
J’aurais mauvaise grâce à dire que cela m’ennuie. Je ne suis pas mécontent de recevoir ces questionnaires. Simplement, cela me surprend beaucoup, et je n’en rajoute pas.
16:03 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 14 juin 2008
La goutte de Giono
Les recueils toujours les moins intéressants sont ceux qui regroupent une correspondance familiale. Celle de Giono, par exemple, publiée sous le beau titre J’ai ce que j’ai donné, n’a presque aucun intérêt si l’on ne désire pas lire (en tout cas pas durant plus de deux-cents pages) ce que l’auteur a mangé, quand il a eu une crise de goutte ou mal aux dents, combien il a versé à la banque ou touché pour tel article. Ce n’est vraiment pas lisible, quelque amitié qu’on ait pour l’auteur, quelque goût qu’on puisse avoir pour les chroniques intimes. Les éditeurs vendent ces livres sur le nom de l’écrivain qui, on le lui reconnaît volontiers, n’avait pas rédigé ces missives dans un but de publication. Les nouvelles qu’il donne de sa santé ou du temps qu’il fait à Manosque – dans un style d’ailleurs particulièrement plat – intéressaient très certainement et très légitimement son épouse et ses filles (la quasi totalité du volume est faite de lettres à elles adressées) mais ne sauraient nous retenir aujourd’hui. On note que même le voyage qu’il effectue en Angleterre et en Écosse ne lui inspire qu’une série de banalités un peu redondantes. Giono, certainement, réservait son génie à ses livres et ne jugeait pas utile d’en faire don et grâce aux siens. Sa tendresse est souvent mièvre. Demeure donc un recueil très anecdotique qui ne vaut que par l’attachement sentimental qu’on peut avoir pour une grande plume et l’on sourit miséricordieusement de la voir se traîner dans les eaux familières d’une expression plus que commune.
19:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 12 juin 2008
Je ne sais pas où est Rungis
Saura-t-on jamais réellement comment naissent les livres ? Non sur le papier, au bout des chemins inquiétants, dans les pierriers du travail obstiné, mais dans la tête des auteurs ? Je dirai quelque jour en détail le cheminement qui aboutit à ma vie d’Albertine Sarrazin ou à ma vie et œuvre de Ian Fleming, entre autres. Que se passe-t-il pour que surgissent à la cinquantaine et bien au-delà des livres fondés sur des lectures faites des décennies plus tôt ? Pourquoi ces lectures donnent-elles naissance à des travaux quand d’autres ne le font pas ? Quel peut donc être le curieux fonctionnement de nos engouements pour les découvertes d’autrefois ? Pourquoi certaines réminiscences ou redécouvertes donnent-elles la clef de livres complets quand d’autres n’aboutissent qu’à des textes de quelques pages (mon Guimard, mon Vailland) ? Comment certaines joies nouvelles n’autorisent-elles qu’un commentaire réduit (mon Bourdouxhe) ou moyennement long (mon Pons) ? Je ne sais pas pourquoi certaines œuvres, elles, suscitent des travaux sans fin (mes cinq Ferré, trois parus, deux en chantier – pour ne parler que des livres parmi tout ce que je lui ai consacré). Je ne sais pas grand-chose du mystère de la création, quand je me frotte à lui pratiquement depuis toujours. Je ne saurais dire si c’est décourageant ou non puisque, le plus souvent, j’accepte sans discuter cet état de choses. Mais lorsque j’y pense réellement, cela m’intrigue. Alors, je prends quelques notes comme ici mais, bien vite, je tourne en rond. Sans doute ne saurai-je jamais rien de tout cela. Et puis, quelle dépense d’énergie que d’y réfléchir trop longtemps ! Il y a mieux à faire – par exemple, écrire des livres. Je suis né pour cela, c’est ce que je fais le moins mal et, de toute façon, cela me permet de respirer et de sortir mes pieds minables du peu héroïque mal de vivre dans lequel ils s’enfoncent en dépit de mes tentatives désespérées pour avancer. Je suis un arbre à livres, rien n’y fera jamais, je donne des fruits non traités, non calibrés, becquetés par les oiseaux, véreux parfois – mais ce sont des fruits libres. Pas des fruits collabos, prêts à sacrifier l’authenticité à l’apparence, jusqu’à paraître lustrés et peut-être en plastique.
Si je devais rédiger des ouvrages dans chacun des domaines qui m’intéressent, en admettant que j’en sois capable, il me faudrait plusieurs vies et une santé d’airain. Cela ajoute une interrogation au boisseau des précédentes. Pourquoi, dans ces conditions, ai-je été amené à composer sur tel sujet plutôt que sur tel autre ? Je suis incapable de répondre à cette question qui n’est cependant pas sans importance. Est-ce parce que, dans sa prudence, l’inconscient fait le tri et, connaissant la brièveté de tout, impose les recherches les plus immédiatement nécessaires, les plus authentiquement proches, reliées à notre essence même ? Je l’ignore mais il doit y avoir de cela, cependant. Pourtant, en posant ainsi le problème, j’écarte d’emblée la solution la plus simple, celle qui consiste à dire qu’on met en chantier ce que nous imposent les circonstances : si telle recherche indispensable à un travail m’est à un moment donné impossible, je n’effectuerai pas cette besogne ou bien, je modifierai le projet, le redessinerai, en ferai quelque chose d’autre afin de contourner l’obstacle. Je crois néanmoins que les réponses simples le sont trop. Les circonstances, si elles font le dessin du présent, n’exécutent en revanche aucun dessein. Elles n’ont d’importance que factuelle et, oserai-je l’écrire, circonstancielle. Plus sérieusement, il doit y avoir un faisceau de causes « faisant que », comme il est certainement une raison pour que je cherche ici ces réponses impossibles quand approche minuit et qu’il est, là aussi, autre chose à faire.
À tout cela s’ajoute cette interrogation : qu’aurais-je donné à lire si j’avais pu disposer de ma vie complète, sans avoir à la gagner (ce qui, comme chacun sait, aboutit à la perdre) ? Aurais-je fait davantage de livres ? N’en aurais-je écrit que peu, mais bien plus forts ? Je ne le saurai jamais. Serais-je allé plus vite pour les mener à bien ? Auraient-ils été publiés plus tôt ? Il ne convient pas de remuer le destin a posteriori ; mieux vaut le laisser dormir, même s’il parle en dormant et par là nous dérange. À dix-sept ans, à vingt-et-un ans, j’écrivais beaucoup et très vite, vraiment très vite : tout était mauvais, exécrable quelquefois. Cette étape était sans doute indispensable, mais je ne sais pas plus aujourd’hui le pourquoi du travail d’écriture, la raison du « déclic », la manœuvre de quel interrupteur pour allumer quelle lampe. Il est curieux de devoir admettre que notre action est étayée par l’ignorance. Dans n’importe quel domaine de l’activité des hommes, on s’appuie, pour agir, sur la connaissance, l’étude. S’agissant du travail littéraire, on avance à l’aveugle, pétri d’une certitude unique, celle de ne pas comprendre grand-chose à ce qui nous meut. Quelle autre machine fonctionnerait sans qu’on connaisse sa source d’énergie, sans qu’on sache comment l’approvisionner en un carburant quelconque ? Le pire est que cet exercice de funambule a su aboutir à quelques chefs-d’œuvre qui réjouiront l’humanité dans de nombreux siècles encore.
Je vends aux autres ce que je mange moi-même, ce dont quotidiennement je me nourris. Je ne garde pas pour moi, dans ma cave, mon meilleur vin. Je ne fais pas de livres des halles mais des ouvrages de petit producteur. Je ne sais pas où est Rungis.
12:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 05 mai 2008
Vingt ans passent vite
Chez Corti où j’étais allé acheter les deux livres de Gracq que je ne possédais pas encore, je risquai une question sur les inédits que tous les auteurs possèdent inévitablement. Pouvait-on espérer une publication ? Son éditrice me répondit très aimablement que Gracq avait, par testament, rigoureusement interdit toute publication de ses inédits jusqu’à vingt ans après son décès – et que, par conséquent, il me faudrait revenir en 2027. Elle m’encouragea en m’assurant, avec un beau et amical sourire, que vingt ans passaient vite. Plus sérieusement, il se trouve que Gracq avait voulu empêcher toute exploitation éditoriale de son œuvre dans un but commercial, sachant combien, de nos jours, la mort augmente considérablement la valeur marchande. Vingt ans, avait-il pensé, sauraient faire le tri et laisser voir si persistait un intérêt pour son œuvre.
Je hasardai une autre interrogation : existait-il une correspondance ? On m’assura que non, qu’il n’était pas homme à cela, qu’on ne pourrait vraisemblablement trouver que de brèves missives à l’image de celles qu’il envoyait à ses éditeurs, lettres qui n’avaient d’autre intérêt que de régler une question pratique immédiate.
21:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (5)
jeudi, 14 février 2008
Encore
L’horrible taulier doit encore avouer une de ses turpitudes. Le quinzième tome de ses œuvres complètes paraîtra aux éditions Rhubarbe. Il s’agira d’un recueil de nouvelles, Des journées insolites. Mais vous avez le temps de vous remettre de vos émotions. Cette publication ne se fera qu’en 2010.
22:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (8)
vendredi, 08 février 2008
Avis aux promeneurs
 Il se confirme qu’un colloque consacré à l’œuvre de la romancière belge Madeleine Bourdouxhe se tiendra à Paris, en mars 2009, au Centre culturel Wallonie-Bruxelles. C’est dans plus d’un an, on en reparlera certainement ici. Le fichu taulier, qui n’en rate décidément pas une, devrait, en principe, y participer, comme cela lui a été demandé.
Il se confirme qu’un colloque consacré à l’œuvre de la romancière belge Madeleine Bourdouxhe se tiendra à Paris, en mars 2009, au Centre culturel Wallonie-Bruxelles. C’est dans plus d’un an, on en reparlera certainement ici. Le fichu taulier, qui n’en rate décidément pas une, devrait, en principe, y participer, comme cela lui a été demandé.
11:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3)
mercredi, 05 septembre 2007
Simenon et moi
Je n’aime pas Simenon. J’ai beau faire, j’ai beau essayer, je n’aime pas Simenon.
J’ai lu des romans, des Maigret et des non-Maigret. J’ai tenté de lire sa biographie, je dis : tenté seulement parce que la grâce légendaire d’Assouline eut vite fait de me dégoûter de ce qui, au préalable, ne m’emballait guère, de toute façon. J’ai lu les souvenirs, charabia compris, de son ancienne épouse Tigy. J’ai lu le bel album qui lui a été consacré dans la collection « Passion ». J’ai lu la correspondance qu’il échangea avec Gide : heureusement, il y avait Gide.
Cependant, mon honnêteté légendaire m’oblige à dire que les films inspirés de son œuvre, en général, m’ont séduit ; que le bonhomme Simenon m’avait paru intéressant et humain lorsqu’un DVD coédité par Gallimard et l’INA apporta chez moi son image et sa voix, dans un Apostrophes à lui consacré, autrefois, par Pivot. Il me parut même plutôt sympathique.
Cet été, j’ai donc fait une nouvelle tentative : Maigret chez le ministre, roman datant de 1954, rédigé dans le Connecticut, acheté trois euros au marché aux livres de la rue Brancion par Martine avant le départ, dans une réédition de 1974. J’y ai trouvé des anglicismes, du charabia, des fautes de langue et des ficelles honteusement tirées. À propos de tirer, on tirait aussi à la ligne. Astuce habituelle, qui me fait enrager : on fait avancer l’action à coups de dialogue. Ça évite d’écrire… Et ça dure des pages et des pages. Double astuce, le dialogue rapportant un dialogue antérieur. Et vas-y que je te pousse : par des jeux de tirets et de guillemets, on remplit ainsi des pages d’où toute rédaction est absente.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (18)
vendredi, 20 avril 2007
Un visage de la critique vaillandienne
Les Cahiers Roger-Vailland viennent de publier une recension des articles de presse écrits lors de la parution des romans de Vailland. Il s’agit d’un premier tome, l’autre étant malheureusement reporté à 2008 au moins, on se demande bien pourquoi. L’intérêt d’un tel travail était précisément, en premier lieu, de tenir en un seul volume. Surtout, on s’est encore et toujours limité aux romans, soit neuf (magnifiques) livres sur une bibliographie de plusieurs dizaines de titres, recouvrant à peu près tous les genres habituellement reconnus. Ces deux erreurs sont fondamentales, à mon avis.
Ce qui est à relever, dans ce panorama de la réception des œuvres (romanesques) de Vailland, c’est que, presque systématiquement, et peut-être même systématiquement, les auteurs commencent par raconter l’histoire. On observe qu’il s’agit de billets beaucoup plus longs que ceux qu’on peut lire aujourd’hui. Une critique littéraire, entre 1945 et 1955 puisque ces dates bornent ce tome premier, compte environ trois fois plus de texte qu’aujourd’hui. Elle procède ainsi : introduction sur un ton personnel, souvent ironique ou distancié, exposé de l’intrigue, considérations sur l’engagement politique et social de l’écrivain, défauts et qualités, regrets, souhaits, conclusion sur un ton personnel, souvent ironique ou distancié, le plus souvent soit admiratif, soit admiratif en dépit de. Incroyablement, le schéma est grosso modo le même d’un article à l’autre, au fil de onze années de recensions portant, toujours en ce qui concerne le tome un, sur six livres. Pourtant, les textes sont donnés in extenso (c’était bien la moindre des choses) et les regards souvent très différents. Les auteurs sont Maurice Nadeau, Claude Roy, Marcel Arland, René Lalou, Louis Parrot, Émile Henriot, Claude-Edmonde Magny, Thierry Maulnier, Pierre Courtade, Eugène Ionesco, Roger Stéphane, Luc Decaunes, Roger Nimier, Jean Duvignaud, Louis-Martin Chauffier, Robert Kanters, André Wurmser, Kléber Haedens, François Nourrissier, Claude Mauriac, Jean Blanzat, Antoine Blondin, Henri Lefebvre et quelques autres, soit le gratin de la critique du moment. Eh bien, dans l’ensemble, les méthodes, l’exposé, sont les mêmes, au moins sur le plan technique. Comme s’il était fatal que des époques entraînent des modes de pensée, des comportements induits. Alors que le découpage de ce Cahier Vailland est parfaitement arbitraire et, à mon avis, sot au possible. Déjà, isoler la réception des romans de celle des autres livres est un non-sens. Ensuite, considérer que Vailland, publiant Drôle de jeu en 1945 et mourant en 1965, a une vie littéraire de vingt années (alors que les parutions posthumes continuent aujourd’hui), c’est idiot. Décider de couper purement et simplement en deux cette période de vingt années, c’est consternant. Effectuer cette coupure systématique juste avant La Loi, c’est-à-dire le Goncourt pour 1957, c’est-à-dire avant le désintéressement (trop affirmé pour être réel) de l’écrivain, c’est condamnable. Réduire la recension des dix dernières années aux trois romans qui demeurent les plus mal compris (La Loi, La Fête et La Truite) et renvoyer à l’année prochaine cette parution complémentaire, c’est suicidaire.
En dépit de cela (et c’est beaucoup), on observe donc des constantes, comme je l’ai dit, dans l’attitude critique. C’est encore ce qui m’étonne le plus dans ce relevé interrompu. Ces articles ne disent pas que des sottises, certes non, même quand ils sont peu favorables aux ouvrages retenus. Mais ils le disent tous sur la même lancée, dans un schéma presque scolaire, quelque chose d’obligatoire, de convenu. On s’étonne rétrospectivement. On se demande si, vraiment, l’audace d’une critique peut-être pas plus intelligente mais simplement différente, était impossible. Et cela nous rappelle, si nous l’avions oublié, combien la société d’avant 1968 était calibrée, corsetée, définie, arrêtée, établie et, pensait-on, définitive parce qu’incontestable.
On terminera sur une constatation : autrefois comme aujourd’hui, Maurice Nadeau écrivait comme un pied.
16:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 06 février 2007
Persiste et signe
 L’horrible taulier prie les patients promeneurs de la rue Franklin de bien vouloir l’excuser d’annoncer la parution du treizième tome de ses inénarrables œuvres complètes, un ensemble de nouvelles intitulé Le Château d’utopie, aux éditions D’un noir si bleu. Il ne peut même pas promettre qu’il ne le fera plus.
L’horrible taulier prie les patients promeneurs de la rue Franklin de bien vouloir l’excuser d’annoncer la parution du treizième tome de ses inénarrables œuvres complètes, un ensemble de nouvelles intitulé Le Château d’utopie, aux éditions D’un noir si bleu. Il ne peut même pas promettre qu’il ne le fera plus.
11:35 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (12)
jeudi, 25 janvier 2007
Verlaine complet
Je lis depuis plusieurs semaines les œuvres poétiques complètes de Verlaine publiées dans la collection « Bouquins ». Depuis les recueils découverts à l’adolescence, je n’avais pas lu Verlaine, pardon : je n’avais pas lu d’autre livre que ceux dont il est convenu de dire qu’ils sont les « grands », c’est-à-dire les plus célèbres : Poèmes saturniens, Fêtes galantes, Jadis et naguère, Parallèlement, La Bonne chanson, Romances sans paroles, Chansons pour elle, Sagesse. J’avais lu ses textes en prose, sa correspondance (j’attends toujours le deuxième volume, d’ailleurs), des études et des biographies, mais pas ses autres poésies.
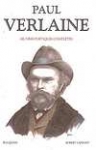 Dans ce tome, toute la poésie de Verlaine. Les « grands » livres ci-dessus et puis tous les autres, ceux qu’on ne lit jamais et qui témoignent d’une volonté absolue, de la part du poète, de construire une œuvre cohérente, bâtie, solide, avec des effets de « rappel » d’un livre à l’autre, des espèces de dyptiques, de grands pans complets presque thématiques. Alors, certes, les autres ouvrages sont vraiment moins bons. Mais à quoi cela tient-il ? Je me le demande. Verlaine serait-il tout à coup moins poète ? Cela ne veut pas dire grand-chose, d’autant que, jusqu’au bout, son art du poème est en éveil et en recherche constante de formes originales, de musique évidemment. Pas de redites, tout est neuf, chaque fois. Le travail du vers et la maîtrise absolue de la technique – pardon, des techniques – l’invention verbale et prosodique, tout y est. Et pourtant, ce ne sont pas d’aussi grands livres que les premiers. C’est très curieux. Cela dit, le plus mauvais Verlaine est de loin supérieur au meilleur d’autres.
Dans ce tome, toute la poésie de Verlaine. Les « grands » livres ci-dessus et puis tous les autres, ceux qu’on ne lit jamais et qui témoignent d’une volonté absolue, de la part du poète, de construire une œuvre cohérente, bâtie, solide, avec des effets de « rappel » d’un livre à l’autre, des espèces de dyptiques, de grands pans complets presque thématiques. Alors, certes, les autres ouvrages sont vraiment moins bons. Mais à quoi cela tient-il ? Je me le demande. Verlaine serait-il tout à coup moins poète ? Cela ne veut pas dire grand-chose, d’autant que, jusqu’au bout, son art du poème est en éveil et en recherche constante de formes originales, de musique évidemment. Pas de redites, tout est neuf, chaque fois. Le travail du vers et la maîtrise absolue de la technique – pardon, des techniques – l’invention verbale et prosodique, tout y est. Et pourtant, ce ne sont pas d’aussi grands livres que les premiers. C’est très curieux. Cela dit, le plus mauvais Verlaine est de loin supérieur au meilleur d’autres.
Et puis, une exception, le recueil Amour avec, notamment, le bouleversant cycle de Lucien Létinois, recueil qui n’est pas loin de pouvoir venir s’agréger aux plus prestigieux.
11:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9)
dimanche, 14 janvier 2007
« Je m’appelle Werner von Ebrennac »
 Une fois de plus, nous avons regardé Le Silence de la mer, le premier film de Melville, d’après Vercors, sorti en 1949. Cette œuvre de Vercors, j’en ai lu le texte, je l’ai vue au cinéma et en DVD plusieurs fois, j’ai assisté à une adaptation théâtrale, il y a quelques années. Chaque fois, je reste sans voix devant les qualités de ce texte. Une langue impeccable, bien entendu, au rythme parfaitement adapté au sujet. Dieu sait combien il est difficile, même lorsqu’on pense connaître un brin la langue et qu’on se targue de la manier, de trouver cependant le registre idoine. Mais il n’y a pas que cela. Il y a évidemment l’idée formidable – pour un auteur, c’est séduisant au possible, en dépit de la gravité du thème – du silence que l’oncle et la nièce opposent à Werner von Ebrennac. La résistance par le silence, le mutisme, quelle trouvaille passionnante. Il y a l’humanité profonde dont est pétri ce roman (bien plutôt une longue nouvelle), l’humanisme utopique de l’officier qui finira par se « suicider » en demandant à être muté sur le front de l’Est lorsqu’il aura compris les buts réels poursuivis par la barbarie nazie, lui qui, cultivé, amoureux de la France, avait cru aux lendemains qui chantent, avait imaginé que le soleil se lèverait sur l’Europe. Il y a l’évolution lente – mais peinte d’une main sûre – des sentiments de l’oncle et de la nièce, l’amour qui naît dans son cœur de jeune femme… Enfin, il y a mille choses qu’un écrivain ne peut pas ne pas admirer en rêvant forcément de faire un jour un livre de ce niveau, de cette élégance et de cet espoir meurtri. Un livre utile – et je ne répèterai jamais assez que l’écrivain est utile ou n’est pas. Et puis, il y a ce film de Melville, son tout-premier long-métrage, déjà parfait, déjà épuré, déjà melvillien en diable.
Une fois de plus, nous avons regardé Le Silence de la mer, le premier film de Melville, d’après Vercors, sorti en 1949. Cette œuvre de Vercors, j’en ai lu le texte, je l’ai vue au cinéma et en DVD plusieurs fois, j’ai assisté à une adaptation théâtrale, il y a quelques années. Chaque fois, je reste sans voix devant les qualités de ce texte. Une langue impeccable, bien entendu, au rythme parfaitement adapté au sujet. Dieu sait combien il est difficile, même lorsqu’on pense connaître un brin la langue et qu’on se targue de la manier, de trouver cependant le registre idoine. Mais il n’y a pas que cela. Il y a évidemment l’idée formidable – pour un auteur, c’est séduisant au possible, en dépit de la gravité du thème – du silence que l’oncle et la nièce opposent à Werner von Ebrennac. La résistance par le silence, le mutisme, quelle trouvaille passionnante. Il y a l’humanité profonde dont est pétri ce roman (bien plutôt une longue nouvelle), l’humanisme utopique de l’officier qui finira par se « suicider » en demandant à être muté sur le front de l’Est lorsqu’il aura compris les buts réels poursuivis par la barbarie nazie, lui qui, cultivé, amoureux de la France, avait cru aux lendemains qui chantent, avait imaginé que le soleil se lèverait sur l’Europe. Il y a l’évolution lente – mais peinte d’une main sûre – des sentiments de l’oncle et de la nièce, l’amour qui naît dans son cœur de jeune femme… Enfin, il y a mille choses qu’un écrivain ne peut pas ne pas admirer en rêvant forcément de faire un jour un livre de ce niveau, de cette élégance et de cet espoir meurtri. Un livre utile – et je ne répèterai jamais assez que l’écrivain est utile ou n’est pas. Et puis, il y a ce film de Melville, son tout-premier long-métrage, déjà parfait, déjà épuré, déjà melvillien en diable.
22:23 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)
mercredi, 06 décembre 2006
Tout est relatif
L’ami Pierre Bosc a cru bon de parler à deux reprises, sur son blog comme sur son site, de mes petites bêtises théâtrales. Ses articles pleins de louanges me rendent confus mais je sais qu’il exagère toujours. Ce qui m’amuse, et c’est la raison de cette note, c’est qu’à l’instar de tous mes autres ouvrages, celui-ci a été refusé cent fois avant de paraître en un tirage confidentiel chez un éditeur qu’on ne trouve pas en librairie. Manon a été écrit en 2002, Guillemine en 2004 et, depuis, j’ai essuyé tant de refus que les compliments de Pierre me font sourire. Si c’était aussi génial, les éditeurs s’en seraient rendu compte plus tôt.
10:09 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3)
lundi, 20 novembre 2006
Information
Un éditeur, D’un noir si bleu, vient d’accepter de publier mon treizième livre, quelques petites nouvelles de rien du tout. Le recueil est intitulé Le temps d’être un autre, mais cela doit changer. Parution début mars, en principe. Bah, la terre continuera à tourner.
16:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (16)
Site Roger Vailland
Je signale l’ouverture du site Roger Vailland, écrivain français, sous l’égide des Amis de Roger Vailland.
15:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 04 novembre 2006
Le maître parle
Être connu n’est pas ma principale affaire. Cela ne satisfait entièrement que les très médiocres vanités. D’ailleurs, sur ce chapitre même, sait-on jamais à quoi s’en tenir ? La célébrité la plus complète ne vous assouvit point et l’on meurt presque toujours dans l’incertitude de son propre nom, à moins d’être un sot. Donc l’illustration ne vous classe pas plus à vos propres yeux que l’obscurité. Je vise à mieux, à me plaire.
Lettre de Flaubert à Maxime du Camp, 26 juin 1852.
19:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 02 novembre 2006
Le gallinacé tout nu
J’ai découvert, en voyageant de lien en lien, un blog nouveau, plaisamment intitulé Le Coq à poil, animé depuis le 5 octobre dernier par Hubert Antoine. Il s’agit de textes très brefs, pas mal tournés à première vue. Je ne sais pas si cela ne sera pas lassant, à la longue. On verra. Pour le moment, ce n’est pas désagréable et surtout, ce n’est ni ostentatoire ni prétentieux.
12:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15)
mercredi, 01 novembre 2006
Sur Barthes
Les Derniers jours de Roland B. est un livre d’Hervé Algalarrondo paru chez Stock, il y a peu. Il était précisé que cet ouvrage s’intéressait aux derniers jours de Barthes en envisageant l’homme lui-même. Cela pouvait n’être pas inintéressant. Il reste que ce livre est l’exemple même de l’essai rédigé par un journaliste : ton léger, tournures rapides ou familières, tics de langage, excessive distance ironico-maniaque. En bref, tout ce qui fait le travers du journalisme contemporain : la légèreté et l’absence d’écriture. On enfourche ici mon habituel dada : l’écriture des essais et documents qui, plus que jamais, est nécessaire. Je n’achète pas un livre avec le désir de lire un article de journal étiré sur près de trois-cents pages (dans une typographie gonflée, pour faire masse.) J’achète un livre en espérant y trouver une œuvre écrite, rédigée, qui témoigne d’une recherche et en présente le résultat avec style et allure, de préférence sur un ton personnel. Je ne veux plus de ces ouvrages qui ne sont pas inintéressants, certes non, mais sont vraiment des copies interchangeables, rendues par des folliculaires. Il me reste trop peu de temps à vivre et à lire pour le perdre et je deviens de plus en plus exigeant quant à l’écriture des livres dont je fais l’acquisition.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10)
dimanche, 24 septembre 2006
Un documentaire de Sandrine Dumarais
France 3 Sud redonnera, samedi 7 octobre à 16 h 20, Albertine Sarrazin, le roman d’une vie, réalisé par Sandrine Dumarais. Je rappelle qu’on peut y rencontrer le beau Pierre Bosc et l’horrible taulier. Pour ceux qui vivent dans les environs, donc, et qui n’auront pas peur d’entendre le père Layani et surtout de le voir.
21:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2)


