mardi, 25 juin 2019
Redécouvrir Yvan Govar
Je redonne ici cette étude proposée une première fois en 2014, une seconde fois en 2018, revue et complétée. Elle sera présentée chaque fois que j'aurai pu apprendre quelque chose de nouveau sur Yvan Govar.
Une trop courte vie
Yvan Govar (24 août 1935-18 février 1988) est un cinéaste belge – son vrai nom est Yvan Govaerts, il est le fils du peintre Jean Govaerts et de Nelly Van Kelekom, galeriste ostendaise – qui a abandonné le cinéma après que ses sept films n’eurent pas connu le succès. Dans les années 50, il fut comédien et joua Racine ou Giraudoux. En 1954, au théâtre Colon, à Buenos-Aires, il interprète deux rôles (le créancier et l’homme sage) dans Le Livre de Christophe Colomb de Claudel, dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault. Au Conservatoire national d’art dramatique de Paris, il rencontre Belmondo, Marielle, Rochefort et Annie Girardot. Selon Philippe Durant, biographe de Belmondo, Govar, à dix-huit ans, pesait cent-dix-huit kilos et mesurait un mètre quatre-vingt-cinq, ce qui devait faire de lui un impressionnant personnage. En 1953, La Revue théâtrale le présente comme un « tout jeune acteur auquel la stature, la voix, la présence en scène semblent promettre carrière dans ce que l’on appelle volontiers au répertoire les rondeurs ».
Il réalise son premier film, un moyen-métrage intitulé Nous n’irons plus au bois, dans lequel il joue lui-même, à l’âge de dix-neuf ans. Marié, un temps, à une actrice, Irène Tunc, qui fut Miss Côte-d’Azur puis Miss France, il tenta de se suicider à cause de ses infidélités. Plus tard, ils divorcèrent. Elle joua, entre autres, dans Les Aventuriers de Robert Enrico, dans Léon Morin, prêtre du grand Jean-Pierre Melville, et mourut dans un accident de la route à Versailles, en 1972. Elle s’était remariée avec Alain Cavalier qui, de nombreuses années après sa disparition, lui consacrera un film, Irène. Après 1965, Govar, découragé par le médiocre accueil réservé à ses réalisations, renonça définitivement à son art. En 1983, on le retrouve acteur dans un court-métrage de Richard Olivier, Le Buteur fantastique, une curiosité surréaliste, sans texte mais avec bruitages. Il est décédé à moins de cinquante-trois ans.

Le cinéma de Govar
Ses films, tous en noir et blanc, sont emplis de fausses pistes. Il y règne, sous l’apparence de films « de genre », une atmosphère étrange, déroutante, intrigante. Un soir, par hasard en est un excellent exemple puisque l’on croit, tout au long du récit, se trouver dans une film résolument fantastique, avant de s’apercevoir, dans le dernier quart d’heure, qu’il s’agit d’un film d’espionnage tout ce qu’il y a de plus matériel, de plus concret, de plus réaliste.
L’écriture filmique de Govar recèle de nombreuses audaces, à tout le moins des originalités. Il n’est pas du tout académique. Le montage est toujours juste, le rythme à la fois lent et soutenu. Il engage de grands acteurs : Brasseur, Nicaud, Cuny, Simon, Servais, Marielle, Rouleau, Roquevert, Marie Dubois, Madeleine Robinson, Maria Pacôme, Annette Stroyberg, Jacqueline Maillan, Pascale Petit…
Dans Deux heures à tuer, son dernier film, le plus abouti, une œuvre étonnante car pleine de surprises, jouent aussi Jean-Roger Caussimon et Catherine Sauvage, l’adaptation et les dialogues formidables étant signés Bernard Dimey. Délicieux huis-clos aux rebondissements incessants, qui se déroule pratiquement en temps réel, Deux heures à tuer voit des acteurs se frotter l’un à l’autre avec une excellente verve. La distribution comprend des choses amusantes : Caussimon et Catherine Sauvage, qui se connaissent bien, forment un couple bourgeois déchiré et, par ailleurs, il était piquant de réunir Pierre Brasseur et Catherine Sauvage... qui fut à la ville Mme Brasseur. Govar témoigne ici de son aptitude à diriger sept personnages principaux – et une douzaine d’autres – dans un espace unique. Les déplacements, évidemment essentiels dans ce genre, sont fort bien réglés en un plaisant ballet, évoluant sous des éclairages toujours justes.
La Croix des vivants qui, lui, n’est pas un policier et dont le scénario est dû à Maurice Clavel et Alain Cavalier, est le développement de son moyen-métrage, Nous n’irons plus au bois. C’est un drame authentique, dans lequel Govar montre sa capacité à diriger de nombreux acteurs, à faire apparaître progressivement des personnages multiples. Cet homme tendre est aussi un démiurge. Le fait de reprendre une idée vieille de plusieurs années et de la développer est un signe certain d’authenticité : lorsqu’un artiste remet sur le métier un projet ancien, il y tient toujours et tente alors de donner le meilleur de lui-même.
L’adaptation de Que personne ne sorte ! est cosignée par Stanislas-André Steeman, d’après son roman. Il s’agit d’une série noire « pour rire », tout comme Les Tontons flingueurs de Lautner qui date de la même année ou Les Barbouzes, du même, qui sortit l’année suivante. Toutefois, La Métamorphose des cloportes de Granier-Deferre, un an plus tard encore, constituera un film bien supérieur à ces trois-là, plus fin, plus fouillé. Entre 1963 et 1965, dans le genre policier, le sous-genre du policier comique connaîtra une grande vogue. Ce style, que l’on peut ne pas apprécier, est ici bien traité car rythmé et monté avec vivacité. L’utilisation ironique de la musique ajoute à la cadence d’une œuvre qui n’est jamais vulgaire, comme c’est toujours le risque, dès qu’il y a parodie. La direction d’acteurs est parfaite, y compris dans les situations loufoques où les comédiens risquent toujours de se perdre.

Tournage de Que personne ne sorte !

Le 45-tours de la bande originale d’Un soir, par hasard
En vidéo
Sous la houlette de l’association Belfilm et de Paul Geens, historien du cinéma et redécouvreur passionné, la firme belge Come and See avait entrepris la réalisation d’une intégrale Yvan Govar qui a tourné court, en 2009. Seuls quatre titres ont paru, quand un coffret de sept DVD était annoncé. On dispose donc aujourd’hui, uniquement, de La Croix des vivants, Que personne ne sorte ! (autre titre : La Dernière enquête de Wens), Un soir, par hasard et Deux heures à tuer, soit les œuvres des années 60. Les bonus sont curieux et c’est un choix de Geens : ils n’ont aucun rapport avec les films. Ce sont, au mieux, des courts-métrages concernant un des acteurs du film auquel ils ne se rapportent pas (sauf dans le cas de La Croix des vivants, dont le bonus est le moyen-métrage initial, ou bien dans celui d’Un soir, par hasard, qui est le court-métrage de Richard Olivier dont il a été question plus haut, dans lequel joue Govar). La restauration laisse à désirer : l’image est un peu terne, mais ce n’est pas catastrophique. Les bonus, toutefois, ne sont pas restaurés du tout. Dans cette intégrale regrettablement interrompue, ne sont finalement pas sortis les titres des années 50 : Le Toubib, médecin du gang (autre titre : Le Toubib du gang, écrit, produit et réalisé par Govar, dans lequel Barbara est réputée avoir fait une très courte apparition en tant que figurante, mais, selon sa biographe Valérie Lehoux, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’elle), Le Circuit de minuit et Y en a marre (autres titres : Ce soir on tue ou Le Gars d’Anvers, « un film mouvementé d’Yvan Govar, de style policier classique, émaillé des plus belles bagarres jamais réalisées à l’écran »)[1], qui ont cependant existé, autrefois, en VHS.

Une des affiches du Toubib, médecin du gang

Une scène du Toubib, médecin du gang

Une des affiches de Y en a marre

Une scène de Y en a marre
Chez Dailymotion, on trouve deux minutes du Toubib, médecin du gang, deux autres de Y en a marre, frustrantes séquences apéritives que ne suit malheureusement aucun repas. Du Circuit de minuit, rien n’est proposé.

Une des affiches du Circuit de minuit
Pourtant, Le Circuit de minuit mêle une intrigue relativement classique mais bien traitée et un aspect documentaire fort détaillé, remarquablement exposé (en l’occurrence, le milieu du sport automobile). De beaux angles de caméra, un montage et un rythme maîtrisés, un rendu de la durée très juste, un brin d’humour, enfin, en la présence de l’amusant Luc Varenne, reporter jouant son propre rôle. En prime, le temps de deux plans brefs, Govar en personne, dans le rôle d'un speaker.

Yvan Govar dans Le Circuit de minuit
En 2014, la firme Filmédia a ressorti, sous de nouvelles présentations, deux DVD, Que personne ne sorte ! et Deux heures à tuer, dont le contenu est parfaitement identique à l’édition de Come and See. Il n’est nullement indiqué qu’une suite sera donnée à cette réédition.

Pascale Petit et Giani Esposito dans La Croix des vivants
Ce qu’on en a dit
Du Toubib, médecin du gang, les Cahiers du Cinéma écrivaient, en 1959 : « Un réalisateur odieux au service d’une méchante cause ». Rien de moins. Dans le même numéro, une notule expédiait Y en a marre sur le mode « marabout, bout de ficelle », en écrivant : « Y en a marre – marchandise – discontinue – continue donc – dont auquel – quel navet ! », ce qui, on le voit, est fort argumenté.
Longtemps plus tard, les livres de cinéma continuent d’affirmer sans la moindre explication : « Un soir par hasard d’Yvan Govar (…) relevait plus de la comédie boulevardière que de la SF ».[2] Ils parlent de « Y en a marre : ce film (…) est une coproduction franco-belge mise en scène par un réalisateur sans avenir, Yvan Govar ».[3] Pire encore, voici Yves Martin : « Zéro à Yvan Govar. Inaptitude = prétention. La Croix des vivants (1962), sous-produit mauriacien, vaudrait une bonne décharge de chevrotine ».[4] On aimerait savoir, mais on l’ignorera, pourquoi Martin se sent tout à coup des humeurs de chasseur.
Rien n’est insupportable comme ces critiques « au sentiment », rédigées à l’emporte-pièce, crachées sans explications, sans argumentaire aucun. Elles n’ont rien à voir avec le cinéma.
Il est heureux que d’autres auteurs pensent différemment : « Son souci semble avoir été de raconter, sans temps morts, des histoires à intrigues policières ou à suspense. Il ne méritait pas, pour autant, le discrédit dans lequel on l’a tenu. Car il avait un univers à lui, peuplé de personnages souvent en lutte contre un mauvais destin, un univers où le drame, sinon le mélodrame était l’élément dominant », écrit avec justesse Jacques Siclier, dix ans, malheureusement, après la mort du cinéaste.[5] Le Soir de Bruxelles affirme : « Yvan Govar (...) est l’oublié du ciné belge. Pourtant, dans les années 50, il fut le seul de nos réalisateurs, avec Jacques Feyder, à réussir dans le cinéma populaire français. Cet aventurier rabelaisien mit en scène des polars, des comédies ou des drames qui valaient les films d’Henri Decoin ou de Gilles Grangier. Govar avait le sens du rythme et de la narration et dirigeait excellemment des acteurs débutants ou des seconds rôles (...) qui donnaient à son œuvre une densité du quotidien compensant son manque de moyens financiers... (...) Scénarios vifs où le destin brise les protagonistes. Filmant dans les rues, Govar a capté l’air du temps (la poésie réaliste) des années 50. (...) Découvrez-le, vous serez surpris ».[6]
On sera étonné, en effet. À l’ambiance que perpétuaient Grangier, Decoin et autres réalisateurs de ce temps, Govar a ajouté, çà et là, un peu de surréalisme belge à la façon d’André Delvaux et même de Paul Delvaux (diaphane et irréelle, la cavalière de La Croix des vivants paraît sortir d’une de ses toiles, elle a le visage des femmes de Delvaux ; les personnages étranges de Deux heures à tuer, isolés dans une gare, évoquent aussi les thèmes du peintre, surtout dans les scènes se déroulant sur les quais). Cela se marie parfaitement avec le réalisme poétique. La séquence finale d’Un soir, par hasard, l’élimination du personnage joué par Servais, si elle est réaliste sur le plan du scénario, est cependant tournée dans une atmosphère nettement onirique.
On penserait presque que Govar a connu l’injuste destin de ses propres personnages : combat, échec sentimental et professionnel, mort précoce. Cette vision noire finit par s’imposer.
Objectivement, on comprend mal pourquoi ces films, peu nombreux, n’ont pas, en leur temps, connu le succès. Là comme ailleurs, il importe de combattre les idées reçues, de mettre le feu aux clichés et d’aller voir de quoi il s’agit. Ce cinéma est techniquement bon, les scénarios sont intéressants, l’humain n’est jamais perdu de vue et leur réalisateur est à l’évidence un artiste généreux.

Catherine Sauvage et Jean-Roger Caussimon dans Deux heures à tuer
___________________________________________
[1]. Feuille d’avis de Neuchâtel du 4 août 1961.
[2]. Jean-Pierre Bouyxou et Roland Lethem, La Science-fiction au cinéma, Bourgois, 1971.
[3]. Michel Azzopardi, Le Temps des vamps, 1915-1965, cinquante ans de sex-appeal, L’Harmattan, 1997.
[4]. Yves Martin, Le Cinéma français, 1946-1966, un jeune homme au fil des vagues, Méréal, 1998.
[5]. Le Monde des 31 août et 1er septembre 1998.
[6]. Le Soir de Bruxelles du 16 décembre 1998.
11:20 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 26 septembre 2018
Alexis le Grec
À la télévision, nous avons regardé, enregistré l’autre soir, le film de 1964, Zorba le Grec. Je l’avais vu autrefois, j’avais été formidablement déçu. Je l’ai été de nouveau. Du chef-d’œuvre de Kazantzaki, il reste l’anecdote. Je le savais, mon regard de soixante-six ans me l’a confirmé. Par ailleurs, le film est remarquablement cadré, tourné, monté. Anthony Quinn est prodigieux, toujours juste, généreux. Il demeure toutefois un gros problème de rythme. Je sais bien que le film date de 1964, mais c’était déjà non pas trop lent, mais pas assez vif. Il ne reste rien, non plus, de la dimension philosophique, voire métaphysique, de l’œuvre originale. Il est vrai qu’il n’était pas possible de la rendre au cinéma. Bref, c’est raté, malgré la distribution impeccable et la direction d’acteurs excellente. Le roman s’intitulait Alexis Zorba, le film, Zorba le Grec. C’est peut-être toute la différence.

19:48 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 23 septembre 2018
Alex et son Guy
Le film d’Alex Lutz, Guy, est intelligent. Faux documentaire consacré à un chanteur de variétés imaginaire, long-métrage parfaitement monté aux allures de documentaire brut, non monté, justement, l’œuvre, nourrie de dialogues très justes, s’élève à une dimension humaine véritable. Les maquillages sont remarquables, les faux extraits d’émissions de télévision, censés être usés par le temps, aux couleurs passées, sont subtils.
Lutz, co-scénariste, réalisateur et acteur, a quarante ans, il est grimé pour en paraître soixante-quatorze. Drucker et Julien Clerc jouent leur propre rôle, ajoutant au film une série de mises en abyme. Impeccable en vérité, d’autant que touchant et sensible.


Saisissant, non ?
12:37 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 29 décembre 2017
Une si belle promesse

La Promesse de l’aube, un film d’Éric Barbier d’après l’œuvre de Romain Gary. On oublie qu’il s’agit d’un remake, puisque Dassin, en 1971, avait déjà adapté le roman avec Mélina Mercouri dans le rôle de la mère.
Certes, Charlotte Gainsbourg « en fait des tonnes » comme a pu dire parfois la critique, mais peut-on être Nina Kacew sans en faire des tonnes, justement ? Au vrai, elle a raison, elle ne pouvait pas interpréter le rôle autrement. La distribution est excellente et l’on a fait un bon choix des acteurs interprétant Gary enfant puis jeune homme. Le passage à l’âge adulte se fait sans même que le spectateur s’en aperçoive. Le maquillage de tous les acteurs est bon, notamment dans les étapes du vieillissement.
Le réalisateur évite tous les pièges de la reconstitution, entre autres lors des combats aériens qu’il stylise avec intelligence. Il a de belles trouvailles, comme celle du général de Gaulle décorant Gary enfant, dans des images en noir et blanc au cadre réduit, comme si une réelle archive était insérée dans le film. Le rendu de la durée est très bon.
Seul défaut, l’usage d’un filtre jaune pour obtenir une lumière mordorée systématique, ce qui est regrettable.
16:46 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 09 décembre 2017
Le nouveau Guédiguian

C’est sur un rythme très lent que Robert Guédiguian narre sa nouvelle histoire, La Villa, une rêverie supplémentaire sur le temps qui passe et la fidélité à sa jeunesse, à ses idées, à ses amours. Dans le décor superbe de la calanque de Méjean, à l’ouest de l’Estaque, il développe pas moins de sept histoires parallèles (au moins) sans sortir du cadre, allant son chemin d’un pas un peu triste, mélancolique, au fil d’une nostalgie contre laquelle il paraît lutter sans y rien pouvoir. L’action est scandée par le train de la Côte Bleue qui passe et repasse tout en haut de l’immense viaduc dominant la somptueuse calanque.
Image parfaitement nette, lumière de la Méditerranée sucée avec le lait et restituée avec justesse, jusque dans ses couchants, longs plans fixes ou presque fixes marquant le temps qui passe en même temps qu’il se fige, montage cut comme toujours, flot des générations qui se mêlent dans cette œuvre où les pêcheurs connaissent Claudel par cœur et trouvent le moyen de vivre leur rêve de toujours en faisant éclore un amour inattendu dans le cœur d’une femme blessée, meurtrie – Guédiguian traite de problèmes réels en maniant l’onirisme et, en ce qui concerne la scène finale, l’allégorie pure et simple. L’espoir appartient à la fois à la jeunesse – les trois enfants migrants – et à la sincérité absolue des autres personnages – du couple âgé qui se suicide aux gens mûrs que jouent ses comédiens habituels. L’espoir, c’est crier sous le viaduc à la recherche de l’écho. L’écho, c’est la réponse de demain aux tristesses d’aujourd’hui.
Photo La Provence
23:52 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 21 décembre 2016
Madame
La grande Michèle Morgan est décédée le 20 décembre 2016. Un article fielleux du Monde.fr relativise sa gloire et son aura. Comme le font remarquer plusieurs commentateurs, son auteur ne doit pas avoir entendu parler des Orgueilleux, du Miroir à deux faces, ni de Fortunat. Ne retiendrait-on que ces trois œuvres, cela serait déjà bien.
Dans Les Orgueilleux (Yves Allégret, 1953), elle partage l’affiche avec Gérard Philipe, bouleversant, littéralement somptueux. Bien qu’il ne soit pas crédité au générique, le scénario est de Sartre. Une scène d’un érotisme inimaginable en 1953 et encore aujourd’hui très « chaude » montre combien elle était animale, il n’y a pas d’autre mot. Dans Le Miroir à deux faces (André Cayatte, 1958), elle est l’épouse d’un Bourvil jouant un personnage odieux et malheureux. Et elle, beauté entre les beautés, avait accepté d’être enlaidie pour le rôle, ce qui n’avait rien d’évident. Dans Fortunat (Alex Joffé, 1960), elle est de nouveau en compagnie de Bourvil, un Bourvil extraordinaire pour un film profondément humain. Alors, plutôt que de nous seriner la réplique mondialement connue de Quai des Brumes qui a d’ailleurs vieilli, qu’on aille voir ces films-là, au moins ceux-là.

16:52 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 04 décembre 2016
L’emblème du film fantastique français
 D’après un roman de Jean Redon paru au Fleuve Noir, adapté par le tandem Boileau-Narcejac et Claude Sautet dans un noir et blanc magnifique, avec des éclairages précis, un montage parfait, une interprétation sans égale, ce sont Les Yeux sans visage. Si le film de Franju (1960) a malheureusement un peu vieilli dans ses derniers moments, notamment lors de l’enquête policière – le scénario, très solide, peine alors un peu, fort peu, mais suffisamment pour que notre regard de 2016 s’en aperçoive –, ce n’est pas très important. L’œuvre relève du fantastique, qui n’est pas le genre le plus représenté dans le cinéma français. Elle n’en est que plus remarquable. Un article pertinent est à lire ici.
D’après un roman de Jean Redon paru au Fleuve Noir, adapté par le tandem Boileau-Narcejac et Claude Sautet dans un noir et blanc magnifique, avec des éclairages précis, un montage parfait, une interprétation sans égale, ce sont Les Yeux sans visage. Si le film de Franju (1960) a malheureusement un peu vieilli dans ses derniers moments, notamment lors de l’enquête policière – le scénario, très solide, peine alors un peu, fort peu, mais suffisamment pour que notre regard de 2016 s’en aperçoive –, ce n’est pas très important. L’œuvre relève du fantastique, qui n’est pas le genre le plus représenté dans le cinéma français. Elle n’en est que plus remarquable. Un article pertinent est à lire ici.
17:27 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
jeudi, 27 octobre 2016
La Femme de paille
La Femme de paille (1964) a tenu le coup. Réalisé par Basil Dearden, le film Woman of straw est sorti la même année que Goldfinger et, avec mes parents, nous l’avions vu à Marseille, peu après. Sean Connery joue ici un rôle aux antipodes de celui de 007. On y voit Gina Lollobrigida, dont la fougue italienne joue des contrastes face aux personnages anglais. Magnifique bande sonore (Beethoven, Berlioz, Mozart, Rimski-Korsakov) qui, de plus, se rapporte au sujet du film. Des décors somptueux ajoutent au propos. Et le personnage de l’oncle ! Il faut le découvrir car il n’est pas racontable.

Évidemment, l’emploi de « découvertes » est devenu impossible aujourd’hui, mais c’était l’usage, la façon de faire. À part cela, La Femme de paille est une belle leçon de cinéma. Filmage impeccable, montage parfait, plans toujours justes, belle direction d’acteurs, bon dialogue… D’après le livre de Catherine Arley, grande dame du roman noir.
18:10 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 27 septembre 2013
Regards argentins

J’ai regardé l’autre soir, proposé par Arte, le film de Juan José Campanella, Dans ses yeux (El secreto de sus ojos), en version originale sous-titrée. Pour une fois, « version originale » ne signifiait pas « en anglais », puisqu’il s’agit d’un film hispano-argentin. Il n’était pas désagréable d’entendre d’autres sonorités.
Cette œuvre, qui dure deux heures, est remarquable parce que tout y est intelligent : scénario, distribution, direction d’acteurs, interprétation, filmage, couleurs, prise de son, montage. Inévitablement, quelques ficelles laissent voir leurs nœuds, mais je dis vraiment cela pour ne pas tirer mon chapeau trop bas. Les personnages sont vrais : pas de carton-pâte. Les deux comédiens principaux (Ricardo Darin dans le rôle de Benjamin Esposito et Soledad Villamil dans celui d’Irene Menendez Hastings), sont de surcroît attachants parce qu’au-delà de leur talent et de leur sensibilité, ils sont beaux, elle et lui bruns aux yeux gris-bleus. Ces personnages parlent sans sabir, sans manières, sans platitude non plus : pas de bouillon-cube dans leur bouche. La musique – peut-être y en a-t-il un peu trop – ne couvre pas ce qu’ils disent : on a engagé un ingénieur du son compétent, ce qui paraît être de moins en moins le cas. L’alternance d’action, d’humour fin, de sentiments, d’enquête, de réflexion – sans parler d’une description discrète du fonctionnement de l’Argentine dans les années 70 – est fort bien dosée.
Le film relève-t-il du thriller, du policier, du drame humain, du film sentimental ? Plus que jamais, les cloisons s’écroulent, les boîtes étiquetées se déchirent, les étagères tombent, les catégories toutes faites grincent horriblement. Tant mieux.
Le montage repose sur de constants allers-retours entre le passé (les années 70) et le « présent » (les années 90). C’est dire que le film, tourné en 2009, a pour lui le recul nécessaire, y compris dans le présent de l’action. On est, au début, quelque peu désorienté, car le réalisateur n’agite pas un fanion : « Attention, flash-back ». Quelques minutes suffisent cependant pour s’installer dans l’espace-temps du film et on ne le regrette pas ensuite.
Un choix subtil fut de donner au récit l’allure d’une enquête, sans jamais montrer le moindre commissaire ou le plus petit inspecteur. Si enquête il y a, elle est effectuée par des juristes, fonctionnaires du ministère de la Justice, à titre plus ou moins individuel. Puis le principal protagoniste, une fois retraité, poursuit sa quête parce qu’un dossier dont il eut jadis à connaître est véritablement devenu une part de sa propre histoire et, par voie de conséquence, de celle d’un de ses amis qui y a trouvé la mort, de celle de la femme qu’il aime – et qui l’aime – depuis vingt-cinq ans sans que rien, jamais, n’ait pu se produire.
Plusieurs rebondissements émaillent le cours de l’histoire. Quelques scènes – et je ne parle pas ici de l’épilogue – sont franchement inattendues, et excellentes.
On salue les seconds rôles, tellement importants néanmoins qu’il faudrait les appeler autrement : Guillermo Francella incarne l’amical et chaleureux Pablo Sandoval, Pablo Rago joue Ricardo Morales emprisonné dans son souvenir amoureux, Javier Godino confère au personnage d’Isidoro Gomez cette totale abjection qui lui était nécessaire.
18:50 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 24 septembre 2013
Quand les hommes ont chaud

J’ai découvert hier soir, sur la chaîne Arte, le film Douze hommes en colère, de Sidney Lumet, sorti en 1957. Certes, il n’est jamais trop tard, n’est-ce pas ?
C’est un huis-clos et j’affectionne particulièrement les huis-clos, situation idéale pour faire ressortir la vérité des personnages, les faire crier ce qu’ils sont ou espèrent, faire monter la tension dramatique autant qu’il se peut.
Naturellement, on peut rétorquer que, justement, c’est trop facile. Je ne le crois pas. Renouveler le huis-clos aussi souvent que nécessaire est au contraire une gageure.
Évidemment, dans le cas de ces Douze hommes, les ficelles scénaristiques sont nombreuses. La scène se déroule par un temps orageux et la chaleur étouffante qui règne dans la salle où se réunit un jury d’assises contribue, bien sûr, à augmenter le poids des responsabilités, des hésitations, des scrupules, des certitudes et des préjugés. Pour qu’on comprenne bien, on n’a pas hésité à mouiller le visage des protagonistes, à dessiner sous leurs aisselles, dans leur dos, sur leur poitrine, de grandes taches de transpiration.

Durant de nombreuses années, les films montrant des procès et se déroulant dans des tribunaux ont obtenu un succès constant. Les effets sont faciles : tirades, joutes oratoires, attitude des avocats, solennité de la Cour, inquiétude de l’accusé… Avec cela, on fabriquait littéralement des morceaux de bravoure. Dans le cas qui nous occupe, c’est un peu différent. Il s’agit de la délibération : le jury se tient dans une salle et le premier juré doit frapper à la porte, verrouillée, si l’un des douze désire obtenir quelque chose. On n’a pas assisté à l’audience, on ne verra pas le verdict.
C’est en cela que le film est intelligent. On s’est débarrassé des clichés les plus fameux et concentré sur l’essentiel, ces douze hommes qui ne se connaissent pas, ignorent tout l’un de l’autre, sont issus de milieux fort différents et ne se reverront sans doute jamais.
Il y a d’autres chevilles, d’autres « trucs ». Oui, le héros, Henry Fonda, a les yeux bleus qu’on lui connaît, il porte un costume clair et c’est lui qui a le plus d’allure. Oui, le héros va retourner le jury par ses scrupules, sa logique, sa réflexion, sa prudence, son intelligence. On le sait depuis le début, du moins le pressent-on car, autrement, le film n’aurait strictement aucune raison d’être. Oui, le héros est architecte parce que, des décennies durant, au cinéma, les héros contemporains étaient architectes, avocats ou pilotes. Néanmoins, le spectateur « marche ».
Demeurent les douze rôles parfaitement écrits, même si certains font un peu figure d’archétypes ; la confrontation entre ces personnages ; les revirements successifs des jurés et, surtout, le revirement final du dernier d’entre eux, pour des raisons qu’on ne pouvait réellement deviner ; le débat sur la peine de mort, inscrit en filigrane ; la mise en scène qui tient du théâtre et du ballet (chose inévitable puisqu’il s’agit d’un huis-clos, mais qui aurait pu être moins talentueuse), notamment à la fin, lorsque les jurés vont reprendre leur veste au porte-manteau, l’enfiler et partir, dans une espèce de pas de danse filmé de l’intérieur de la penderie.
Et surtout, le noir et blanc, somptueux, seul procédé (sauf lorsqu’il existe un authentique travail sur la couleur, comme chez Demy, par exemple) réellement créatif.

10:41 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (6)
lundi, 10 juin 2013
Un inventaire de la consternation
Hier soir, un DVD acheté d’occasion m’a délivré la quintessence de l’ennui et du ridicule, Vivre pour vivre de Claude Lelouch (1967). Un film où tout est mauvais, sans exception.
Je ne parle pas des acteurs : un film, ce n’est pas seulement des acteurs. C’est d’abord un montage, ici chaotique, suite de séquences collées. Des prises de vue, brouillonnes, caméra à l’épaule comme l’affectionne le cinéaste. Un cadrage, répétitif au possible, avec une contreplongée quasi systématique. Un propos, totalement perdu en cours de route avec les innombrables et interminables séquences documentaires, parfaitement inutiles, empoisonnantes à suivre et très mal filmées, parfois complaisantes donc suspectes, lorsque Lelouch traite de la violence, par exemple. Une vérité, malmenée par un filmage en plans serrés afin de figurer le Vietnam en guerre quand ces scènes ont été tournées avec quelques misérables figurants et du matériel militaire minable, je ne sais où, peut-être en Afrique, puisqu’une partie du tournage y a été effectuée. Une distribution, fort mal faite puisque Candice Bergen, incolore, inodore, sans saveur, donc inexistante, est supposée être préférée à Annie Girardot (on se demande bien pourquoi) par le personnage que joue Montand. Une rigueur, combien malmenée par l’absence de direction d’acteurs. Une recherche, quand ici tout est répétitif, monstrueusement répétitif, notamment les scènes tournées en muet qui permettent de figurer le temps qui passe, de rendre la durée et font économiser les efforts du dialoguiste (ne pas s’inquiéter, les séquences avec texte sont elles-mêmes comme muettes, vu l’inanité du dialogue). Une imagination, alors qu’on voit rouler cent trains, voguer cent péniches et décoller ou se poser cent avions. Une cohérence, mais le personnage de Montand, dont le niveau de vie est élevé, se promène durant les deux ou trois années qu’est supposée durer l’intrigue, avec le même blouson de daim, la même canadienne et à bord de la même voiture. Un style, las, ici, on a le sentiment de lire à l’envers, sur un buvard, des inscriptions presque illisibles. Un panache, or, la chute, la toute dernière séquence, est, comme on dit, « téléphonée », prévisible, prévisible, prévisible : je l’ai annoncée en hurlant de rire quelques secondes avant que, forcément, elle apparaisse à l’écran, noyant définitivement ce navet dans les eaux putrides du grotesque.
Je pourrais continuer cet inventaire de la consternation. À quoi bon ? C’est le genre de cinéma inacceptable, à fuir au plus vite.
15:46 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
jeudi, 23 mai 2013
Il n’y a plus de Moustaki
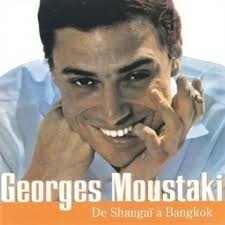 Le cher Moustaki est mort ce matin, à Nice.
Le cher Moustaki est mort ce matin, à Nice.
Je l’avais vu en scène au théâtre du Gymnase, à Marseille, en 1971. À l’Olympia, un soir de gala de soutien pour la veuve de Paul Castanier, le pianiste, en 1992. Au Casino de Paris, en 1997. C’est peu, tout de même.
J’avais lu quelques livres de ou sur lui, notamment le Moustaki de Cécile Barthélémy paru en 1970 chez Seghers, ressorti en 2008 avec une mise à jour. C’était une catastrophe, l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Redondances, prose délayée, tirage à la ligne, tics de langage, ton anecdotique, répétitions, maîtrise de l’espace-temps du livre nulle, rendu de la durée exécrable. Il ne s’agit pas réellement d’une édition refondue puisque la mise à jour est constituée de passages entés au texte initial, sans réexamen littéraire. Littéraire ? Quel mot, ici ! Lorsqu’on achète un tome de la collection « Poésie et chansons », on ne cherche pas une biographie stricto sensu, moins encore un feuilleton. Ce Moustaki n’est rien d’autre : pas un mot d’analyse, pas un commentaire de fond sur les divers musiciens qui l’ont accompagné, pas un développement portant sur le contenu, hormis, en surface seulement, pour Le Métèque – et encore. Un feuilleton, oui, et interminable.
Les marchands de papier vont pouvoir gagner quelque argent. Cette triste disparition s’ajoute en effet aux multiples célébrations de l’année 2013, dont je parlais dans la note précédente.
12:20 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 05 avril 2013
Demy, 15 : un autre point de vue, II
Cet article fait suite à celui intitulé Demy, 8 : un autre point de vue, publié ici-même le 14 mars 2013.
On peut aller encore plus loin. Reprenons. Une fois au bureau, que dit Geneviève à Guy et comment peut-on l’interpréter ?
« Maman est morte à l’automne ». Comprendre : plus personne ne peut s’interposer entre nous. « Françoise. Elle a beaucoup de toi. Tu veux la voir ? ». Comprendre : formons enfin une famille, reprends-nous, notre fille et moi. Est-ce que je vais trop loin ? Je ne pense pas. Quel besoin avait-on de faire mourir la mère ? Cela n’apporte rien au scénario.
Je tiens que, dans cette scène du bureau, existe un moment d’incertitude, un temps de latence où tout peut se produire. Geneviève attend quelque chose de Guy. Qu’est-ce qui brise l’enchantement ? Le pompiste ouvre la porte : « Est-ce que je fais le plein pour Madame ? ». Ce pompiste, c’est Caron. C’est le passeur : il ouvre la porte de l’enfer d’une séparation, cette fois définitive. Pourquoi est-il vêtu de noir dans ce film en couleurs ? Caron était bien là dans La Baie des anges, il le sera de nouveau dans Parking. En vérité, le cinéma de Demy est si cruel qu’il tente de nous faire croire qu’il ne l’est pas. Il y a pourtant du raffinement dans la cruauté et, avec ce pompiste, Demy fait vraiment acte de démiurge.
Ainsi, tout est brisé et Geneviève s’en va. Que va-t-elle faire ? Rouler de Cherbourg à Paris avec une jeune enfant, dans la nuit, sous la neige ? Et que vient faire ce pompiste, toujours lui, que l’on voit astiquer le pare-brise d’une voiture alors qu’il neige ? Son geste inutile ressemble à un rire grinçant.
Je me trouve conforté dans mes interprétations par le fait qu’initialement, Guy devait être présent dans Les Demoiselles de Rochefort et rater de nouveau Geneviève (Catherine Deneuve aurait tenu les deux rôles, celui de Delphine et celui de Geneviève). Dans l’absolu, c’eût été la première fois que se seraient retrouvés Roland Cassard, sa femme, la petite Françoise et lui, en même temps : Geneviève aurait eu tout son monde sous les yeux et dû choisir – mais elle n’aurait pu le faire, puisqu’ils devaient se manquer… Demy avait donc bien imaginé remettre, sinon en présence, du moins non loin l’un de l’autre, les anciens amants – et par conséquent faire prendre à Cassard le risque d’être encore déçu, comme autrefois dans Lola, pauvre Cassard – avant de les séparer de nouveau. Si ce n’est pas démiurgique, j’ignore le sens de cet adjectif.
Ces considérations n’auraient qu’une importance relative – on peut effectivement gloser sans fin sur un scénario – si on ne trouvait ici dans un système de personnages récurrents. À partir du moment où le réalisateur lui-même avait admis de pouvoir faire se croiser de nouveau Guy et Geneviève, rien ne s’oppose réellement à ce que la scène finale des Parapluies puisse être interprétée comme je le fais.

15:49 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 01 avril 2013
Demy, 14 : à propos de Model Shop
Il importe de redécouvrir Model Shop. Cet excellent film est d’une beauté austère, d’une beauté sèche, pourrait-on dire. En vingt-quatre heures, George Matthews – un Roland Cassard de Los Angeles, à n’en pas douter – perd sa compagne qu’il n’aime guère, Lola qu’il vient de rencontrer et qui refuse de l’aimer parce qu’elle ne veut plus aimer qui que ce soit, sa voiture dont il ne peut payer les mensualités, ses illusions et, véritable Guy Foucher de Californie, reçoit sa feuille de route pour partir au Vietnam dont, selon toute vraisemblance, il ne reviendra pas, à l’instar du Frankie de Lola, ou bien meurtri à jamais, comme le Guy des Parapluies. En attendant, il a perdu Lola, comme Roland avant lui. En résumé, on est chez Demy, les amours ne durent pas et tout se passe au plus mal. Ceux qui croient à la gentillesse, voire à la cucuterie du monde de Demy, en seront pour leurs frais.

Concrètement, Model Shop est un film dépouillé, un très beau documentaire sur le Los Angeles de 1968, road-movie bien plus intéressant que le trop flatté Easy Rider de Dennis Hopper, qui le suivra de peu (1969). Rien ne dépasse la mesure de l’humain et de ses sentiments. Aux Américains qui, séduits et attirés par le succès mondial des Parapluies et des Demoiselles, l’invitent pour qu’il tourne une comédie musicale plus ou moins classique (qui, de toute manière, eût été un film de Demy, puisqu’il s’approprie toujours ce qu’il fait et intègre chaque commande, chaque attente, dans son univers propre), il livre une œuvre austère et triste, sans danses et sans numéros, pourtant superbe, tout simplement. L’accueil réservé à Model Shop ne sera pas grandiose mais il lui sera néanmoins proposé de réaliser un autre film : il préfèrera rentrer en France pour se consacrer à Peau d’âne.
15:17 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 24 mars 2013
Demy, 13 : de la mise en abyme
Demy ne pratique pas seulement la récurrence, il effectue aussi quelques mises en abyme qui, d’une certaine manière, complètent les liens qu’il tisse entre les films.
Lorsque Lola, personnage récurrent du film Lola, évoque, dans Model Shop, son passé et, en même temps, celui de Michel, d’Yvon, de Frankie, de Cassard et de Jackie Demaistre, le réalisateur ajoute Catherine Deneuve, citée, elle, comme actrice, par le truchement d’un magazine glissé sous l’album de photographies de Lola.
Trois places pour le 26 est l’histoire (entre autres) d’un spectacle dans un film. Il s’agit d’une comédie musicale où se raconte la vie de Montand, mais une vie partiellement récrite, inventée, pas entièrement réelle, jouée par Montand sous son vrai nom. Parallèlement à cette évocation biographique plus ou moins authentique, Montand vit une histoire totalement imaginaire avec le personnage de Marion.
Anouchka, projet hélas non réalisé, est l’histoire d’un film dans un film. Une équipe de cinéma part tourner une adaptation d’Anna Karénine. Le film se serait ouvert avec une conférence de presse, évidemment en musique, dans laquelle Demy et Legrand eussent tenu leur propre rôle.
Les mises en abyme se retrouvent même dans les musiques, les chansons. Dans Les Demoiselles de Rochefort, les jumelles proposent aux forains quelques airs qu’elles peuvent jouer, et terminent par : « Ou préférez-vous entendre du Michel Legrand ? »
Dans Trois places pour le 26, Montand, dans l’air intitulé Ciné qui chante, cite quelques classiques du film musical et interprète soudain : « Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi », l’air, mondialement célèbre, des Parapluies de Cherbourg.
12:23 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 23 mars 2013
Demy, 12 : de la récurrence, II
On a coutume de dire que Demy a renoncé au principe des personnages récurrents après Model Shop. C’est parfaitement faux – à tout le moins inexact. Les citations d’un film à l’autre vont se poursuivre quelquefois.
Dans Une chambre en ville, le nom de Mme Desnoyers (Lola) qui habite Nantes où se déroule l’action, est inscrit au tableau fixé dans l’atelier d’Edmond Leroyer, le marchand de télévisions. Elle a déposé son poste chez lui, pour qu’il le répare ; l’espace-temps des personnages des différents films est parfaitement respecté. C’est bien une citation, Mme Desnoyers est bien un personnage récurrent.
Dans Trois places pour le 26, Marius Cerredo répond à un ouvrier qui lui apporte une information : « Je préviendrai Dambiel ». Dambiel était ouvrier aux chantiers navals de Nantes en 1955 (Une chambre en ville), on le retrouve aux chantiers navals de Marseille en 1988. C’est tout à fait plausible. Certes, il ne s’agit que d’une évocation : son nom est cité, mais on ne le voit pas à l’écran. Il reste qu’on ne voyait pas davantage Lola dans Les Parapluies, où Cassard l’évoquait seulement : « Autrefois, j’ai aimé une femme ; elle ne m’aimait pas. On l’appelait Lola ». On ne voyait pas, non plus, Mme Desnoyers dans Les Demoiselles, lorsque Dutrouz se la remémorait en même temps que son beau-frère et amant, Aimé le coiffeur. On ne voyait pas Cécile (Lola) lorsque Geneviève la mentionnait dans Les Parapluies.
Ainsi, quoi qu’on dise, Demy a poursuivi son dessein démiurgique jusqu’au bout. Lorsqu’il n’a pu faire apparaître le personnage à l’écran, il l’a cité dans le dialogue.
La plus belle récurrence, celle qu’on regrettera certainement toujours puisqu’elle n’a pas eu lieu, était prévue dans le scénario des Demoiselles. Demy en a parlé dans un entretien accordé à la presse, et son biographe Berthomé l’a raconté. Nino Castelnuovo n’était pas disponible au moment du tournage et l’idée fut perdue. De quoi s’agissait-il ? Le deuxième forain, Bill, devait être Guy Foucher, ce même Guy des Parapluies. Il était censé avoir perdu sa femme Madeleine – chez Demy, les amours ne durent guère – et avoir été sauvé du désespoir par Étienne, le premier forain, qui l’avait arraché à sa station-service et au Cherbourg de ses mauvais souvenirs, et emmené avec lui. Or, sur la place de Rochefort, il était frappé par la ressemblance de Delphine Garnier avec Geneviève Émery. Il lui disait combien elle ressemblait à cette fille qu’il avait tant aimée, lui montrait une photographie d’elle et s’entendait répondre : « Je suis tout de même mieux que cela » (Demy n’a pas peur de l’humour grinçant). Savoureuse scène où Catherine Deneuve se serait estimée plus belle… qu’elle-même. Mais la récurrence continuait car, un peu plus tard, on devait voir Cassard et Geneviève, avec la petite Françoise – fille de Guy – arriver à Rochefort et assister au numéro de danse de Delphine et de Solange. Et Guy, à l’intérieur du stand, ne voyait pas son ancien amour. Il ne sortait que Geneviève partie. Chez Demy, on se croise, on se rate toujours, on le sait. Encore une scène où Catherine Deneuve eût du jouer les deux rôles de Delphine et de Geneviève. Cela ne faisait pas peur à Demy, le grand tireur de ficelles, lui, l’ancien enfant qu’émerveillait le théâtre de marionnettes : il la dirigera ainsi dans Peau d’âne, où elle sera à la fois la mère et la fille puis, quelques scènes plus loin, la princesse et la souillon.
19:28 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 21 mars 2013
Demy, 11 : faire cent blancs

Lorsqu’à ses débuts, il ne peut disposer du budget qu’il désire, Demy traite le film en noir et blanc comme un film en couleurs. Lola et La Baie des anges sont dans ce cas. Par le jeu des contrastes, des veloutés, des oppositions, en résumé, par une remarquable photographie, Demy donne vie aux couleurs que la pellicule n’est pas à même de faire apparaître. La meilleure idée, en ce sens, est de faire de Jeanne Moreau une blonde platinée (à l’image, ses cheveux paraissent presque blancs) aux yeux fardés de noir, vêtue d’une robe imprimée blanche à grandes fleurs noires, ou bien d’une guêpière blanche. Le tout, dans une chambre d’hôtel aux murs qu’on devine blanchis à la chaux, sur lesquels se découpent des meubles sombres, qu’on voit noirs à l’écran. Dans La Baie des anges, l’alternance des ruelles obscures de Nice et de la plage étale sous l’éclatant soleil de la Côte d’Azur, remplit aussi cet office.

Dans Lola, la guêpière noire de l’héroïne, sa chambre aux murs blancs, le costume blanc de Frankie le marin de Chicago, celui de Michel, la voiture blanche de Michel, jouent le même rôle, auquel participe l’image surexposée de la lumière entrant par les vitres du café où Cassard se rend régulièrement, ou bien de celle pénétrant l’appartement de Mme Desnoyers. Ces noirs et blancs somptueux, ces éclairages le plus souvent naturels, savent conférer l’illusion de la couleur.


07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)
samedi, 16 mars 2013
Demy 10 : quelques dommages
Les ultimes films de Demy constituent des succès partiels, autant dire des semi-échecs (Une chambre en ville, Trois places pour le 26). Et un ratage complet, Parking. Il faut ajouter à cette liste un peu triste une série de projets passionnants, demeurés sans suite (Skaterella, Kobi, Anouchka).
On s’est déjà demandé pourquoi, regrettablement, Une chambre en ville n’avait pas eu le succès des Parapluies de Cherbourg. On sait que le public décide toujours, en définitive. Par conséquent, même s’il se trompe, il a en quelque sorte toujours raison.
Je n’ai jamais su démêler les raisons qui me font trouver Trois places pas entièrement réussi. Qu’est-ce qui ne va pas ? Est-ce parce que Montand est trop âgé pour le rôle, comme cela a été souvent dit ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je sais, ayant vécu à Marseille, qu’un baron n’habitera jamais sur la Canebière, mais avenue du Prado ou sur la Corniche. Peut-être est-ce parce que je sais pertinemment que le bar où Montand va retrouver Françoise Fabian n’existe pas. Peut-être parce que ma sœur fut engagée comme figurante parmi beaucoup d’autres, pour simuler le public applaudissant le spectacle joué dans le film (il s’agit d’une mise en abyme) et qu’elle m’a raconté avoir dû applaudir un rideau baissé sur une scène vide. Peut-être parce que j’ai travaillé autrefois dans la librairie, 21, rue Paradis, dans laquelle entre Montand : je vois immédiatement quels éléments de mobilier ont été enlevés pour permettre à l’opérateur de travailler ; je vois immédiatement que les deux libraires sont des actrices ; surtout, j’entends, et ça m’insupporte, l’accent supposé marseillais, totalement contrefait, inaudible, de celle qui joue la patronne. Peut-être parce que j’imagine bien que Montand, tout Montand qu’il est, ne pourra certainement pas pénétrer dans les chantiers navals, dans la zone de radoub, en voiture (à moins que Marius Cerredo ait prévenu, je ne sais pas). Peut-être parce que je trouve la scène finale, les retrouvailles sur les escaliers de la gare avec ce non-dit entre le père et la fille, sans parler de la mère qui ne saura sans doute jamais rien, expédiée trop rapidement, bien trop rapidement pour qu’on puisse y croire, même dans le cadre d’une stylisation courante chez Demy. Peut-être pour l’ensemble de ces raisons, finalement. Pour résumer, j’aime beaucoup Trois places pour le 26, mais je voudrais l’aimer moins mal et je n’y parviens pas. Et puis, je trouve que c’est un mauvais titre, et je suis très sensible aux titres. Au vrai, le demi-échec est souvent ce qui arrive aux projets anciens n’ayant pu aboutir, qu’on remanie lorsque les circonstances sont plus favorables : Dancing et Les Folies passagères ont abouti à Trois places pour le 26, mais le temps avait passé, Montand changé et le scénario été remanié, d’ailleurs intelligemment, mais perdant ainsi sa fraîcheur initiale.
Si Parking est un ratage, on sait au moins pourquoi. Demy aussi le savait, et il le savait en le tournant. La responsabilité essentielle de l’échec artistique de ce film repose sur Francis Huster, ridicule, lamentable, aussi charismatique qu’une andouillette bouillie, le tout, dans un rôle où il est censé être un chanteur rock, galvanisant des salles entières. Qui plus est, le producteur a imposé par contrat qu’il chante lui-même, sans le dire à Demy, qui fut obligé de faire avec. Le résultat est au-dessous de tout. À sa décharge, Huster, par la suite, a admis cette erreur, disant que ce film était pour lui « une casserole » qu’il traînait, et reconnaissant que chanter est un métier, que ce n’était pas le sien. L’actrice japonaise également imposée fut choisie sur une photographie et apprit son rôle phonétiquement puisqu’elle ne parlait pas français. Ce que les Anglo-Saxons appellent miscasting – on parlera, plus simplement, d’erreur de distribution – est ici gigantesque. Et pourtant, refaire le mythe d’Orphée aujourd’hui ; réintroduire le personnage de Caron comme dans La Baie des anges, toujours au volant d’une voiture noire ; saluer Cocteau et engager Jean Marais pour jouer Hadès ; employer Marie-France Pisier, délicieuse dans n’importe quel rôle, pour être Perséphone ; présenter l’enfer comme une administration ; traiter les couleurs de l’enfer comme elles le sont ; imaginer qu’on y accède par un parking souterrain, en pénétrant le mur d’une zone réservée ; traiter simultanément la bisexualité (Orphée), l’homosexualité (les Bacchantes), l’inceste (Hadès est l’oncle de Perséphone), la drogue, tant de choses encore ; faire assassiner Orphée par les Bacchantes, ou par un admirateur, à l’instar de Lennon (le film ne permet pas de le savoir) ; se permettre des astuces comme cette carte de visite d’une agence artistique, que présente Perséphone à Orphée : Hadès (quand il a existé réellement une maison de disques appelée Adès) ; tout cela ne manquait pas d’ambition, d’imagination, d’humour. Mais le budget était insuffisant, le délai de réalisation trop court, et Huster impossible à admettre.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 15 mars 2013
Demy, 9 : un cinéma en Demycolor
Dans le monde en couleurs dans lequel vivent Geneviève et sa mère – Jean-Pierre Berthomé a excellemment détaillé ce sujet –, Roland Cassard introduit le noir : son pardessus, sa voiture, son costume. Quand elle accepte de l’épouser, Geneviève perd ses couleurs : d’abord avec sa robe de mariée, certes belle mais blanche ; ensuite, en montant, au sortir de l’église, dans la voiture noire de son mari qui, pour l’occasion, a fait appel à un chauffeur. On ne la reverra qu’à la fin du film, vêtue d’un manteau noir, un bandeau noir dans les cheveux et conduisant elle-même la voiture noire. Le tout dans un environnement blanc dû à la neige et à la station-service.

Dans l’intervalle, Guy revient de l’armée, il n’est au courant de rien et s’inquiète du silence de celle qui l’a abandonné. Au sortir de la gare, il court droit au magasin de parapluies, qui n’existe plus. Quand il y repasse un peu plus tard – et c’est la première fois qu’il y entre –, il croise des livreurs en train d’installer des machines à laver. L’endroit est devenu une blanchisserie et on l’en fait sortir sans ménagement : « Qu’est-ce que tu cherches ? Alors, pousse ta viande. Tu vois bien que tu gênes ». Le blanc règne en maître et chasse Guy, témoin du temps où Geneviève était en couleurs.
Mais le blanc chez Demy, et Berthomé l’a aussi expliqué, c’est l’amour : celui de Lola qui attend sept ans durant le retour de Michel – l’homme reviendra, vêtu de blanc, dans une voiture américaine blanche (Lola) ; celui du costume de Cassard, lorsqu’il fait son ultime déclaration sur les quais de Cherbourg (« Nous élèverons cet enfant ensemble ») ; celui des vêtements de Lola, que George remarque aussitôt dans les rues de Los Angeles (Model Shop). Mais voilà, Lola se retrouve seule une fois de plus, George également, et l’on peut tout supposer de la suite du mariage de Geneviève et Cassard. Il n’est guère que dans Peau d’âne que le mariage se fait dans une grande scène finale, toute blanche. Quant au Joueur de flûte, il emmène Dieu sait où une théorie d’enfants vêtus de blanc, et ils disparaissent à nos yeux. L’amour, dans ces films, ne dure pas. Le blanc se salit vite, c’est connu.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 14 mars 2013
Demy, 8 : un autre point de vue
On considère habituellement, biographes et critiques s’accordent en cela, que lors de la dernière scène des Parapluies de Cherbourg, Guy et Geneviève n’ont plus rien à se dire, qu’ils échangent quelques paroles banales et se séparent.
J’ai un point de vue sensiblement différent et, honnêtement, rien, dans ce que je vois à l’écran lorsque je regarde cette scène, ne me convainc de mon erreur.
Geneviève regagne Paris après être allée chercher sa fille en Anjou et elle passe par Cherbourg. Cela a déjà été relevé, certes, mais il faut le redire : on ne passe pas par Cherbourg lorsqu’on fait ce trajet. Elle-même précise : « J’ai fait ce détour ». Mais il ne s’agit pas d’un détour, il s’agit d’un véritable détournement, si j’ose dire. Elle est donc revenue volontairement, cela ne fait aucun doute. À partir de là, diverses interprétations sont possibles. Elle pouvait vouloir revoir sa ville, tout simplement. Soit. D’ailleurs, elle ne savait même pas, en principe, ce qu’était devenu Guy. On peut donc penser qu’elle venait uniquement se ravitailler en essence et qu’elle a abouti à « L’escale cherbourgeoise » par hasard. Aurait-elle su ce que Guy avait fait de sa vie, elle ignorerait de toute façon de quelle station-service précise il était le gérant. Admettons qu’elle se soit renseignée dans Cherbourg et qu’on ait su la diriger. Dans ce cas, elle arriverait à la station volontairement.

Quoi qu’il en soit, voilà les deux anciens amoureux face à face. Que se passe-t-il ?
Guy lui dit : « Viens au bureau ». On sait ce que « le bureau » signifie pour lui. Dans ses rêves d’autrefois, il disait : « Nous achèterons une station-service toute blanche, avec un bureau, tu verras ». Le bureau, c’est aussi l’endroit d’où Aubin, son ancien patron, l’appelait. Il était convoqué au bureau, alors qu’il se trouvait à l’atelier. Le bureau, c’est l’endroit du patron. On peut estimer qu’à son tour, il convoque Geneviève au bureau.
On s’accorde aussi à dire qu’à cet instant de l’histoire, Geneviève a remplacé sa mère et que, selon toute vraisemblance, elle aura plus tard avec sa fille les mêmes rapports que sa mère avait avec elle. Je pense que les choses sont différentes.
Elle regarde le bureau, l’arbre de Noël, pose des questions, propose à Guy de voir leur fille, se moque éperdument du type de carburant que lui propose le pompiste (Guy a maintenant un ouvrier, il est vraiment patron). Puis, le plein fait, Guy lui dit : « Je crois que tu peux partir » et, en cet ultime instant, elle se retourne avant de passer la porte et tente une dernière interrogation : « Toi, tu vas bien ? », avec un regard qui ne signifie pas du tout, à mon sens, qu’elle désire s’en aller. Guy ne prête pas le flanc à ce qui, pour moi, est une invite. Avec son « Je crois que tu peux partir », il la met purement et simplement à la porte. À la porte du bureau, donc de sa vie.
Je crois que Geneviève désirait rester. Je ne suis pas certain que cela ait été préconçu, mais, une fois Guy retrouvé, quelque chose me dit qu’elle imagine une suite possible. Rien ne l’obligeait à suivre Guy au bureau, à lui parler, même peu et de façon générale.

J’imagine que Guy, pas fou, a les pieds sur terre et tient à ce qu’il a construit avec Madeleine. À ce propos, on a beaucoup écrit aussi qu’il épousait Madeleine sans l’aimer vraiment, par défaut en quelque sorte. Ce n’est nullement certain. On a encore écrit que, son grand amour déçu, il se résignait à une vie médiocre avec une autre. Pas du tout : sa vie de gérant de station-service, c’est ce qu’il a toujours désiré. En quoi est-ce médiocre ? Par ailleurs, vendre de l’essence est-il plus minable que vendre des parapluies ? C’est là un raisonnement à la Mme Émery. Ce n’est pas sérieux. Guy vit donc ainsi qu’il l’a toujours voulu et il ne va pas tout détruire parce qu’une commerçante embourgeoisée (Geneviève n’est rien d’autre) est de retour.
Cassard ou non, Geneviève commençait à oublier Guy dès les premières semaines qui suivirent son départ (air « C’est drôle l’absence »). Si Cassard n’avait pas été là, elle aurait épousé Guy sans amour, ou peut-être se serait-elle mariée avec un autre homme. Je tiens que Madeleine était la meilleure chance de Guy. Je tiens que Guy l’a échappé belle. En poussant le raisonnement jusqu’à son terme, il apparaît que c’est Cassard qu’il faut plaindre. C’est lui que sa femme a épousé par défaut. On peut même aller jusqu’à supposer qu’elle ne lui a pas fait part de son intention de retourner à Cherbourg. Autrement dit, elle lui a menti et lorsqu’on commence à mentir, dans un couple, cela n’augure rien de bon.
Je ne crois pas faire ici un contresens : Geneviève, dans l’instant où elle se trouve « au bureau », imagine quelque chose. Elle ne l’a pas cherché, mais elle est prête, elle se sent brusquement prête à. À quoi ? Elle n'en sait rien elle-même. Le film ne nous le dit pas, mais il ne nous interdit certainement pas d’y penser. Cela étant, je ne tiens pas à avoir raison contre tout le monde. Il est possible que je ne sois pas dans le vrai.
12:26 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)
mercredi, 13 mars 2013
Demy, 7 : l’image de la mère
 La mère, chez Demy, a, heureusement pour elle, une meilleure image que celle du père.
La mère, chez Demy, a, heureusement pour elle, une meilleure image que celle du père.
Elle est fille-mère (Geneviève dans Les Parapluies, Violette dans Une chambre en ville), est veuve et vit avec sa ou ses filles (Mme Desnoyers dans Lola, Mme Émery dans Les Parapluies de Cherbourg, Yvonne Garnier dans Les Demoiselles de Rochefort, la mère de Violette dans Une chambre en ville), a son mari en prison et vit seule avec sa fille (Marie-Hélène de Lambert dans Trois places pour le 26).
 Variantes : elle espère le retour de son mari et vit seule avec son fils (Lola dans Lola), elle est veuve s’entendant mal avec sa fille et vivant dans le souvenir de son fils décédé (Mme Langlois dans Une chambre en ville).
Variantes : elle espère le retour de son mari et vit seule avec son fils (Lola dans Lola), elle est veuve s’entendant mal avec sa fille et vivant dans le souvenir de son fils décédé (Mme Langlois dans Une chambre en ville).
Elle est entraîneuse (Lola dans Lola), commerçante (Mme Émery et Yvonne Garnier, déjà citées), modèle (Lola dans Model Shop), coiffeuse (Irène de Fontenoy dans L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune), vendeuse (Violette, déjà citée), bourgeoise prostituée (Édith dans Une chambre en ville).
La constance de Demy à nous présenter cet éternel couple veuve-fille qui, malgré quelques différends, s’aime beaucoup, fait qu’on se demande parfois si lui-même ne se rêve pas en fille seule avec sa mère, le père écarté pour cause de décès ou d’emprisonnement.
Seule Irène de Fontenoy, déjà citée, a une famille classique : père-mère-fils, mais voilà que le père se retrouve enceint.
À ces situations renouvelées et perpétuées à la fois, s’ajoute la différence de classes comme dans Une chambre en ville : Guilbaud est métallurgiste, Mme Langlois, autrefois baronne de Neuville, est veuve d’un colonel. Comme il est fréquent chez un fils d’ouvriers, on remarque chez Demy une certaine déférence envers l’aristocratie, censée protéger le peuple alors que les bourgeois l’oppriment, supposée apprécier les arts alors que les bourgeois détestent les artistes. On trouve une deuxième aristocrate, la baronne de Lambert, mais celle-ci est, au vrai, une ancienne entraîneuse : elle est devenue baronne par son mariage avec un baron, tandis que la première, baronne de Neuville, avait fait, en épousant un militaire, le colonel Langlois, une mésalliance : elle était devenue une bourgeoise, par ailleurs ennemie de sa classe (« Ça vous épate la bourgeoisie qui, comme moi, s’envoie en l’air. Moi, voyez-vous, Guilbaud, j’emmerde les bourgeois »). Mais la bourgeoisie, par le biais des CRS qu'elle paie et qui la protègent, tuera Guilbaud, entraînant ainsi la mort d’Édith, fille de Mme Langlois. Celle-ci, après avoir perdu son mari et son fils, verra sa fille se suicider sous ses yeux... dans la minute qui suit la mort de Guilbaud, laquelle a lieu devant Violette, enceinte de lui. Tout cela est très gai, certes.
La différence de classe est présente aussi dans Les Parapluies de Cherbourg, où elle est double : Mme Émery est une commerçante rêvant de toujours davantage s’embourgeoiser alors que Guy Foucher, mécanicien dans un garage, est un ouvrier ; mais Roland Cassard, devenu diamantaire richissime (lui qui était sans situation dans Lola), est un plus grand bourgeois qu’elle, et cela pèse évidemment dans la balance lorsqu’elle est séduite par lui et qu’elle l’épouse indirectement en influençant sa fille pour qu’elle devienne Mme Cassard. 
Si Guy pouvait, par ses seules qualités, espérer séduire et conserver la jeune marchande de parapluies, il ne peut plus faire face lorsqu’apparaît Cassard, avec son pardessus, sa Mercédès et ses joyaux (et, ajoutons-le pour être juste, son amour sincère pour Geneviève, dont il adopte l’enfant à venir). En résumé, Guy pouvait gravir un échelon, pas deux ou davantage. Il perd la partie (une partie dont il ne savait même pas qu’il était en train de la jouer et dont le dernier pli est levé durant son absence) et retourne à son milieu d’orphelin élevé par sa marraine, tante Élise, vaincu socialement, mais vainqueur par l’amour enfin révélé de Madeleine, la jeune infirmière.
17:10 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 12 mars 2013
Demy, 6 : d’un opéra populaire à l’autre

Pourquoi le film Une chambre en ville n’a-t-il pas reçu un accueil aussi enthousiaste que Les Parapluies de Cherbourg ? Tous deux sont des opéras populaires, tous deux sont entièrement chantés.
Comme de coutume, il n’y a pas de raison unique, mais un ensemble de causes.
La musique de Michel Colombier, magnifique partition, n’est pas aussi chantante que celle de Legrand. On ne peut pas isoler d’airs, détacher des « chansons » du contexte.
La lutte des classes « paie » moins, au cinéma – ou dans ce que les spectateurs de Demy attendent faussement de lui ? – que les amours malheureuses. Et pourtant, les amours malheureuses sont aussi présentes dans Une chambre en ville, ô combien.
Les grèves de 1955 aux chantiers navals de Nantes intéresseraient-elles moins le public que la guerre d’Algérie ? 
Dans Les Parapluies, Geneviève est infidèle : elle se lasse assez vite d’attendre son amoureux parti à la guerre, emporte avec elle l’enfant qu’il lui a fait et épouse Cassard, qui donnera son nom à la fille de Guy. Cela serait-il mieux accepté que François Guilbaud abandonnant purement et simplement Violette enceinte de ses œuvres, au milieu d’un marché où l’on balaie les détritus ? Est-ce que, par hasard, le public ne saurait aimer Guilbaud après cet acte lâche, minable, la passion qu’il vit avec Édith ne le dédouanant pas, sa mort tragique ne l’excusant pas, celle d’Édith se suicidant sous les yeux de tous les protagonistes du film ne rachetant rien ?
On compte deux suicides (dont un particulièrement violent, sur le plan visuel) et une mort tragique dans la dernière partie du film : serait-ce trop pour être accepté ?
La stylisation d’Une chambre en ville est-elle plus grande que celle des Parapluies ? Ces grévistes qui lancent sur les CRS des pavés imaginaires, des pavés ramassés nulle part et qu’ils ne portaient pas dans leurs mains avant l’affrontement, seraient-ils moins crédibles que Guy et Geneviève montés sur le travelling et paraissant glisser, flotter dans leurs rêves d’amour, au lieu de marcher comme ils sont censés le faire ?

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 11 mars 2013
Demy, 5 : la figure du père
 Chez Demy, le père est absent : le plus souvent décédé, ou bien parti, et même en prison. Quand, d’aventure, il est présent, il se nomme M. Fournier (La Baie des anges), exerce la profession d’horloger, ce qui suppose, au moins dans le film, un caractère strict, précis, et porte une blouse blanche. Il est autoritaire, fermé, il ne veut pas le savoir. Parfois, un substitut de père apparaît, en la personne du patron : le garagiste Aubin, par exemple (Les Parapluies de Cherbourg). Aubin, lui aussi, porte une blouse blanche, ce qui n’est pourtant pas le plus courant dans un atelier de mécanique.
Chez Demy, le père est absent : le plus souvent décédé, ou bien parti, et même en prison. Quand, d’aventure, il est présent, il se nomme M. Fournier (La Baie des anges), exerce la profession d’horloger, ce qui suppose, au moins dans le film, un caractère strict, précis, et porte une blouse blanche. Il est autoritaire, fermé, il ne veut pas le savoir. Parfois, un substitut de père apparaît, en la personne du patron : le garagiste Aubin, par exemple (Les Parapluies de Cherbourg). Aubin, lui aussi, porte une blouse blanche, ce qui n’est pourtant pas le plus courant dans un atelier de mécanique.
Parfois, après être parti, il revient, mais c’est toujours longtemps après, plusieurs années parfois, et il est encore vêtu de blanc, comme Michel (Lola). Cela ne l’empêche pas de repartir quelque temps plus tard, cette fois pour de bon. On trouve aussi le père du sketch La Luxure, tout juste bon à distribuer des gifles au fils qui pose une question. Ou le père ultra-conservateur et autoritaire de Lady Oscar, qui décide que sa fille sera un garçon et finit, des années plus tard, par se battre avec elle à l’épée.
Souvent, les personnages ignorent qui est leur père. C’est le cas de Cécile (Lola) : elle ignore que son oncle Aimé est en réalité son père. C’est le cas de Françoise Cassard (Les Parapluies de Cherbourg) : elle ignore que Guy est son père et qu’elle devrait s’appeler Foucher. C’est le cas de Boubou (Les Demoiselles de Rochefort) : il ignore que Simon Dame est son père. C’est le cas de Delphine et de Solange (Les Demoiselles de Rochefort) : elles ignorent qui est leur père et portent le nom de leur mère, Garnier. C’est le cas de l’enfant que porte Violette (Une chambre en ville) : il ignorera que François Guilbaud est son père. C’est le cas de Marion (Trois places pour le 26) : elle s’appelle Lambert quand elle devrait s’appeler Montand ; elle ignore que Montand est son père et va pousser jusqu’au bout le rêve d’inceste qui traverse toute l’œuvre de Demy.
Parfois, le père est tout bonnement en prison : le baron de Lambert, père adoptif de Marion (Trois places pour le 26) a cet avantage d’ainsi ne déranger personne. Ici, le père est un pur et simple escroc. Parfois, il vit loin, son fils lui téléphone et leur conversation tourne court à force d’incompréhension : c’est ce qui arrive à George (Model Shop).
Les autres fois, le père est mort. M. Émery, père de Geneviève (Les Parapluies de Cherbourg). Le colonel Langlois, père d’Édith (Une chambre en ville). Ou bien il vend sa fille au fils du baron (Le Joueur de flûte). À moins qu’il ne veuille l’épouser (Peau d’âne). Ou qu’il soit enceint (L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune).
On l’aura compris, le portrait du père, chez Demy, n’est guère reluisant. M. Demy père, le garagiste, a-t-il tant dressé son fils contre lui, au moins inconsciemment, en refusant au début sa vocation de cinéaste, en voulant à tout prix qu’il aille au collège technique apprendre un métier manuel, avant de céder au bout d’un long moment devant l’obstination du jeune Jacques ?
09:49 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 10 mars 2013
Pour sauver le plus beau film du monde
« La société familiale Ciné-Tamaris a besoin de votre aide pour numériser, restaurer le film et le proposer aux normes actuelles de projection ».
J’ai vu, il y a quelques jours, que la famille Demy-Varda lançait un appel, une sorte de souscription pour sauver Les Parapluies de Cherbourg et permettre de continuer à exploiter le film, en le restaurant en numérique. Le pourquoi du comment, la méthode et le suivi de l'opération sont présentés sur une page spéciale, qui explique tout en détail. On peut verser de 1 à 6. 000 euros avec, chaque fois, d'amusantes et artistiques contreparties. Voici le lien :
http://www.kisskissbankbank.com/il-faut-sauver-les-parapluies-de-cherbourg
20:30 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 08 mars 2013
Demy, 4 : de la récurrence
En littérature, en bande dessinée, les personnages récurrents sont aisés à animer. Il suffit à l’auteur de désirer les faire apparaître et réapparaître. Au cinéma, c’est bien plus difficile : les acteurs doivent être toujours vivants, intéressés par le nouveau projet et, bien entendu, libres au moment du tournage.
En dépit de ces obstacles, Demy qui, au commencement de son aventure, voulait réaliser cinquante films, pas moins, et que toutes ces œuvres soient liées entre elles (il n’est malheureusement pas parvenu à ses fins) a tout de même abouti au schéma suivant.
Personnages récurrents, présents à l’écran ou simplement évoqués
Jackie Demaistre : La Baie des anges ; évoquée dans Model Shop.
Michel : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Mme Desnoyers : Lola ; évoquée dans Les Demoiselles de Rochefort ; évoquée dans Une chambre en ville.
Cécile : Lola ; évoquée dans Model Shop.
Lola : Lola ; évoquée dans Les Parapluies de Cherbourg ; Model Shop.
Roland Cassard : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg ; évoqué dans Model Shop.
Frankie : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Yvon : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Aimé : évoqué dans Lola ; évoqué dans Les Demoiselles de Rochefort.
M. Favigny : évoqué dans Lola ; évoqué dans Trois places pour le 26.
Dambiel : Une chambre en ville ; évoqué dans Trois places pour le 26.
Il était par ailleurs question que Guy (Les Parapluies de Cherbourg) réapparaisse dans Les Demoiselles de Rochefort, mais cela n’a pu se faire.
À noter que Demy s’autorise une mise en abyme au milieu d’une récurrence : lorsque Lola, personnage récurrent du film Lola, évoque, dans Model Shop, son passé et, en même temps, celui de Michel, d’Yvon, de Frankie, de Cassard et de Jackie Demaistre, le réalisateur ajoute Catherine Deneuve, citée, elle, comme actrice, par le truchement d’un magazine glissé sous l’album de photographies de Lola.
Toutefois, l’univers du cinéaste se prolonge dans le sens de la récurrence, à travers une série de lieux et de situations.
Lieux et situations
Cafés tenus par des femmes : Lola ; Les Demoiselles de Rochefort.
Mères vivant seules avec leurs filles : Lola (Mme Desnoyers et Cécile) ; Les Parapluies de Cherbourg (Mme Émery et Geneviève) ; Les Demoiselles de Rochefort (Yvonne Garnier et les jumelles) ; Une chambre en ville (la baronne et Édith) ; Trois places pour le 26 (la baronne et Marion).
Pères absents, ailleurs ou décédés : Lola (Cécile rejoint son oncle Aimé à Cherbourg, sans savoir qu’il est son père) ; Les Parapluies de Cherbourg (père de Geneviève décédé) ; Les Demoiselles de Rochefort (jumelles sans père ; Boubou ne sait pas que M. Dame est son père) ; Une chambre en ville (père d’Édith décédé) ; Trois places pour le 26 (père adoptif de Marion en prison ; Marion passe la nuit avec Montand, sans savoir qu’il est son père).
Femmes enceintes sans mari : Les Parapluies de Cherbourg ; Une chambre en ville.
Marraines influentes : Les Parapluies de Cherbourg ; Peau d’âne.
Baronnes désargentées : Une chambre en ville (baronne qu’une mésalliance a faite colonelle et qui, veuve, doit louer une chambre à un ouvrier) ; Trois places pour le 26 (entraîneuse devenue baronne, mais le baron est ruiné et sous les verrous).
Dîner à trois (veuve, fille et Cassard) : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg.
Enfer : Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Parking.
Foires, fêtes foraines, carnavals : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Le Joueur de flûte.
Forains ou artistes arrivant en ville et amenant l’action avec eux : Les Demoiselles de Rochefort ; Le Joueur de flûte ; Trois places pour le 26.
Personnages partant, devant partir bientôt ou désirant partir : Lola ; La Baie des anges ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Model Shop ; Peau d’âne ; Le joueur de flûte ; Trois places pour le 26.
Personnages se croisant, au début sans se connaître : Lola ; La Baie des anges ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Une chambre en ville ; Trois places pour le 26.
Homosexualité, bisexualité, ambiguïté sexuelle : Lady Oscar ; La Naissance du jour ; Parking.
Inceste ou sentiment incestueux : Lola ; Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Les Demoiselles de Rochefort ; Peau d’âne ; Une chambre en ville ; Trois places pour le 26.
Ports : Lola (Nantes) ; La Baie des anges (Nice) ; Les Parapluies de Cherbourg (Cherbourg) ; Les Demoiselles de Rochefort (Rochefort-sur-Mer) ; Une chambre en ville (Nantes) ; Trois places pour le 26 (Marseille).
Librairies : Lola ; Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Trois places pour le 26.
Petits commerces : Lola (coiffure) ; La Baie des anges (horlogerie) ; Les Parapluies de Cherbourg (magasin de parapluies ; garage) ; Les Demoiselles de Rochefort (magasin de musique) ; L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune (coiffure ; auto-école) ; Une chambre en ville (magasin de télévision) ; Trois places pour le 26 (parfumerie).
Passage Pommeraye : Lola ; mentionné dans Les parapluies de Cherbourg ; Une chambre en ville.
Principaux lieux où se concentre l’action et où se retrouvent tous les personnages : Les Parapluies de Cherbourg (magasin de parapluies) ; Les Demoiselles de Rochefort (café sur la place) ; Une chambre en ville (chez la baronne).
Rendez-vous donné « à huit heures devant le théâtre » : Lola (Lola à Cassard) ; Les Parapluies de Cherbourg (Geneviève à Guy).
Voitures noires survenant comme de mauvais présages : La Baie des anges (Citroën de Caron) ; Les Parapluies de Cherbourg (Mercédès de Cassard) ; Parking (Porsche de Caron).
Ces relevés, peut-être non exhaustifs, montrent que les films sont davantage liés entre eux, qu’il n’y paraît au lu d’une simple liste de personnages récurrents. Ils montrent encore la cohérence absolue du monde de Demy. On note que la récurrence, qu’elle soit des personnages, des lieux ou des situations, se manifeste indépendamment du genre des films (opéras populaires filmés, comédies musicales, films avec chansons, contes) et de la technique (noir et blanc, couleur).


Marc Michel joue Roland Cassard dans Lola et dans Les Parapluies de Cherbourg


Anouk Aimée joue Lola dans Lola et dans Model Shop
07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 07 mars 2013
Demy, 3 : demeurer un chef-d’œuvre
Pourquoi le film Les Parapluies de Cherbourg demeure-t-il un chef-d’œuvre ? Au moment de son tournage, pouvait-on se douter qu’il ferait le tour du monde et que, cinquante ans plus tard, on en parlerait encore, mieux : que la ville de Cherbourg organiserait des manifestations commémoratives ?

Comme toujours, il n’y a pas de réponse et l’on ne peut avancer que l’exposé d’une série de causes, d’un faisceau de raisons. L’authenticité absolue du cinéaste, évidemment. L’invention géniale d’un genre, naturellement. La création de couleurs et de costumes encore jamais vus, en tout cas, jamais vus réunis. La rencontre parfaite, faut-il le dire, de deux créateurs, deux artistes, Demy et Legrand, et l’osmose de leur collaboration. L’exigence et la rigueur de l’auteur, palpables dès la première vision, vérifiables au long des dizaines qui suivirent. La fluidité d’un filmage et d’un montage, parfaitement incontestables. La photographie, juste et précise, d’une société donnée à une époque donnée, tellement juste et tellement précise que, paradoxalement, elle sort du temps et devient universelle, un peu comme ces photographies de classes qui deviennent, avec les années, l'école elle-même.
Et ce film magnifique, non content de ramasser le prix Delluc et la Palme d’or au passage, comme sans s’en apercevoir, révèle et consacre en même temps un réalisateur, un compositeur, une productrice et une actrice. Seulement.

Les Parapluies de Cherbourg : tournage de la scène du départ de Guy, sur le quai de la gare : le travelling arrière est effectué à une vitesse différente de celle du train, ce qui crée un bel effet visuel (Photo DR, Ciné-Tamaris).
07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (8)
mercredi, 06 mars 2013
Demy, 2 : le plus beau film du monde
 Je ne sais pas de film plus réellement populaire, plus réussi que la merveille de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, avec la musique de Michel Legrand. C’est une fête somptueuse, bâtie sur un argument cruel au possible, œuvrée dans un décor aux couleurs inimaginables.
Je ne sais pas de film plus réellement populaire, plus réussi que la merveille de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, avec la musique de Michel Legrand. C’est une fête somptueuse, bâtie sur un argument cruel au possible, œuvrée dans un décor aux couleurs inimaginables.
Tout ici est une réussite, du générique où se croisent les parapluies filmés à la verticale, à la dernière image, celle de cette station-service dans la nuit, sous la neige de Noël, avec toutes ses lumières, tel un gâteau blanc sous le rouge cerise des pompes à essence. De la partition remarquable en tous points, qui a su permettre de chanter l’intégralité du texte, même lorsqu’il était extrêmement prosaïque (les scènes qui se déroulent au garage Aubin, par exemple), à la voix des chanteurs doublant les comédiens, qui furent tenus de jouer sur un rythme plus lent qu’au naturel. De ce choix de couleurs plus que vives (on peut même dire que certaines nuances furent absolument inventées en 1964) au contraste qu’il crée, justement, avec la noirceur du thème. C’est bien d’un opéra qu’il est question, non d’une simple comédie musicale. L’ambition même du genre s’oppose à la modestie de Guy, de Geneviève et de Mme Emery, de Madeleine ou de tante Élise. On narre une histoire triste, de tous les jours, qui, avec des personnages communs, banals, se déroule dans des milieux modestes dans une ville de province, à une époque, la plus conformiste qui soit. Mais on a fait appel à tous les talents, à toutes les inventions, on a servi le film avec amour et, de là, naît un authentique et incontestable chef-d’œuvre.
Si notre société n’a strictement plus rien à voir avec celle qui est montrée dans ce film, on le regarde encore aujourd’hui d’un œil que la nostalgie n’a même pas besoin d’attendrir. Parce qu’il reste présent, quotidien. Tour de force artistique, cette œuvre est à la fois « décalée » et « en phase » par rapport à nous. Ce qui aurait pu n’être qu’une délicieuse bluette, même tournant mal, ne se démodera jamais parce qu’ayant touché à l’universel. Cette histoire reste un bout du génie de l’humanité, un trésor de la création populaire bien comprise, respectueuse de son public et authentiquement engagée dans une démarche d’artiste consciente.
Ce film mémorable supporte plutôt bien d’être vu sur un petit écran, ce qui est rare. Il ne s’éloigne jamais, en effet, de l’intimisme inhérent à son sujet, même si la toile de fond est celle de la guerre d’Algérie, historique. Ce n’est pas pour autant un spectacle « familial » car, s’il arrive qu’on y pleure des larmes jamais vulgaires, il pourrait bien se produire aussi que l’injustice du destin y révolte des cœurs tendres.
 Des esprits jeunes, en effet, souffriront de voir Mme Emery pousser Geneviève, enceinte de Guy, à épouser Roland Cassard, diamantaire protecteur. Ils comprendront mal qu’elle n’ait pas absolument tort d’agir ainsi, contexte socioculturel aidant. Ils donneront à Guy, soldat absent, toute leur sympathie, au détriment de Cassard.
Des esprits jeunes, en effet, souffriront de voir Mme Emery pousser Geneviève, enceinte de Guy, à épouser Roland Cassard, diamantaire protecteur. Ils comprendront mal qu’elle n’ait pas absolument tort d’agir ainsi, contexte socioculturel aidant. Ils donneront à Guy, soldat absent, toute leur sympathie, au détriment de Cassard.
Et pourtant, risquons un point de vue différent de celui couramment partagé. Même en sachant, cela se voit à l’écran, que Mme Emery épouse Cassard par procuration en lui donnant sa fille, il reste que Cassard est réellement désintéressé, amoureux et sincère ; il sauve littéralement Guy d’un échec futur puisque, Cassard ou pas, enceinte ou non, Geneviève est bel et bien en train de l’oublier (« C’est drôle, l’absence ») parce que deux ans de séparation, c’est bien long, sans téléphone possible, au hasard de courriers qui n’arrivent pas. Guy et Geneviève, réunis, auraient couru au désastre. Allons, Cassard n’est pas si mal venu, n’est-ce pas ? Même si Geneviève l’épouse sans amour. Madeleine n’est pas qu’une consolation pour Guy car elle l’a, elle, toujours aimé en silence et attendu avec patience ; elle se serait effacée si elle l’avait dû, elle ne demande rien, jamais, ne réclame aucun sentiment qui n’aurait pas lieu d’être ; c’est Guy qui lui demande de rester, après la mort d’Élise qu’elle aura assistée jusqu’au bout. C’est avec elle et grâce à l’héritage d’Élise que Guy réalisera ses projets. C’est elle qui peut façonner son bonheur. Et c’est durant son absence d’un moment, à la fin du film, que revient Geneviève, par hasard (un hasard qui, alors qu’elle rallie Paris au départ de l’Anjou, la fait passer par Cherbourg !), prendre de l’essence pour la Mercedes de Cassard, qu’elle conduit à présent. Cette même Mercedes que Guy n’a pas pu réparer, au début, parce qu’il ne pouvait pas faire une heure supplémentaire, et pour cause : il allait au théâtre... avec Geneviève. Qu’allaient-ils voir et entendre ? Un opéra. Cette scène ultime, dure mais si bien notée, pour ainsi dire décalquée dans le carnet de dessins de la vie tant elle est évidente pour qui a connu un bout d’amour une fois dans son existence, peut révolter les cœurs intègres. En attendant qu’ils en vivent un jour une copie, peut-être sans musique et sans trop de couleurs cette fois.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 05 mars 2013
Demy : que conseiller ?
 Si je devais recommander des films de Jacques Demy à quelqu’un qui ignorerait tout de ce cinéaste prodigieux, que choisirais-je ? Sans doute ne choisirais-je pas et dirais-je : « Il faut regarder, plusieurs fois de préférence, l’intégrale publiée il y a quelques années et qui, comme toute intégrale, ne l’est pas puisqu’il y manque deux courts-métrages de commande, mais enfin, ce n’est pas très grave puisque Demy ne les reconnaissait pas vraiment comme siens ».
Si je devais recommander des films de Jacques Demy à quelqu’un qui ignorerait tout de ce cinéaste prodigieux, que choisirais-je ? Sans doute ne choisirais-je pas et dirais-je : « Il faut regarder, plusieurs fois de préférence, l’intégrale publiée il y a quelques années et qui, comme toute intégrale, ne l’est pas puisqu’il y manque deux courts-métrages de commande, mais enfin, ce n’est pas très grave puisque Demy ne les reconnaissait pas vraiment comme siens ».
Mais encore ? Si je devais ? Eh bien, j’indiquerais évidemment les deux films qui ressortent d’un genre littéralement inventé par Demy, l’opéra populaire filmé. Inventé, oui, puisque personne n’avait jamais osé cela auparavant et que personne n’a plus jamais tenté de le faire ensuite, une fois le cinéaste disparu. Un genre, donc, définitivement marqué par lui, porteur de son empreinte, qui n’a rien à voir avec la comédie musicale stricto sensu, dont il a par ailleurs dessiné l’image à la française.
Un genre nouveau, qui l’est resté, où tout le texte, sans exception, est chanté. Opéra, puisqu’entièrement chanté. Populaire, puisque compréhensible. Filmé, pour la première fois. C’est tout simplement merveilleux.
On aura reconnu Les Parapluies de Cherbourg, que je tiens pour le plus beau film du monde, excusez du peu, et que j’ai dû voir vingt ou trente fois… pour le moment, car j’ai bien l’intention de continuer. On aura reconnu Une chambre en ville, qui n’eut pas le même succès, peut-être parce que le thème était plus noir encore que celui des Parapluies, peut-être parce que la musique de Michel Colombier contenait moins d’« airs » que celle de Michel Legrand. Pourtant, il s’agit ici de deux tragédies, raison de plus pour ne pas parler de comédies.
Après avoir regardé ces deux œuvres extraordinaires, il faudra poursuivre, explorer cent fois cet univers extrêmement bouleversant, traversé en permanence par les obsessions du cinéaste (bisexualité, inceste), où se promènent des personnages récurrents, où les destins se croisent, toujours dans l’amertume, où les amours ratent, sont condamnées par les guerres ou les grèves, où la figure du père, presque toujours absente, est montrée une fois ou deux d’une manière péjorative, où tous les clins d’œil et citations sont disséminés (comprenne qui pourra), où les personnages qu’on ne revoit pas physiquement sont cependant nommés au cours du dialogue, où, dans un port ou un autre, l’on va de départ en rupture, de désillusion en espoir caduc, où la pudeur de l’auteur vient farder tout cela de chansons et de gammes chromatiques éblouissantes... Bien entendu, on gagnera infiniment à regarder tout cela dans l’ordre chronologique.
univers extrêmement bouleversant, traversé en permanence par les obsessions du cinéaste (bisexualité, inceste), où se promènent des personnages récurrents, où les destins se croisent, toujours dans l’amertume, où les amours ratent, sont condamnées par les guerres ou les grèves, où la figure du père, presque toujours absente, est montrée une fois ou deux d’une manière péjorative, où tous les clins d’œil et citations sont disséminés (comprenne qui pourra), où les personnages qu’on ne revoit pas physiquement sont cependant nommés au cours du dialogue, où, dans un port ou un autre, l’on va de départ en rupture, de désillusion en espoir caduc, où la pudeur de l’auteur vient farder tout cela de chansons et de gammes chromatiques éblouissantes... Bien entendu, on gagnera infiniment à regarder tout cela dans l’ordre chronologique.

14:28 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 31 janvier 2013
Les deux Thérèse

Le chef d’œuvre de Mauriac, Thérèse Desqueyroux, adapté par Franju en 1962, avec des éclairages somptueux, un montage irréprochable et des plans très intéressants – voilà la supériorité définitive du noir et blanc sur la couleur.
La distribution est impeccable de bout en bout : Emmanuelle Riva, Philippe Noiret, Sami Frey, Édith Scob… La direction d’acteurs est parfaite.
L’adaptation a reçu le concours de Mauriac lui-même, assisté de son fils Claude, et c’est également Mauriac qui a écrit les dialogues, ainsi que le monologue intérieur de son héroïne.

Autant dire qu’on touche à la perfection et que le remake de Claude Miller, sorti en 2012, ne présente aucun caractère d’indispensabilité. D’autant moins que Miller a choisi la narration chronologique la plus bête quand le roman – et Franju avait conservé cela – s’ouvre sur Thérèse sortant du palais de justice en ayant bénéficié d’un non-lieu. Il ne faut pas se tromper de choix narratif car ici, le retour arrière a un sens authentique. On revient d’ailleurs au présent de l’action, à partir de l’arrivée de Thérèse chez elle. Miller a fait une erreur et je crois que c’est cela qui m’empêche d’aller voir son film, outre le fait que le réalisateur paraît, si j’en crois les images et la bande-annonce, être tombé dans tous les pièges de la reconstitution léchée et pourléchée. Cette reconstitution pour laquelle je choisis toujours un critère un peu sot, certes, mais irréfutable : les voitures. Dans la quasi-totalité des cas, les voitures, louées fort cher à des collectionneurs pointilleux, sont toujours rutilantes. Il n’y avait pas de voitures sales ou cabossées, du temps de Thérèse ? Jamais ? Au moins, chez Franju, la 403 de la famille (il a transposé l’action en 1962, au temps présent des spectateurs d’alors), après avoir roulé dans des chemins de campagne par temps de pluie, est sale. Ça n’a l’air de rien, mais cela évite de donner à l’image l’aspect d’un catalogue de constructeur automobile ou celui d’un journal de mode.

11:40 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 29 janvier 2013
Quand ils ne meurent pas, les aventuriers vieillissent mal
Je ne sais plus si j’avais vu Les Aventuriers lors de sa sortie, en 1967, mais je me rappelle avoir pris un grand plaisir à le regarder, il y a plusieurs années, à la vidéothèque des Halles. Je l’ai revu hier soir à la télévision. Je n’ai pas ressenti la même chose.
Les artifices techniques, aujourd’hui, sautent aux yeux. La descente en rase-mottes des Champs-Élysées par Delon pilote de monoplace est sans appel : on ne voit que la transparence, trucage alors habituel. La foule qui proteste sur l’aérodrome africain, que l’on découvre en retour arrière, narrée par Reggiani, cette foule mécontente que doivent contenir des militaires, demeure ce qu’elle est : des figurants obéissant scrupuleusement aux consignes et réagissant au signal. La vision censée être celle de Delon et Ventura, qui, tout en marchant, observent l’intérieur d’un atelier où travaillent des ouvrières, ne laisse voir aujourd’hui qu’un travelling sur rails, trop « lisse » qu’elle se trouve être, cette vision, et pas assez « heurtée » pour être celle de deux hommes qui se déplacent. La technique est vraiment ce qui, dans un film, vieillit le plus vite et, hélas, le plus mal.
L’histoire est toujours sympathique : deux aventuriers généreux comme il n’est pas permis, gamins grandis qui s’amusent à vivre leurs rêves et qui, seuls avec une femme dans un bateau pas très grand, ne la touchent pas, ne tentent rien, se comportent en amoureux transis ; deux aventuriers qui distribuent la part du trésor, revenant à la fille décédée, à son cousin, un gamin fils d’épiciers aux sentiments minables, seule famille de la disparue qu’ils se sont donnés un mal fou à retrouver. Bref, des aventuriers extrêmement improbables, comme on ne disait pas alors, mais attachants. À la fin, un beau combat dans un fort désaffecté, sur une île, où les héros se battent avec des armes abandonnées là, autrefois, par les nazis, Delon tué et Ventura qui descend les assassins à coups de grenades allemandes, ces grenades qu’on appelait des « tampons à soupe ». Ça a « de la gueule », comme on dit, mais sur un écran de télévision, ça ne donne pas grand-chose. Une belle histoire, donc – une esthétique de bande dessinée, une interprétation, faut-il le dire, impeccable – mais l’histoire étant ce qui m’intéresse le moins dans un film, je n’ai pas retrouvé la joie ressentie lors de la première vision.

10:01 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 21 janvier 2013
Qu’on me décharge de Témoin à charge
 Je n’avais jamais vu jouer Marlène Dietrich. Je reconnais qu’à soixante ans et quelques malencontreuses poussières, ce n’est pas très flatteur. Au vrai, en y réfléchissant, j’ai vu, si l’on peut dire, L’Ange bleu lorsque j’étais petit, dans les années 50. Mon père mettait sa main sur mes yeux, chaque fois qu’il estimait, certainement à raison, que la scène à l’écran n’était pas indiquée pour un enfant. Autant dire qu’il ne me reste rien de L’Ange bleu.
Je n’avais jamais vu jouer Marlène Dietrich. Je reconnais qu’à soixante ans et quelques malencontreuses poussières, ce n’est pas très flatteur. Au vrai, en y réfléchissant, j’ai vu, si l’on peut dire, L’Ange bleu lorsque j’étais petit, dans les années 50. Mon père mettait sa main sur mes yeux, chaque fois qu’il estimait, certainement à raison, que la scène à l’écran n’était pas indiquée pour un enfant. Autant dire qu’il ne me reste rien de L’Ange bleu.
J’ai regardé l’autre soir, à la télévision, Témoin à charge, film de 1957, sans intérêt. Les rebondissements d’une intrigue molle, adaptée de la pénible Agatha Christie, sont classiques. Le final à double ou triple détente est un procédé trop connu pour ajouter quelque chose à ce film considérablement vieilli et très impersonnel, sentant le studio à deux kilomètres. Aucun effet de montage, de filmage, aucun coup de caméra, aucune beauté plastique.
Il ne peut être sauvé de cela que l’interprétation impeccable de tous les acteurs et, bien évidemment, celle de Marlène Dietrich elle-même, magnifique, excellente. Pour le reste, quel ennui.
16:41 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)



