samedi, 24 décembre 2005
Les poètes conseilleurs
On sait, de Ronsard, l’attention absolue qu’il portait au temps qui passe et flétrit inexorablement, avec la mort au bout. Il a, de cette matière désespérée, modelé plusieurs magnifiques poèmes, tous très connus, à la fin desquels il ne manquait pas de conseiller à « mignonne » de se hâter. Se hâter de quoi, en fait ? De le rejoindre au déduit, bien sûr.
Corneille, nul ne l’ignore, a repris, un siècle plus tard, la manière, conseillant à Marquise – c’était son nom, je crois, pas un titre – de ne pas croire en sa jeunesse éternelle et de lui céder.
Deux siècles plus tard, ce fut au tour de Baudelaire, l’immense Baudelaire, de tarauder le cœur de la « belle ténébreuse » par un Remords posthume, lui conseillant de connaître très vite « ce que pleurent les morts ».
Un siècle après, Queneau a suivi la même voie, conseillant à la « fillette » de ne pas s'imaginer trop de choses et de se dépêcher de cueillir les roses dont parlait déjà Ronsard.
On peut se demander si toutes ces belles ne furent pas effrayées par les noirceurs que leur décrivaient ces hommes pour qui les mots n’avaient pourtant aucun secret. J’ignore s’il eurent gain de cause, mais la poésie française y a gagné des splendeurs.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (11)
jeudi, 22 décembre 2005
Ramuz
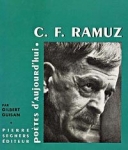 À l’instigation de Dominique Autié, je découvre Ramuz (1878-1947) à cinquante-trois ans. Il n’est jamais trop tard, dit-on. Il peut être tard, tout simplement. Car rencontrer un écrivain, une langue, une écriture en un temps où l’on ne supporte plus de lire des romans est ennuyeux. Il est vrai qu’il est aussi l’auteur d’essais.
À l’instigation de Dominique Autié, je découvre Ramuz (1878-1947) à cinquante-trois ans. Il n’est jamais trop tard, dit-on. Il peut être tard, tout simplement. Car rencontrer un écrivain, une langue, une écriture en un temps où l’on ne supporte plus de lire des romans est ennuyeux. Il est vrai qu’il est aussi l’auteur d’essais.
Dans Derborence, par conséquent, je ne suis l’anecdote que de très loin mais je succule la langue et me repaîs des tournures et du rythme. On parle beaucoup de Giono mais Ramuz le vaut très largement.
L’ennui est que, décidément, je ne puis plus entrer, simplement entrer dans une matière romanesque. Je vois les coutures, la fabrication, j’ai le regard trop expérimenté pour que le cœur se laisse aller, pour que l’esprit soit emporté. Il ne faut voir là nulle outrecuidance, moins encore de prétention. C’est technique. Lorsque je vais au cinéma, c’est la même chose. Je ne vois plus l’image mais l’emplacement de la caméra, les lumières, l’équipe, j’imagine le micro tenu hors-champ, là-haut, prompt à recueillir les propos des acteurs. Je vois les ourlets du scénario.
Est-ce donc qu’il est un âge malheureux où l’âme ne s’émerveille plus guère ? Je ne sais pas. En tout cas, lisez Ramuz pour le goût des mots dans la bouche, le rythme de la phrase mené de main de maître ou artistiquement cassé.
Charles-Ferdinand Ramuz, Derborence, roman, Grasset, 1936 (rééd. collection Les Cahiers rouges). Illustration : Gilbert Guisan, C. F. Ramuz, collection « Poètes d’aujourd’hui », n° 154, Seghers, 1966.
Le Centre de recherches sur les lettres romandes parle de Ramuz.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (10)
vendredi, 16 décembre 2005
La « présentification » selon Sartre
Je relance aujourd’hui un débat fréquent en ce lieu, celui de l’écriture et de ses exigences. Après une série d’échanges sur le style, nous étions convenus il y a quelques semaines de nous arrêter sur l’expression « justesse de l’énonciation » (Barthes).
On peut ici compléter les conclusions, toutes provisoires, auxquelles nous étions parvenus par ces propos de Sartre définissant la fonction du style comme faisant dire au texte « ce qu’il ne dit pas ou n’a pas à dire ». Le style est « une manière de dire trois ou quatre choses en une », déclare Sartre qui baptise cela « présentification », afin de « viser la signification tout en l’alourdissant de quelque chose qui doit vous donner des présences ».*
Ce style-là – je veux dire : cette définition du style et de son rôle – j’y adhère entièrement. C’est celui que j’espère approcher sinon atteindre quelque jour, en travaillant beaucoup et en m’abreuvant d’humilité, car je pense – on reconnaîtra là une de mes obsessions – qu’il est le meilleur moyen de rendre littéraire l’écriture non romanesque.
* Jean-Paul Sartre, Situations, IX, Gallimard, 1987. Cité par Bernard Pingaud, « Le Génie de la famille », in catalogue de l’exposition Sartre (ss. dir. Mauricette Berne), Bibliothèque nationale de France et Gallimard, 2005.
14:04 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15)
samedi, 19 novembre 2005
Paul Fort l’oublié
À Dominique
 Paul Fort, poète français né à Reims en 1872, fonde la revue Vers et prose qui publiera Apollinaire et Gide, excusez du peu. De 1896 à sa mort en 1960, il publie trente volumes des Ballades françaises, imitation du poème à forme fixe remontant au Moyen Âge, mais réinventant sa disposition typographique en évoquant la prose (voire les versets) et en s’autorisant l’apocope et l’assonance.
Paul Fort, poète français né à Reims en 1872, fonde la revue Vers et prose qui publiera Apollinaire et Gide, excusez du peu. De 1896 à sa mort en 1960, il publie trente volumes des Ballades françaises, imitation du poème à forme fixe remontant au Moyen Âge, mais réinventant sa disposition typographique en évoquant la prose (voire les versets) et en s’autorisant l’apocope et l’assonance.
Par là, il crée dans ses textes une musique propre qui les apparente à la chanson et renoue ainsi avec la tradition populaire et orale de la poésie, depuis ses origines. Son œuvre fut publiée chez Flammarion et Pierre Béarn lui consacra en 1960, chez Seghers, un volume des « Poètes d’aujourd’hui » que Fort ne vit pas paraître.
21:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4)
dimanche, 30 octobre 2005
Passions et partis
Le samedi 16 novembre 1867, Flaubert écrit, de Croisset, à Amélie Bosquet. Il l’entretient du livre dont elle est l’auteur, Le Roman des ouvrières.
Il note : « En quoi, dans le domaine de l’Art, MM. les ouvriers sont-ils plus intéressants que les autres hommes ? Je vois, maintenant, chez tous les romanciers, une tendance à représenter la Caste comme quelque chose d’essentiel en soi. (…) Cela peut être très spirituel, ou très démocratique. Mais avec ce parti-pris on se prive de l’élément éternel, c’est-à-dire de la Généralité Humaine. Je sais bien tout ce que vous pourrez me répondre ! C’est une chicane que je vous cherche pour vous engager à faire sortir votre Muse des classes pauvres. Il faut représenter des Passions et non plaider pour des Partis ».
Capitales et soulignements sont de Flaubert lui-même. Source : Gustave Flaubert, Correspondance, tome III, janvier 1859-décembre 1868, collection « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1991.
Quel sentiment est le vôtre face à ces conseils d’un maître ? Que doit-on penser de l’opposition que Flaubert estime exister entre les passions et les partis ? Sont-ils vraiment exclusifs les uns des autres ? Si oui, en quoi sont-ils incompatibles ?
11:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (7)
mercredi, 26 octobre 2005
Dans le détail
Il faudra que je parle des détails. J’ai pour les détails une affection considérable. Je ne comprends pas l’expression : « C’est un détail », je ne peux pas la comprendre. Je ne parle évidemment pas de l’allusion que fit un porc, quelque jour, associant ce mot, dans l’imaginaire collectif, à une provocation sordide.
Dans un ouvrage documentaire, historique, biographique, j’aime trouver des détails, beaucoup de détails, énormément de détails. J’estime qu’il n’y en a jamais réellement assez. J’ai toujours envie de crier aux auteurs : « Allez plus loin ! Précisez ! Soyez plus juste dans votre discours. Mais encore ? »
Comprenons-nous. Il n’est pas question ici de faire des fiches, des enquêtes policières, d’établir des comptes rendus cliniques. Je ne veux pas de biographie à l’américaine ni d’ouvrage desséché. Je cherche des textes bâtis, écrits et détaillés, tout cela dans le but de parvenir au dire le plus exact possible. Je ne veux pas de scalpel, mais un pinceau très fin.
« Dieu est dans les détails », dit-on. Je souscris à cette phrase. La lumière, l’exactitude, la précision, le sérieux, la justesse, l’honnêteté sont dans les détails. On peut résumer tout cela par « Dieu ». Pourquoi chercher à déchristianiser la langue à tout prix, si l’on entend parfaitement ce que l’on veut dire ? Je trouve la tournure explicite.
Le détail n’exclut pas la sensibilité. Au contraire, conjointement et galamment accordés, tous deux œuvrent à la richesse d’un texte. Naturellement, le détail n’a rien à voir avec l’anecdote, la petite histoire et surtout pas avec le secret d’alcôve. Le détail est précieux, il n’est pas racoleur. Il éclaire mais ne tient pas la chandelle. Détail d’un tableau, d’un vitrail, il faut savoir trouver votre équivalent littéraire.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (9)
lundi, 10 octobre 2005
Lecture
Avez-vous lu l’ensemble des textes qu’au fil des semaines, l’ami Dominique Autié a consacré sur son blog aux livres et à la chose imprimée ? Si ce n’est pas le cas, vous pourrez trouver là les huit premières séries de réflexions.
10:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 07 octobre 2005
Maurice Pons, un écrivain nécessaire
Je donne ici à lire un extrait de mon ouvrage Écrivains contemporains (L’Harmattan, 1999). Il s’agit d’une présentation de l’œuvre de Maurice Pons. On voudra bien considérer que ce texte a été écrit en 1992. Je ne le rédigerais plus ainsi aujourd’hui. Tel qu’il est, cependant, il peut faire connaître à ceux qui l’ignoreraient cette œuvre très insolite. Depuis sa rédaction, ont paru, qui ne sont donc pas pris en compte ici, un volume de Souvenirs littéraires et un scénario, La Dormeuse, à tirage limité. Il faut enfin ajouter un livre dont j'ignorais tout lors de l'écriture de cette étude, La Folle passion de Cléopâtre, d'après Shakespeare, livre qui ne figure dans aucune bibliographie.
Il est, pour paraphraser Baudelaire, de fortes œuvres pour qui tout livre est poreux. D’où vient, en effet, que du travail de Maurice Pons, s’échappe un parfum entêtant, toxique peut-être et identifiable entre tant d’autres ?
Maurice Pons vit dans l’Eure, au moulin d’Andé d’où sont datés ses ouvrages. Il a cet avantage d’être un écrivain rare, non seulement par son style et les sujets qu’il choisit, mais aussi, plus prosaïquement, par le rythme qui est le sien. Au rebours des auteurs qui publient avec une régularité confondante, Pons donne à lire, à des intervalles importants, des textes de facture et d’écriture toujours différentes. Il est un écrivain nécessaire.
Avec La Passion de Sébastien N., on est chez Jonathan Swift, voire chez Rabelais. Ce personnage, omnivore depuis toujours et dont une vision d’enfance va conditionner la vie et la sexualité, mange, à la fin du roman, sa voiture. Pièce après pièce. Il veut lui montrer son sentiment, s’assurer qu’ils ne seront plus séparés et c’est pour lui la seule solution. Vision classique de l’amour, la psychanalyse en a vu d’autres. Le mythe de l’automobile est ici, simultanément, porté à son paroxysme et disséqué. Outil de puissance sexuelle, de dépassement, d’affirmation virile. Ce sont des modèles habituels, mais ce n’est pas tout, car il y a aussi, dans cette Passion, une histoire d’amour tendre et d’incompréhension, de solitude. Le récit se déroule, entre autres, dans le département de la Haute-Tisane, notation que ne renierait nullement le capitaine Gulliver. Rappelons que le père de l’auteur, l’universitaire Émile Pons, était un érudit swiftien ; son enfance durant, son fils baigna dans toutes les exégèses des Voyages ; un jour, il les préfacera. Le portrait de Swift ornait le bureau de son père qui ne s’en sépara jamais, même au moment de la fuite devant l’avancée des troupes nazies, lorsque la famille quitta Strasbourg, où naquit Pons. Il faut peut être rapprocher de cela cette phrase de Métrobate, où l’auteur évoque l’exode de mai 1940 : « Au dernier moment, maman n’a pas pu résister à la folie d’emmener sa jument ». Que cette anecdote soit ou non réelle, ne peut-on risquer ici un parallèle ? On emmène une jument. Or, chez Swift, le quatrième voyage de Gulliver fait aborder celui-ci au pays des Houyhnhnms, nobles chevaux philosophes et poètes, aux altières préoccupations et ne connaissant que les vertus.
Swift se retrouve aussi dans Les Saisons, livre noir et magnifique, au moins sur un point, celui de ce pessimisme que nous serions portés à appeler désespoir absolu. La société que rencontre Siméon dans ce pays où l’automne dure vingt mois et l’hiver trente à quarante (il n’y a pas d’autres saisons) est abjecte, immonde. Désespérante et désespérée. On n’est pas si éloigné de Swift, à ceci près qu’il y a fort peu d’humour dans Les Saisons. Non que Pons n’en soit doué, loin de là, mais il a écrit un livre où l’horreur le dispute à la désespérance. L’allégorie est totale. Le lecteur le plus détaché reconnaîtra sans peine une volonté d’outrance mais il ne rira pas, sauf à être malhonnête. Nous sommes ici en pays noir. La seule lueur d’espoir – l’arrivée des deux cavaliers inconnus qui font entrevoir aux habitants un monde meilleur – est aussitôt éteinte, piétinée, niée ; c’est un mensonge. Quand le peuple arrive, après un voyage de mort, d’horreur et d’épuisement, en vue de cet autre pays, c’est pour en croiser les autochtones qui ont vu les mêmes cavaliers et sont partis, eux aussi, vers... l’endroit d’où venaient les premiers ! La conclusion est logique. Siméon, qui les avait guidés, sera sacrifié. Notation importante, il s’était fait leur berger, ils le tuent à coup d’ossements de mouton. La boucle est close. Il s’agit peut être là du plus important ouvrage de Pons. Il concentre toutes les visions de son auteur au point le plus aigu de la tristesse de vivre. Il n’est pas utile, ici, de narrer par le menu le thème des Saisons. Il faut un sacré courage pour entrer dans ce livre et pour y rester jusqu’au bout, mais le plaisir intellectuel et moral qu’on y goûte est sans pareil. La force du roman, sa puissance en raviront plus d’un. Précisons que la dimension onirique, en même temps que philosophique, du récit, est servie par une belle langue classique.
À propos de la langue, relevons cette gourmandise que s’offre Pons dans Mademoiselle B. L’auteur-personnage se rend chez un pharmacien qui lui dit avoir lu ses ouvrages et ne pas les avoir goûtés. Il se croit tenu de préciser que sa femme, elle, ne les a appréciés que parce qu’elle « a des goûts décadents ». Il ajoute : « Votre langue n’est pas sûre ». Quelle jubilation doit être celle de l’écrivain lorsque, se mettant lui-même en scène, il crée un personnage lui reprochant son français, surtout lorsqu’il sait pertinemment que sa langue est sans défaut. Quelle joie d’ainsi pouvoir jouer avec et contre ses propres vérités ! Un peintre pourrait, à la rigueur, « tricher » ainsi avec lui-même, s’amuser d’un jeu de miroirs et de profondeurs (construction dite « en abyme »). Un sculpteur connaîtrait davantage de difficultés. Dans ce domaine, l’écrivain est roi. Chacun des personnages qu’il fait naître est et n’est pas un bout de lui-même, peut exprimer l’opinion de son créateur ou son contraire. L’écrivain peut s’offrir des plaisirs de ce genre : « Votre langue n’est pas sûre », quelle jouissance !
Avec Mademoiselle B., donc, Pons aborde un moyen technique nouveau pour lui, celui de l’auteur-personnage. Cette délicate méthode a été employée avec succès par nombre d’écrivains, tel Roger Vailland. Mais nous resterons décidément dans le domaine du merveilleux. Mademoiselle B. est un somptueux canular, composé avec un talent prodigieux. À première lecture, il s’agit d’un livre totalement autobiographique. Le lecteur, toutefois, se rendra vite compte que tout, dans ce roman, est faux. Pons s’y met en scène, écrivain demeurant au village imaginaire de Jouff, à l’ouest de Paris, dans la campagne. Le livre connaît de nombreuses digressions, d’ailleurs succulentes, qui se rapportent aux gestes et opinions de Pons lui-même ; il y a gros à penser qu’ils sont, eux, exacts. Pour le reste, tout est illusion et pas seulement l’argument, ou l’atroce dénouement. Pons aurait fort bien pu créer un personnage central, le narrateur, et l’affubler de quelque nom. Tout son art est de lui avoir donné le sien et d’avoir encore brouillé les pistes, en se permettant mille considérations personnelles. Cela va cependant plus loin, dans la mesure où l’on retrouve ici sa perpétuelle négation des frontières supposées entre réalité et fiction, introduisant une fois encore la notion de merveilleux, ainsi que l’humour noir cher aux surréalistes. Picturalement, si Les Saisons évoquaient Jérôme Bosch (ainsi que Patinir, nous y reviendrons), Mademoiselle B. fait plutôt penser à un Dali mâtiné de Magritte et de Klee. Il y a tout de même, ce qui ne saurait être tu, une dimension d’angoisse dans cette œuvre. Cette angoisse, on ne la ressentait pas vraiment dans Les Saisons, où l’horreur estompait tout autre sentiment. Ici, tout l’introduit, des descriptions de cadavres décomposés à celles de pendus à la langue boursouflée, butinée par un essaim de frelons, en passant par la cadence de certains passages qu’on jurerait accordés à la vitesse à laquelle le personnage conduit ces automobiles dont il raffole (autre aspect du sujet déjà évoqué dans La Passion de Sébastien N.). Et le récit s’accélère encore dans sa dernière partie, comme tiré par la motocyclette du pseudo-fils de l’auteur, jusqu’au bout. Jusqu’à la mort, fidèle compagne littéraire de Pons.
Rosa est un roman présenté sous l’aspect de la chronique historique d’un pays, naturellement imaginaire. Avec Rosa, le psychanalyste ne sait plus où donner de la tête. Surtout, c’est l’empreinte rimbaldienne qu’on y retrouve. Rimbaud est présent dans le récit que fait Segesvar du voyage qu’il a effectué à l’intérieur de la belle aubergiste. Car, si « la vraie vie est ailleurs », où donc Maurice Pons peut-il bien la situer, sinon dans ce pays que découvrent des hommes très malheureux lorsque, dans le lit de Rosa, ils pénètrent (au sens propre et total) en elle ? Ce n’est pas acceptable, pour les militaires qui commandent la place, Rosa doit disparaître. Elle mourra, et de quelle façon ! Il est d’ailleurs symptomatique que ce soient la force, les militaires, qui détruisent l’amour et la vraie vie. Dans tous ses livres, la sympathie de l’auteur est clairement exprimée. Maurice Pons affectionne l’effet de surprise final, qui suit généralement un autre effet extraordinaire, mais auquel s’attend le lecteur, bien préparé par le talent et le métier de l’écrivain. Cependant, le coup final est imprévisible. Si l’on a compris, par avance, que Sébastien N. va manger sa voiture, on ne peut deviner ce qui va suivre. Si l’on a pressenti la clef du mystère de Rosa, on ne sait pas ce qui se passera ensuite. Double niveau du mouvement narratif de conclusion, choc et impact du livre dans le souvenir.
Nous avons évoqué, à plusieurs reprises, les peintres et la peinture. Il était inévitable que Pons fît un jour un peintre d’un de ses héros. La Maison des brasseurs est construit en jeu de reflets successifs et Franck pénètre - parfois seulement - dans les tableaux qu’il peint. C’est au hasard d’un reflet ou d’une transparence observés qu’il sent qu’il pourra entrer et, là, retrouver cette femme qu’il aime en des endroits divers, dans un univers onirique. On pourra reprocher à ce roman d’être trop systématique, fondé sur une succession de scènes – qui donneront naissance, chaque fois, à des tableaux – et sur une trame visuelle tenant par trop du scénario cinématographique. Il est certain que ce texte aurait pu continuer longtemps sans que soit modifié son contenu. Mais les livres de Pons ne sont presque jamais prisonniers de l’espace et du temps. C’est ici plus sensible de par la construction même de l’ouvrage, qu’on peut ressentir comme une succession de sketches.
Douce-amère groupe onze textes, avec cette particularité qu’ils sont tous composés à la première personne, ce à quoi l’auteur n’était tenu par rien. Cela contribue à l’unité de l’ouvrage. Il ne s’agit pas d’un « assemblage » de nouvelles, mais de onze variations sur les mêmes thèmes. Certaines de ces pièces parurent en leur temps dans le journal Le Monde. Dans le même esprit, le recueil Virginales comprend des récits pour lesquels Pons s’était fixé un pari technique, celui de glisser, une fois dans chaque nouvelle, le mot « virginal ». Souvenirs d’enfance, peut-être réinventés par l’écrivain alors âgé d’à peine plus de vingt ans, ils possèdent cette douce fraîcheur que donne le talent, qui évite à jamais à un souvenir de vieillir.
Métrobate, publié en 1951, possède cette même fraîcheur. Il convient de savoir – l’auteur lui-même a rendu publique cette information – que le manuscrit de ce premier roman a été « gonflé » à la demande de René Julliard, son éditeur de l’époque. Le texte initial comptait soixante-deux feuillets dactylographiés. Pons dut en tirer cent vingt-quatre. Ainsi put s’affirmer son jeune métier littéraire. Les ajouts ne se distinguent pas, les raccords sont invisibles. En cela, Métrobate peut être considéré comme un livre porteur de promesses effectivement tenues. S’il est toujours simple de recenser, a posteriori, des qualités littéraires promises, l’honnêteté de l’écrivain reste d’avoir expliqué en détail cette histoire, lot de tout auteur, mais qui, généralement, reste inavoué. Car Maurice Pons est, à n’en pas douter, un écrivain modeste, naturellement conscient de sa valeur, mais dont chaque ligne montre qu’il ne se prend pas au sérieux : « Parodions sans vergogne (et de mémoire) François-René, vicomte de Chateaubriand, écrivain français né à Saint-Malo : "C’est de la publication de Métrobate (en 1951) que date le peu de bruit que j’aurai fait (futur antérieur) dans le monde des lettres" », écrit-il dans L’Histoire de Métrobate, texte donné en postface à une réédition de son premier ouvrage.
Dans Métrobate, on peut lire cette phrase, prononcée par le précepteur : « J’habitais alors chez un vieux cordonnier. Il avait lu tout Aristote ». C’est tout. Peut-être le jeune Pons ne savait-il pas encore, lorsqu’il écrivit ces mots, qu’un de ses prochains romans s’intitulerait justement Le Cordonnier Aristote...
Du moraliste, grand maître de l’allégorie, au politique, il n’y a qu’un pas. Lui-même l’a relevé dans la préface qu’il écrivit pour Swift : « Il joue le jeu du voyage philosophique, et qui dit philosophique entend clairement politique ». Pons devait devenir un écrivain engagé. Mais que signifie ce mot ? Il s’en expliqua lors d’une réponse à un questionnaire que lui avait adressé un journal : « Mais oui, je crois encore, je crois beaucoup à la littérature engagée. L’expression ne me paraît pas très heureuse, car ce sont les écrivains qui sont engagés dans la littérature, ce sont eux qui s’engagent, par leurs livres, dans les options qu’ils ont prises, et éventuellement dans les causes qu’ils défendent, dans les actions qu’ils mènent (...). Car la conviction politique est une formidable motivation créatrice. Je pense aux admirables Lettres du drapier de Swift se battant pour l’émancipation de l’Irlande. (...) Ne jamais hésiter à se laisser porter par le souffle d’une motivation politique, quand elle s’impose d’une façon déterminante. Je l’ai fait moi-même pendant la guerre d’Algérie, quand j’ai pris parti, résolument, pour le FLN et pour l’aide au FLN, en écrivant Le Passager de la nuit, qui ne m’a pas valu que des amis ».* Si l’on ne peut que souscrire à cette déclaration, examinons le résultat. Le Passager de la nuit se déroule à travers des paysages réels. Il s’agit d’un voyage en voiture, de Paris au Jura. C’est son quatrième roman et Pons n’est pas encore entré dans sa période fantastique. Sa prose, si elle est toujours de la meilleure encre, ne s’embarrasse même pas, ici, d’un doigt d’évasion. La quasi-totalité de l’action se situe dans une automobile et reprend source et vigueur aux étapes indispensables au voyage (plein d’essence, restaurant, hôtel). Pons vise à l’efficacité militante. Dans la France d’alors, c’était nécessaire et courageux. C’est selon une construction romanesque traditionnelle que l’auteur expose – rapidement – la condition des Algériens en France, la guerre d’Algérie, la lutte quotidienne du FLN. Georges, le chauffeur de la voiture, pose les questions de Candide. On remarquera dans ce livre une incantation sensuelle à l’automobile et au voyage par route, incantation qu’on retrouvera (mais avec combien plus de métier) dans Mademoiselle B. et qu’on aura vue, entre temps, poussée jusqu’à la satire et aux limites du conte moral dans La Passion de Sébastien N. Sympathie impossible entre un membre du FLN et cet homme qui le conduit. On pourrait croire, à plusieurs reprises, qu’un voile va se déchirer, qu’entre ces deux êtres naîtra enfin un réel échange. Mais non. Même lorsque le passager mystérieux se laisse aller : « Cela vous intéresse peut-être, me demanda-t-il soudain, que je vous parle un peu des "fellaghas" ? » – même alors, les quelques souvenirs incohérents qu’il livre à son compagnon ne jettent entre eux aucun pont véritable. L’œuvre se termine sur un message codé que le narrateur est chargé de transmettre, sans y rien comprendre, évidemment. Curieux ouvrage de Pons, où cette Françoise que le narrateur a quittée et dont le souvenir lui revient régulièrement, sert de contrepoint à l’action et donne au conducteur un passé. Encore celui-ci se présente-t-il sous les traits d’une passion morte alors que le passager, lui, a une passion politique et sociale combien vivante, qu’il ressent intensément.
C’est dans le monde du théâtre que se situait l’action de La Mort d’Éros, qui fut le second roman de Maurice Pons. Ce texte, qui a une place dans l’espace et dans le temps – les lieux sont nommés et des dates données – demeure un chant d’amour pour le théâtre, même s’il prend parfois des allures de réglement de compte avec un milieu, un univers – jalousie entre comédiens, outrances du patron de la troupe et metteur en scène, caprices des vedettes, imprésario homosexuel, préséances hiérarchiques en fonction de la notoriété et de l’importance des rôles, tout y passe.
Hormis ses adaptations, Pons reste l’auteur d’une seule œuvre théâtrale, Chto !, pièce en deux actes qui se situe en Russie, dans la campagne, avant la Révolution. Le personnage principal, le Mage, officiellement marchand de tapis, possède un pouvoir magique dont il ne se sert que peu, dédaignant la puissance qu’il pourrait lui apporter pour mieux se consacrer à la chasse aux âmes, à une belle femme enceinte, à la ronde des saisons. Pons se situe là aux antipodes des recherches esthétisantes. Il demeure fidèle à son univers de merveilleux, d’étrange et de poésie. Moins noire que ses romans, cette pièce suppose pourtant, dès l’abord, l’abandon de toute raison. L’on sourit à sa lecture... jusqu’à la fin, jusqu’aux toutes dernières répliques où l’on prend conscience que le Mage, s’il a été floué comme le croient les autres personnages, est en réalité le seul à savoir ce qui va vraiment se passer. Pons use en orfèvre de la technique théâtrale.
Pons a publié un volume d’entretiens avec le psychiatre Cyrille Koupernik, La Psychiatrie à visage ouvert. Doit-on s’en étonner ? La psychiatrie n’est pas si éloignée de son univers littéraire, par certains côtés. Dans cet ouvrage remarquable par l’aisance de sa lecture, Pons pose les questions que le lecteur se pose, suggère les remarques et les étonnements du public. Bel exemple d’une vulgarisation réussie, cet ouvrage laisse une place importante à l’homme, dont on aura su deviner que sa destinée est pour l’auteur le souci le plus important, notamment dans le chapitre intitulé « Au bonheur des hommes ».
Il a signé, en collaboration avec André Barret, un ouvrage consacré au peintre flamand Patinir. Si le texte de Barret relève de l’analyse des toiles et de l’exégèse de l’œuvre, celui de Pons est une introduction littéraire : « Il (Patinir) aura inventé pour enrichir la terre ces rochers de cristal en forme de molaires, ces incisives de quartz, qu’il fera jaillir comme des cascades à l’envers et grimper à la rencontre du ciel ». Patinir (Bouvignes, vers 1480-Anvers, 1524) a modifié l’idée qu’on se faisait alors du paysage, créant de vastes vues plongeantes intégrées au tableau, lui-même fondé sur une série de plans successifs et ordonnés. C’était incontestablement un poète. Surtout, dans la gamme des couleurs qui furent les siennes, existe un bleu nouveau, que Pons n’hésite pas à décrire ainsi : « Ce n’est pas le bleu du saphir, ni le bleu de l’ardoise ; ce n’est pas le bleu de l’acier, ni celui de la glace vive ; ce n’est pas le bleu du noble iris, ni celui de la grêle mésange ; ce n’est pas le bleu tendre de l’œil de la truite, ni le bleu argenté du mélèze bleu ; ce n’est pas le bleu du ciel, ni le bleu de la nuit. C’est un bleu qui ne ressemble à aucun autre bleu, qui n’est ni de Paris, ni de Prusse et qui ne vient pas d’outre-mer. Ce n’est pas le bleu turquin, ni le bleu Nattier, ni le bleu de cobalt. C’est un bleu qui ne ressemble qu’à lui, et qu’il faudra bien appeler par son nom : c’est le bleu Patinir ». Dans l’œuvre de ce peintre, ami de Dürer, règne un climat que Pons devait avoir en mémoire lorsqu’il composa Les Saisons. Ses paysages pourraient servir, par endroits, de cadre à l’histoire malheureuse de Siméon. Il n’y a pas de secret, les écrivains ne s’intéressent qu’aux sujets qui les hantent. Leurs goûts, en matière de peinture, ne sont jamais gratuits. Il est donc logique de trouver, chez Pons, ce Patinir ou l’harmonie du monde, comme il est concevable d’y remarquer un volume traitant de psychiatrie.
 Aujourd’hui, on réédite certains livres de Pons, parfois sous un autre titre, toujours avec quelques pages d’une préface de l’auteur, spécialement composée pour cette nouvelle parution. Dans sa première livraison, la revue Les Saisons lui a consacré un dossier. Il signe quelques articles dans Le Monde diplomatique... Nous espérons une œuvre nouvelle, bien qu’il paraisse très difficile d’aller plus loin dans l’imaginaire, l’onirique et le désespoir cousu d’espérance. Que donner après ces livres si forts que nous venons de présenter rapidement ? Pourtant, cet écrivain du diable nous réserve certainement d’autres surprises. D’autres aubades au fantastique, à la raison qui dérape et donne sa démission.
Aujourd’hui, on réédite certains livres de Pons, parfois sous un autre titre, toujours avec quelques pages d’une préface de l’auteur, spécialement composée pour cette nouvelle parution. Dans sa première livraison, la revue Les Saisons lui a consacré un dossier. Il signe quelques articles dans Le Monde diplomatique... Nous espérons une œuvre nouvelle, bien qu’il paraisse très difficile d’aller plus loin dans l’imaginaire, l’onirique et le désespoir cousu d’espérance. Que donner après ces livres si forts que nous venons de présenter rapidement ? Pourtant, cet écrivain du diable nous réserve certainement d’autres surprises. D’autres aubades au fantastique, à la raison qui dérape et donne sa démission.
* Le Nouvel Observateur, spécial littérature, mai 1981.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6)
jeudi, 22 septembre 2005
De la biographie
Je donne ici à lire un extrait de mon ouvrage Avec le livre, propos et réflexions, L’Harmattan, 2003.
Il y a quelques années encore, le terme de biographie recouvrait tout écrit relatif à une personne et à son œuvre. Était dit biographe tout exégète, commentateur ou biographe stricto sensu. Aujourd’hui, on le sait, le biographe est celui qui raconte la vie de son modèle et seulement cela, à telle enseigne qu’on peut lire régulièrement que X est l’auteur d’une biographie sur Z. Incroyablement, on ne rédige plus la biographie de Z, mais une biographie sur lui. Il n’y a pas meilleur exemple du devenir récent de la biographie, maintenant genre littéraire en soi (littéraire, pas toujours, hélas, mais c’est un autre sujet), que ce glissement de langage.
L’offensive a commencé dans le domaine historique et, durant de longues années, on n’a connu que les vies d’hommes d’État, de rois, de militaires fameux. Petit à petit, tous les domaines de l’activité humaine ayant leurs maîtres et leurs fleurons, des biographies sont nées, d’écrivains, d’artistes, de savants et, genre dans le genre, d’éditeurs, celles-ci étant très prisées. On remarquera que ces travaux voisinent aisément avec les souvenirs et mémoires des intéressés. Dans le meilleur des cas, tous deux se complètent et s’éclairent. Dans le pire, bien sûr, ils se contredisent.
La biographie dite « à l’américaine » qui exige un volume de grand format de quatre cents à mille pages, une enquête policière et l’examen approfondi des notes de restaurant du modèle, a pratiquement occis ce qu’on nommait biographie jusque là, des volumes de pagination plus raisonnable dans lesquels l’humain passait avant le détail maniaque ou scabreux, le contenu supplantant encore le paraître. Il faut résister et ne retenir du travail « à l’américaine » que son côté curieux, qu’il convient de doubler de rigueur pour pouvoir prétendre à l’intéressante appellation de biographie « scientifique », récemment apparue.
Revers de la médaille, la biographie a pour ainsi dire tué l’essai, annulé l’exégèse, relégué la glose – mot dont on a oublié le sens. Proposer aujourd’hui à un éditeur un livre consacré à un personnage célèbre équivaut évidemment à s’entendre dire : « Ah oui, une biographie de Y ! » Il faut alors préciser que non, il ne s’agit pas de ça. On est soudain curieusement regardé. Une glose ? Une étude thématique ? Une analyse ? Une exégèse ? La biographie, au moins, on sait ce que c’est.
Mais il ne faut pas diaboliser la biographie, tenter, au contraire, d’en faire un outil de travail et de plaisir mêlés et, si elle doit être édifiante, pourquoi pas, encore que la valeur d’exemple ait fait son temps.
La biographie est un genre impossible. Une vie ne tient pas dans un livre, fût-il de mille pages, de deux-mille pages. Une vie n’est pas linéaire, elle s’engage simultanément dans de nombreuses directions, elle est le plus souvent constituée d’une série d’épisodes thématiques. Elle ne peut donc pas se dérouler de la page 1 à la dernière page. À partir de cette constatation, il importe de ne pas dresser un constat d’échec et d’examiner ce qu’il convient de faire pour être un biographe sérieux. Le mot « sérieux » doit être pris ici dans son sens le plus fort, le plus puissant. Il doit qualifier le biographe comme il qualifie le scientifique. Avec prestige et respect, sans idolâtrie toutefois.
Le biographe ne doit pas outrepasser sa fonction, mais il ne lui est pas interdit de poser des questions. Il doit toutefois se montrer honnête, avouer qu’il ne possède pas forcément les réponses. Alors, la biographie devient genre en mouvement, vivant, utile.
S’interdire rigoureusement tout dialogue fictif, toute conversation imaginaire, tout propos supposé, même s’il est vraisemblable. Le biographe n’était pas là au moment des faits qu’il rapporte. S’interdire aussi toute extrapolation romanesque, surtout si elle est tentante, lorsque, par exemple, l’existence du modèle l’a elle-même été. Ces pièges sont évidents, ces façons de faire sont des facilités indignes d’un biographe compétent.
Le plus laborieux est de retrouver les témoins, de les contacter et de les décider, de les rencontrer. Après, les choses vont seules. En ce sens, il est certainement plus facile de rédiger la biographie de Villon ou de Charlemagne que celle d’Albertine Sarrazin. Dans le premier cas, il n’y a personne à rencontrer et il existe des sources et des travaux préalables. Dans le second cas, c’est très exactement le contraire. Il est des personnes qu’il faut retrouver et très peu de travaux préalables, souvent mauvais d’ailleurs.
Si le biographe, au cours de ses recherches, découvre un aspect peu glorieux de son modèle, doit-il le rapporter ? On peut s’en remettre à l’importance de la chose en question dans la vie (et l’œuvre, s’il y en a une), du modèle, mais qui est juge ? Le biographe ? Et s’il se trompe, donnant à quelque chose de mineur une valeur exagérée ? Le pouvoir du biographe doit-il être régalien ?
Trahir son modèle est interdit. Bien le trahir peut être recommandé, tout dépend du talent du biographe. Qu’est-ce que bien trahir ? C’est parler de soi en croyant évoquer l’autre. C’est en effet le seul moyen de signer un ouvrage personnel, non conventionnel, ce qui est recommandé. Mais on en revient toujours au talent, à l’allure, qui sont indispensables. Bien trahir ne suppose pas que l’on manque de rigueur, au contraire.
On peut tout supposer de circonstances ne s’étant pas produites. Malgré tout, il serait déshonnête de ne pas faire ressortir l’opinion de témoins, qui se serait révélée fréquente, même si elle n’est pas satisfaisante pour l’esprit et pour le cœur. L’affectif n’a pas sa place ici, mais la recherche de l’authenticité historique, oui. Le biographe est contraint à des choix et sa réserve, souhaitable, ne doit pas occulter le réel. Chacun pensera ce qu’il voudra.
Le biographe est-il un historien ? Pour être sérieux, il doit l’être. En tout cas, il doit apprendre à se comporter comme tel : raisonner historiquement, c’est-à-dire replacer le fait dans son contexte, savoir en déceler les causes, analyser les conséquences même lointaines et en donner une explication socio-culturelle.
Il est une raison précise, pour laquelle le biographe doit effectivement réagir en historien et se comporter comme tel. Il importe en effet d’éviter à tout prix cette monstruosité qu’est le biographisme, qui consiste à expliquer l’œuvre en fonction de la vie et uniquement ainsi. Avec cette conséquence absurde mais évidente que la lecture de la biographie finit par dispenser purement et simplement de celle de l’œuvre, par la remplacer, ce qui est une aberration. Ce serait grotesque si ce n’était grave, et à rapprocher en cela des adaptations et morceaux choisis qui font croire au lecteur qu’il a lu une œuvre, quand il n’en possède qu’une vue partielle et faussée, arbitraire, gratuite, aussi absurde qu’une compilation, aussi cloisonnée qu’une anthologie, aussi superficielle qu’un résumé.
Dans le cas d’un modèle qui serait un écrivain ou un artiste, le biographe est-il un critique ? Vraisemblablement pas. Cependant, il faut le supposer connaisseur du sujet et de la période traités – sans quoi il n’est qu’un feuilletonniste. À partir de là, il a nécessairement compétence critique. On en revient encore au talent. Les biographes qui, au départ, sont journalistes, demeurent journalistes, et leur prose reste à l’unisson de leur fonction. Le biographe doit donc bien se comporter en historien, seule façon pour lui de se démarquer du plumitif et du raconteur d’anecdotes. À ce propos, il est bien évident qu’il faut bannir celle-ci, autant que faire se peut, de tout travail sérieux. Un recours rarissime à elle peut se concevoir lorsque, par exemple, le biographe aura su rendre l’extrême tension d’une période et éprouvera la nécessité stylistique de conclure son mouvement narratif par un sourire. Cela doit rester l’exception. Encore, l’anecdote susdite devra-t-elle être fort significative, sans quoi, elle serait gratuite ou posée là telle une affiche publicitaire. Utilitaire, l’anecdote est peu digne de considération.
Dans la forme, il ne devrait plus être concevable de faire paraître une biographie sans indication systématique des sources et des références. En ce domaine, il ne faut pas craindre la redondance parce que l’usage qui peut être fait de ces indications est, chaque fois, différent. On mentionnera donc les références complètes des citations en notes infra-paginales, les sources étant thématiquement regroupées en fin de volume.
Il n’est pas davantage admissible qu’un travail de ce genre soit privé d’annexes importantes, non pour effectuer un stupide déballage d’érudition, mais pour permettre au lecteur qui en est désireux d’aller plus loin. Au minimum, les annexes comprendront bibliographie, discographie et filmographie. On ne peut faire moins – sauf, à l’évidence, si l’une ou l’autre était sans objet. Elles seront complétées, selon le sujet, de toute liste, tout état thématique utiles à l’obtention de bons repères dans l’ouvrage.
Évidemment, un index des noms est rigoureusement indispensable, qu’on complètera d’un index des lieux, voire d’un index des œuvres. Sans index, le volume n’est plus consultable une fois achevée la lecture initiale, à moins d’être doté d’une remarquable mémoire, ou de connaître soi-même le sujet à fond.
Ces annexes ne devront pas représenter un total inférieur à une trentaine de pages, sauf à être incomplètes et, par conséquent, inutilisables. Le but, naturellement, n’est pas de « gonfler », très artificiellement, l’ouvrage, mais d’en faire un outil de travail, sans exclure le plaisir de la lecture. Aucun lecteur n’est tenu de servir des annexes. Il importe toutefois de lui en donner la possibilité. Une biographie « nue » est rarement très belle.
10:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (6)
dimanche, 18 septembre 2005
Petite ode à la ville-piège
Écœurés du retrait d’hiver, il arrive que nous tirions la porte. À peine avons-nous laissé nos bois, qu’une sorte de vertige nous saisit. Paradoxalement, le choc est moins fort quand nous roulons à deux-mille kilomètres : loin, l’habitacle de la voiture nous protège, devient une part de la maison déléguée dans l’espace géographique. Quand nous « montons » à cinquante kilomètres, le tunnel de l’autoroute nous expulse vers un monde obscur. Paris crayonne avec ses suies, ses arbres brûlés sur ses bords. Ses vapeurs empoisonnées regorgent de distractions, de belles femmes.
Je sais des gens qui ne peuvent supporter un crépuscule à la campagne : l’égorgement quotidien du soleil les affole. Pour ces sensibles, qui n’ont pas admis nos combats, et nos férocités, la mort partout présente bouche les issues. La ville pose un bandeau sur leurs yeux. Elle les rassure, mais à quel prix ? Ils roulent, travaillent, procréent, meurent, sans rien savoir de l’agitation qui les mène. Les yeux calcinés aux lumières, ils oublient le trou devant eux et se bercent au grondement que la ville fait vibrer : les turbines, les transmissions, qui domptent la nature des choses et montent un rempart devant la nuit. Évacués de leur personne, les habitants des villes acceptent toutes les brimades. Ils s’estiment privilégiés quand on veut bien de leur argent. Ils paient pour s’arrêter. Ils paient pour repartir. Ils paient pour uriner et pour s’asseoir. Pour traverser et pour se faire verbaliser. Les grandes images colorées qu’ils vont voir dans les cinémas assument leurs sensations et leurs désirs. Ces ombres tuent, pillent, violent, torturent, séduisent à leur place. Elles enchaînent avec les cauchemars et les poursuites de leur existence. Quelquefois même, elles les font rire.
Les dernières bêtes libres, couchées au fond des bois, dans une boucle du fleuve, observent. Elles attendent que la ville s’effondre pour entrer. Demain sera le jour de leur victoire.
Luc Bérimont, Les Ficelles, EFR, 1974.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (21)
vendredi, 16 septembre 2005
Le roman, l'écriture
En mars dernier, sur le forum de Romain Gary, j’avais ouvert un fil de discussion qui évoquait déjà ces questions du roman, de la littérature et de l’écriture. Je redonne ci-après l’essentiel du message initial et relance le débat dans le droit fil de ce que nous disions hier.
Ce qui m’ennuie, c’est cette assimilation – qui est celle de la plus grande partie du public – entre livre et roman. Lire, c’est lire des romans. Corollaire : un livre, ça raconte une histoire.
Et là, je ne peux plus suivre. Je lis des documents, des essais, des études, des biographies, des souvenirs, des recueils de correspondance, des pièces de théâtre, des poèmes, des livres d’histoire… et j’ai bien, cependant, le sentiment de lire. J’enrage d’ailleurs lorsque, pestant contre l’écriture souvent peu soignée de ce type d’ouvrage, je m’entends répondre : « Ce n’est pas un roman » ou « Ce n’est pas de la littérature ». En général, la personne qui me sort une ânerie pareille ne le fait pas une seconde fois. Comme si un document ne devait pas être écrit ! Encore que cela s’arrange un peu, depuis quelque temps.
Je ne peux pas comprendre qu’on oppose le roman en tant que genre supposé noble (et pourquoi diable ?) à tout le reste.
Évidemment, il y a Gary.
Gary et le roman. Mais il ne faut pas interpréter les paroles et les opinions d’un homme qui, comme vous le savez, est mort il y a à peu près un quart de siècle. Il faut être rigoureux : nous ne savons rien de la façon dont Gary aurait pu évoluer et de ce que serait devenue son opinion sur le roman. Surtout face aux six ou sept-cents romans publiés en septembre et cinq ou six-cents publiés en janvier, comme c’est systématiquement le cas depuis quelques années. Il faudrait connaître le sentiment de Gary sur l’évolution de l’édition depuis vingt-cinq ans et comme ce n’est pas possible…
En tout cas, et pour résumer, j’ai toujours beaucoup de mal à lire ces assimilations de la chose écrite au roman.
Qu’en pensez-vous ?
Dans le courant du débat, j’ai encore noté ceci.
Les invectives de Gary contre le Nouveau Roman, encore une fois, datent de l’époque... du Nouveau Roman. Nous pouvons continuer d’aimer Gary, mais il n’est plus là, il faut bien l’admettre, et ce depuis vingt-cinq ans. Que dirait-il aujourd’hui ?
Ce que je voudrais exprimer – et il semble que je n’en sois pas capable – c’est qu’il est humainement et intellectuellement impossible de considérer le roman (égale histoire racontée) comme Le Livre. Faites l’expérience, regardez ce qui se lit, ce qui se publie (qui flatte d’ailleurs servilement les lecteurs et surtout les acheteurs), ce qui s’emprunte. Parlez autour de vous, vous verrez : pour neuf personnes sur dix, lire, c’est lire un roman.
C’est ce que je voudrais souligner, parce que j’y pense depuis fort longtemps : l’acte même de lire est devenu celui de lire une histoire.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (88)
jeudi, 15 septembre 2005
Faites sortir la rentrée
L’hypocrite marée qu’on a coutume de désigner sous le nom fallacieux de « rentrée littéraire » est remontée jusqu’à la rive. Voilà, ça y est, la mer est pleine, nous sommes tranquilles jusqu’en janvier, date à laquelle une autre marée submergera le littoral.
Plusieurs centaines de romans, désormais, paraissent ainsi deux fois par an. Le phénomène n’est pas si vieux. Il y eut toujours des « rentrées littéraires » – comme si la littérature sortait –, mais elles ne proposaient pas, deux fois l’an, six à sept-cents romans. Et puis, une question : si l’on ne veut pas de romans, que fait-on ? Car, on ne le dit peut-être pas assez, ces volumes, il faut les disposer sur les tables et dans les rayons, sur les éventaires, dans les vitrines. Ces livres prennent la place d’autres. Répétons-le : ces ouvrages occupent une place que l’on pourrait utilement réserver à d’autres domaines. Disons-le encore : les romans occupent tout l'espace. Martelons : il n'y a plus d'endroit où poser les livres relevant d'autres préoccupations. Pour tout le monde, lire, c’est lire des romans.
Il n’est pas question de manifester un quelconque ostracisme. Il est uniquement question de réclamer pour les autres livres le droit à l’existence. Un peu d’air pour eux, les pauvres. De toute manière, l’amateur de romans ne lira jamais mille quatre-cents livres par an. Il n’en lira pas trente non plus, ne serait-ce que parce que son budget ne le lui permettra pas. J’entends déjà l’argument que l’on croit susceptible de convaincre : le choix. Ah, le choix !
D’abord, c’est faux. Si l’acheteur de romans au budget moyen élimine tout ce qu’il ne pourra pas s’offrir, le choix devient restreint. Ensuite, qu’est-ce que choisir entre rien et rien ? Tous ces textes interchangeables, ces couvertures racoleuses, ces quatrièmes de couverture préfabriquées… Ces briquettes de papier encollées à la diable n’ont pour but que de faire de la cavalerie, c’est-à-dire de la trésorerie pour les éditeurs. En inondant les librairies d’ouvrages de sa marque, l’éditeur Machin étale son label jusqu’à ce que le chaland, inconsciemment, le photographie : s’il y a tant de livres parus dans cette maison, c’est qu’il s’agit d’un grand éditeur et, corollairement, les livres sont bons puisque ce sont ceux d’un grand éditeur. Quant aux « offices », ils procurent de l’argent frais. Enfin, les sept-cents titres de l’automne disparaîtront forcément quand arriveront les sept-cents volumes de janvier. Sans compter qu’entre-temps, il aura fallu faire de la place pour les livres d’étrennes, ces boîtes de chocolats que personne n’ouvre jamais mais qui ont l’avantage de coûter cher.
Je proteste aussi contre l’appellation « littéraire ». La littérature, ce n’est pas que le roman. Il faudra bien, quelque jour, faire rendre gorge à cette idée reçue. Et cela ouvre un autre débat que j’avais esquissé ailleurs sur l’impérieuse nécessité d’écrire les documents, les biographies, les études, les livres de critique, d'histoire. Je me propose d’y revenir.
07:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (15)


