lundi, 25 mars 2013
Lettre à Jérôme Michel
Je pensais adresser cette lettre à Jérôme Michel aux bons soins des éditions Pierre-Guillaume de Roux, comme je le fais habituellement lorsque j’écris à un auteur que je viens de lire. J’ai pensé ensuite que, paradoxalement, le fait de la découvrir en ligne serait sans doute, pour lui, plus doux que de la trouver un jour dans son courrier.
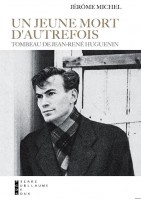
22 mars 2013.
Monsieur,
J’achève ce matin la lecture de votre Jeune mort d’autrefois.
Habituellement, lorsqu’on décide d’écrire à un auteur (je ne le fais pas souvent), c’est pour lui dire le plaisir qu’on a pris, l’intérêt qu’on a éprouvé à le lire. Cette lettre constituera une exception. Croyez bien, toutefois, que j’aurais préféré vous féliciter.
Le tombeau est un genre difficile. En premier lieu, il ne souffre pas la longueur et celui que vous avez composé est trop long, ce qui vous exposait à la redondance, à l’essoufflement, à la lassitude. Vous n’avez échappé à aucun de ces pièges. Votre Mauriac, déjà, m’avait lassé.
Votre style est plat, très plat, et lorsque vous risquez un trait que vous imaginez méprisant, une insolence, vous ne dépassez jamais la ridicule – parce que mesquine – perfidie. Ainsi, cette recherche d’Hemingway qui n’aboutit qu’à Sagan (p. 136). Voilà bien une vision ! L’opposition permanente : ou-ou. Eh bien, l’on peut aimer Hemingway et Sagan, sans pour cela (je devance votre objection probable) considérer que tout vaut tout. Loin de moi une telle idée. La vision et-et s’oppose à la vision ou-ou. Même si le premier détestait le second, on peut aimer, librement, Sartre et Mauriac. C’est mon cas. Vos piques permanentes contre Sartre sont grotesques.
Vous n’avez pas peur du cliché ni de la banalité la plus exténuante : « la lumière déclinante du soir » (p. 179) – cela vaut mieux que la lumière déclinante du matin, remarquez. Sérieusement, vous rendez-vous compte de ce que vous avez écrit là ? Clownesque ! Quant à citer Toulet (p. 174), évitez de donner son poème le plus connu, même s’il est admirable, et il l’est.
L’adoubement d’un jeune homme par Gracq et Mauriac ne suffit pas. Vous êtes parvenu à me dégoûter à jamais d’aller vers Huguenin. Sans doute, cela vous sera-t-il indifférent, mais je suppose que ce n’était tout de même pas votre but. Les extraits de La Côte sauvage (a-t-on vu titre plus banal ?) que vous citez m’ont paru d’un mortel ennui. Quant aux fragments du Journal que vous nous donnez à lire, quelle auto-complaisance de sa part ! Je sais bien qu’il était jeune, mais il est hors de question que j’en lise davantage. Je trouve que rater votre objectif à ce point constitue un échec considérable. Pourtant, vous avez bénéficié d’une édition propre, bien faite. Il y a fort peu de coquilles dans votre livre, qui est bien réalisé, bien imprimé. Ce n’est pas toujours le cas. Votre manuscrit a été relu, notez-vous dans les remerciements. Personne, donc, n’a su vous mettre en garde contre les défauts évidents de votre travail ? On n’a même pas, à vous lire, le sentiment d’une admiration, qui serait parfaitement légitime, même pour qui ne la comprendrait pas, pour Huguenin. Votre texte est si mauvais qu’au bout du compte, on se demande pourquoi vous aimez tant un écrivain que vous ne savez pas servir. Vous ne parvenez à le rendre humain que lorsqu’il prend la décision d’épouser la jeune femme qu’il aime. Il était temps. Avant la métamorphose de l’amour, qu’il n’est heureusement pas le premier à découvrir, il est tout simplement invivable, pour ne pas dire odieux. Si vous avez le sentiment d’être redevable à Huguenin, cela n’apparaît pas réellement. On peut trahir son modèle, mais il faut le faire avec talent.
Le lamentable portrait des soixante-huitards (je n’en suis pas) que vous brossez en fin d’ouvrage est tellement caricatural, et plein d’anachronismes, qu’il n’a plus aucune force, qu’il ne peut plus être considéré sérieusement. Et, mon Dieu, pourquoi vous – les suivants –, n’avez-vous pas inventé autre chose, puisque vos prédécesseurs avaient fait si mal, puisque leur action avait été si déplorable ? Je suis né en 1952, je suis dans ma soixante et unième année et j’ai le sentiment d’être plus jeune que vous. Ne comprenez-vous pas que c’est vous qui êtes vieux ?
Je trouve cependant une chose à sauver dans votre prose, pp. 180-181 : « paroisse morte et glacée gérée par des prêtres puritains en costumes anthracite servant la messe de la concurrence libre, saine et non faussée ». Parce que c’est exactement ça, très exactement. En cet endroit, le lecteur vous pardonne la tristesse, qui confine à l’amertume, de votre regard, puisqu’elle se justifie. Que n’avez-vous visé aussi juste en tous lieux !
Je ne vous aurais pas écrit si votre ton, si prétentieusement insupportable, ne m’avait convaincu qu’il n’y avait nulle raison de vous épargner. Écrire, c’est prendre des risques – vous serez d’accord avec cela, je le sais –, vous en avez pris. J’espère que vous accepterez ce retour. Votre personne n’est pas en cause, seul votre ouvrage l’est, et l’est beaucoup.
Il est bien entendu inutile de me répondre. Quand vous le souhaiteriez, votre lettre ne serait pas lue. Je ne désire pas aller plus avant et considère le sujet comme clos.
Je vous laisse à vos dérélictions et vous adresse mes sentiments littéraires.
Jacques Layani.
19:39 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 24 mars 2013
Demy, 13 : de la mise en abyme
Demy ne pratique pas seulement la récurrence, il effectue aussi quelques mises en abyme qui, d’une certaine manière, complètent les liens qu’il tisse entre les films.
Lorsque Lola, personnage récurrent du film Lola, évoque, dans Model Shop, son passé et, en même temps, celui de Michel, d’Yvon, de Frankie, de Cassard et de Jackie Demaistre, le réalisateur ajoute Catherine Deneuve, citée, elle, comme actrice, par le truchement d’un magazine glissé sous l’album de photographies de Lola.
Trois places pour le 26 est l’histoire (entre autres) d’un spectacle dans un film. Il s’agit d’une comédie musicale où se raconte la vie de Montand, mais une vie partiellement récrite, inventée, pas entièrement réelle, jouée par Montand sous son vrai nom. Parallèlement à cette évocation biographique plus ou moins authentique, Montand vit une histoire totalement imaginaire avec le personnage de Marion.
Anouchka, projet hélas non réalisé, est l’histoire d’un film dans un film. Une équipe de cinéma part tourner une adaptation d’Anna Karénine. Le film se serait ouvert avec une conférence de presse, évidemment en musique, dans laquelle Demy et Legrand eussent tenu leur propre rôle.
Les mises en abyme se retrouvent même dans les musiques, les chansons. Dans Les Demoiselles de Rochefort, les jumelles proposent aux forains quelques airs qu’elles peuvent jouer, et terminent par : « Ou préférez-vous entendre du Michel Legrand ? »
Dans Trois places pour le 26, Montand, dans l’air intitulé Ciné qui chante, cite quelques classiques du film musical et interprète soudain : « Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi », l’air, mondialement célèbre, des Parapluies de Cherbourg.
12:23 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 23 mars 2013
Demy, 12 : de la récurrence, II
On a coutume de dire que Demy a renoncé au principe des personnages récurrents après Model Shop. C’est parfaitement faux – à tout le moins inexact. Les citations d’un film à l’autre vont se poursuivre quelquefois.
Dans Une chambre en ville, le nom de Mme Desnoyers (Lola) qui habite Nantes où se déroule l’action, est inscrit au tableau fixé dans l’atelier d’Edmond Leroyer, le marchand de télévisions. Elle a déposé son poste chez lui, pour qu’il le répare ; l’espace-temps des personnages des différents films est parfaitement respecté. C’est bien une citation, Mme Desnoyers est bien un personnage récurrent.
Dans Trois places pour le 26, Marius Cerredo répond à un ouvrier qui lui apporte une information : « Je préviendrai Dambiel ». Dambiel était ouvrier aux chantiers navals de Nantes en 1955 (Une chambre en ville), on le retrouve aux chantiers navals de Marseille en 1988. C’est tout à fait plausible. Certes, il ne s’agit que d’une évocation : son nom est cité, mais on ne le voit pas à l’écran. Il reste qu’on ne voyait pas davantage Lola dans Les Parapluies, où Cassard l’évoquait seulement : « Autrefois, j’ai aimé une femme ; elle ne m’aimait pas. On l’appelait Lola ». On ne voyait pas, non plus, Mme Desnoyers dans Les Demoiselles, lorsque Dutrouz se la remémorait en même temps que son beau-frère et amant, Aimé le coiffeur. On ne voyait pas Cécile (Lola) lorsque Geneviève la mentionnait dans Les Parapluies.
Ainsi, quoi qu’on dise, Demy a poursuivi son dessein démiurgique jusqu’au bout. Lorsqu’il n’a pu faire apparaître le personnage à l’écran, il l’a cité dans le dialogue.
La plus belle récurrence, celle qu’on regrettera certainement toujours puisqu’elle n’a pas eu lieu, était prévue dans le scénario des Demoiselles. Demy en a parlé dans un entretien accordé à la presse, et son biographe Berthomé l’a raconté. Nino Castelnuovo n’était pas disponible au moment du tournage et l’idée fut perdue. De quoi s’agissait-il ? Le deuxième forain, Bill, devait être Guy Foucher, ce même Guy des Parapluies. Il était censé avoir perdu sa femme Madeleine – chez Demy, les amours ne durent guère – et avoir été sauvé du désespoir par Étienne, le premier forain, qui l’avait arraché à sa station-service et au Cherbourg de ses mauvais souvenirs, et emmené avec lui. Or, sur la place de Rochefort, il était frappé par la ressemblance de Delphine Garnier avec Geneviève Émery. Il lui disait combien elle ressemblait à cette fille qu’il avait tant aimée, lui montrait une photographie d’elle et s’entendait répondre : « Je suis tout de même mieux que cela » (Demy n’a pas peur de l’humour grinçant). Savoureuse scène où Catherine Deneuve se serait estimée plus belle… qu’elle-même. Mais la récurrence continuait car, un peu plus tard, on devait voir Cassard et Geneviève, avec la petite Françoise – fille de Guy – arriver à Rochefort et assister au numéro de danse de Delphine et de Solange. Et Guy, à l’intérieur du stand, ne voyait pas son ancien amour. Il ne sortait que Geneviève partie. Chez Demy, on se croise, on se rate toujours, on le sait. Encore une scène où Catherine Deneuve eût du jouer les deux rôles de Delphine et de Geneviève. Cela ne faisait pas peur à Demy, le grand tireur de ficelles, lui, l’ancien enfant qu’émerveillait le théâtre de marionnettes : il la dirigera ainsi dans Peau d’âne, où elle sera à la fois la mère et la fille puis, quelques scènes plus loin, la princesse et la souillon.
19:28 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 21 mars 2013
Demy, 11 : faire cent blancs

Lorsqu’à ses débuts, il ne peut disposer du budget qu’il désire, Demy traite le film en noir et blanc comme un film en couleurs. Lola et La Baie des anges sont dans ce cas. Par le jeu des contrastes, des veloutés, des oppositions, en résumé, par une remarquable photographie, Demy donne vie aux couleurs que la pellicule n’est pas à même de faire apparaître. La meilleure idée, en ce sens, est de faire de Jeanne Moreau une blonde platinée (à l’image, ses cheveux paraissent presque blancs) aux yeux fardés de noir, vêtue d’une robe imprimée blanche à grandes fleurs noires, ou bien d’une guêpière blanche. Le tout, dans une chambre d’hôtel aux murs qu’on devine blanchis à la chaux, sur lesquels se découpent des meubles sombres, qu’on voit noirs à l’écran. Dans La Baie des anges, l’alternance des ruelles obscures de Nice et de la plage étale sous l’éclatant soleil de la Côte d’Azur, remplit aussi cet office.

Dans Lola, la guêpière noire de l’héroïne, sa chambre aux murs blancs, le costume blanc de Frankie le marin de Chicago, celui de Michel, la voiture blanche de Michel, jouent le même rôle, auquel participe l’image surexposée de la lumière entrant par les vitres du café où Cassard se rend régulièrement, ou bien de celle pénétrant l’appartement de Mme Desnoyers. Ces noirs et blancs somptueux, ces éclairages le plus souvent naturels, savent conférer l’illusion de la couleur.


07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)
mercredi, 20 mars 2013
Ajouts et rajouts font de laides bajoues
Avez-vous remarqué qu’on ne sait plus ajouter, mais qu’on rajoute ? Dans tout ce que je lis, chaque fois qu’il est question d’ajouter, il est désormais écrit rajouter. Pourtant, on ne peut rajouter qu’à un ajout initial. L’acte premier est un ajout.
C’est une marque de notre époque, semble-t-il. Plus la vie est difficile, plus on triche, on fait semblant, on en rajoute (oui, oui) parce que ça fait riche, en quelque sorte.
12:20 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 16 mars 2013
Demy 10 : quelques dommages
Les ultimes films de Demy constituent des succès partiels, autant dire des semi-échecs (Une chambre en ville, Trois places pour le 26). Et un ratage complet, Parking. Il faut ajouter à cette liste un peu triste une série de projets passionnants, demeurés sans suite (Skaterella, Kobi, Anouchka).
On s’est déjà demandé pourquoi, regrettablement, Une chambre en ville n’avait pas eu le succès des Parapluies de Cherbourg. On sait que le public décide toujours, en définitive. Par conséquent, même s’il se trompe, il a en quelque sorte toujours raison.
Je n’ai jamais su démêler les raisons qui me font trouver Trois places pas entièrement réussi. Qu’est-ce qui ne va pas ? Est-ce parce que Montand est trop âgé pour le rôle, comme cela a été souvent dit ? Je ne sais pas. Peut-être parce que je sais, ayant vécu à Marseille, qu’un baron n’habitera jamais sur la Canebière, mais avenue du Prado ou sur la Corniche. Peut-être est-ce parce que je sais pertinemment que le bar où Montand va retrouver Françoise Fabian n’existe pas. Peut-être parce que ma sœur fut engagée comme figurante parmi beaucoup d’autres, pour simuler le public applaudissant le spectacle joué dans le film (il s’agit d’une mise en abyme) et qu’elle m’a raconté avoir dû applaudir un rideau baissé sur une scène vide. Peut-être parce que j’ai travaillé autrefois dans la librairie, 21, rue Paradis, dans laquelle entre Montand : je vois immédiatement quels éléments de mobilier ont été enlevés pour permettre à l’opérateur de travailler ; je vois immédiatement que les deux libraires sont des actrices ; surtout, j’entends, et ça m’insupporte, l’accent supposé marseillais, totalement contrefait, inaudible, de celle qui joue la patronne. Peut-être parce que j’imagine bien que Montand, tout Montand qu’il est, ne pourra certainement pas pénétrer dans les chantiers navals, dans la zone de radoub, en voiture (à moins que Marius Cerredo ait prévenu, je ne sais pas). Peut-être parce que je trouve la scène finale, les retrouvailles sur les escaliers de la gare avec ce non-dit entre le père et la fille, sans parler de la mère qui ne saura sans doute jamais rien, expédiée trop rapidement, bien trop rapidement pour qu’on puisse y croire, même dans le cadre d’une stylisation courante chez Demy. Peut-être pour l’ensemble de ces raisons, finalement. Pour résumer, j’aime beaucoup Trois places pour le 26, mais je voudrais l’aimer moins mal et je n’y parviens pas. Et puis, je trouve que c’est un mauvais titre, et je suis très sensible aux titres. Au vrai, le demi-échec est souvent ce qui arrive aux projets anciens n’ayant pu aboutir, qu’on remanie lorsque les circonstances sont plus favorables : Dancing et Les Folies passagères ont abouti à Trois places pour le 26, mais le temps avait passé, Montand changé et le scénario été remanié, d’ailleurs intelligemment, mais perdant ainsi sa fraîcheur initiale.
Si Parking est un ratage, on sait au moins pourquoi. Demy aussi le savait, et il le savait en le tournant. La responsabilité essentielle de l’échec artistique de ce film repose sur Francis Huster, ridicule, lamentable, aussi charismatique qu’une andouillette bouillie, le tout, dans un rôle où il est censé être un chanteur rock, galvanisant des salles entières. Qui plus est, le producteur a imposé par contrat qu’il chante lui-même, sans le dire à Demy, qui fut obligé de faire avec. Le résultat est au-dessous de tout. À sa décharge, Huster, par la suite, a admis cette erreur, disant que ce film était pour lui « une casserole » qu’il traînait, et reconnaissant que chanter est un métier, que ce n’était pas le sien. L’actrice japonaise également imposée fut choisie sur une photographie et apprit son rôle phonétiquement puisqu’elle ne parlait pas français. Ce que les Anglo-Saxons appellent miscasting – on parlera, plus simplement, d’erreur de distribution – est ici gigantesque. Et pourtant, refaire le mythe d’Orphée aujourd’hui ; réintroduire le personnage de Caron comme dans La Baie des anges, toujours au volant d’une voiture noire ; saluer Cocteau et engager Jean Marais pour jouer Hadès ; employer Marie-France Pisier, délicieuse dans n’importe quel rôle, pour être Perséphone ; présenter l’enfer comme une administration ; traiter les couleurs de l’enfer comme elles le sont ; imaginer qu’on y accède par un parking souterrain, en pénétrant le mur d’une zone réservée ; traiter simultanément la bisexualité (Orphée), l’homosexualité (les Bacchantes), l’inceste (Hadès est l’oncle de Perséphone), la drogue, tant de choses encore ; faire assassiner Orphée par les Bacchantes, ou par un admirateur, à l’instar de Lennon (le film ne permet pas de le savoir) ; se permettre des astuces comme cette carte de visite d’une agence artistique, que présente Perséphone à Orphée : Hadès (quand il a existé réellement une maison de disques appelée Adès) ; tout cela ne manquait pas d’ambition, d’imagination, d’humour. Mais le budget était insuffisant, le délai de réalisation trop court, et Huster impossible à admettre.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 15 mars 2013
Demy, 9 : un cinéma en Demycolor
Dans le monde en couleurs dans lequel vivent Geneviève et sa mère – Jean-Pierre Berthomé a excellemment détaillé ce sujet –, Roland Cassard introduit le noir : son pardessus, sa voiture, son costume. Quand elle accepte de l’épouser, Geneviève perd ses couleurs : d’abord avec sa robe de mariée, certes belle mais blanche ; ensuite, en montant, au sortir de l’église, dans la voiture noire de son mari qui, pour l’occasion, a fait appel à un chauffeur. On ne la reverra qu’à la fin du film, vêtue d’un manteau noir, un bandeau noir dans les cheveux et conduisant elle-même la voiture noire. Le tout dans un environnement blanc dû à la neige et à la station-service.

Dans l’intervalle, Guy revient de l’armée, il n’est au courant de rien et s’inquiète du silence de celle qui l’a abandonné. Au sortir de la gare, il court droit au magasin de parapluies, qui n’existe plus. Quand il y repasse un peu plus tard – et c’est la première fois qu’il y entre –, il croise des livreurs en train d’installer des machines à laver. L’endroit est devenu une blanchisserie et on l’en fait sortir sans ménagement : « Qu’est-ce que tu cherches ? Alors, pousse ta viande. Tu vois bien que tu gênes ». Le blanc règne en maître et chasse Guy, témoin du temps où Geneviève était en couleurs.
Mais le blanc chez Demy, et Berthomé l’a aussi expliqué, c’est l’amour : celui de Lola qui attend sept ans durant le retour de Michel – l’homme reviendra, vêtu de blanc, dans une voiture américaine blanche (Lola) ; celui du costume de Cassard, lorsqu’il fait son ultime déclaration sur les quais de Cherbourg (« Nous élèverons cet enfant ensemble ») ; celui des vêtements de Lola, que George remarque aussitôt dans les rues de Los Angeles (Model Shop). Mais voilà, Lola se retrouve seule une fois de plus, George également, et l’on peut tout supposer de la suite du mariage de Geneviève et Cassard. Il n’est guère que dans Peau d’âne que le mariage se fait dans une grande scène finale, toute blanche. Quant au Joueur de flûte, il emmène Dieu sait où une théorie d’enfants vêtus de blanc, et ils disparaissent à nos yeux. L’amour, dans ces films, ne dure pas. Le blanc se salit vite, c’est connu.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 14 mars 2013
Demy, 8 : un autre point de vue
On considère habituellement, biographes et critiques s’accordent en cela, que lors de la dernière scène des Parapluies de Cherbourg, Guy et Geneviève n’ont plus rien à se dire, qu’ils échangent quelques paroles banales et se séparent.
J’ai un point de vue sensiblement différent et, honnêtement, rien, dans ce que je vois à l’écran lorsque je regarde cette scène, ne me convainc de mon erreur.
Geneviève regagne Paris après être allée chercher sa fille en Anjou et elle passe par Cherbourg. Cela a déjà été relevé, certes, mais il faut le redire : on ne passe pas par Cherbourg lorsqu’on fait ce trajet. Elle-même précise : « J’ai fait ce détour ». Mais il ne s’agit pas d’un détour, il s’agit d’un véritable détournement, si j’ose dire. Elle est donc revenue volontairement, cela ne fait aucun doute. À partir de là, diverses interprétations sont possibles. Elle pouvait vouloir revoir sa ville, tout simplement. Soit. D’ailleurs, elle ne savait même pas, en principe, ce qu’était devenu Guy. On peut donc penser qu’elle venait uniquement se ravitailler en essence et qu’elle a abouti à « L’escale cherbourgeoise » par hasard. Aurait-elle su ce que Guy avait fait de sa vie, elle ignorerait de toute façon de quelle station-service précise il était le gérant. Admettons qu’elle se soit renseignée dans Cherbourg et qu’on ait su la diriger. Dans ce cas, elle arriverait à la station volontairement.

Quoi qu’il en soit, voilà les deux anciens amoureux face à face. Que se passe-t-il ?
Guy lui dit : « Viens au bureau ». On sait ce que « le bureau » signifie pour lui. Dans ses rêves d’autrefois, il disait : « Nous achèterons une station-service toute blanche, avec un bureau, tu verras ». Le bureau, c’est aussi l’endroit d’où Aubin, son ancien patron, l’appelait. Il était convoqué au bureau, alors qu’il se trouvait à l’atelier. Le bureau, c’est l’endroit du patron. On peut estimer qu’à son tour, il convoque Geneviève au bureau.
On s’accorde aussi à dire qu’à cet instant de l’histoire, Geneviève a remplacé sa mère et que, selon toute vraisemblance, elle aura plus tard avec sa fille les mêmes rapports que sa mère avait avec elle. Je pense que les choses sont différentes.
Elle regarde le bureau, l’arbre de Noël, pose des questions, propose à Guy de voir leur fille, se moque éperdument du type de carburant que lui propose le pompiste (Guy a maintenant un ouvrier, il est vraiment patron). Puis, le plein fait, Guy lui dit : « Je crois que tu peux partir » et, en cet ultime instant, elle se retourne avant de passer la porte et tente une dernière interrogation : « Toi, tu vas bien ? », avec un regard qui ne signifie pas du tout, à mon sens, qu’elle désire s’en aller. Guy ne prête pas le flanc à ce qui, pour moi, est une invite. Avec son « Je crois que tu peux partir », il la met purement et simplement à la porte. À la porte du bureau, donc de sa vie.
Je crois que Geneviève désirait rester. Je ne suis pas certain que cela ait été préconçu, mais, une fois Guy retrouvé, quelque chose me dit qu’elle imagine une suite possible. Rien ne l’obligeait à suivre Guy au bureau, à lui parler, même peu et de façon générale.

J’imagine que Guy, pas fou, a les pieds sur terre et tient à ce qu’il a construit avec Madeleine. À ce propos, on a beaucoup écrit aussi qu’il épousait Madeleine sans l’aimer vraiment, par défaut en quelque sorte. Ce n’est nullement certain. On a encore écrit que, son grand amour déçu, il se résignait à une vie médiocre avec une autre. Pas du tout : sa vie de gérant de station-service, c’est ce qu’il a toujours désiré. En quoi est-ce médiocre ? Par ailleurs, vendre de l’essence est-il plus minable que vendre des parapluies ? C’est là un raisonnement à la Mme Émery. Ce n’est pas sérieux. Guy vit donc ainsi qu’il l’a toujours voulu et il ne va pas tout détruire parce qu’une commerçante embourgeoisée (Geneviève n’est rien d’autre) est de retour.
Cassard ou non, Geneviève commençait à oublier Guy dès les premières semaines qui suivirent son départ (air « C’est drôle l’absence »). Si Cassard n’avait pas été là, elle aurait épousé Guy sans amour, ou peut-être se serait-elle mariée avec un autre homme. Je tiens que Madeleine était la meilleure chance de Guy. Je tiens que Guy l’a échappé belle. En poussant le raisonnement jusqu’à son terme, il apparaît que c’est Cassard qu’il faut plaindre. C’est lui que sa femme a épousé par défaut. On peut même aller jusqu’à supposer qu’elle ne lui a pas fait part de son intention de retourner à Cherbourg. Autrement dit, elle lui a menti et lorsqu’on commence à mentir, dans un couple, cela n’augure rien de bon.
Je ne crois pas faire ici un contresens : Geneviève, dans l’instant où elle se trouve « au bureau », imagine quelque chose. Elle ne l’a pas cherché, mais elle est prête, elle se sent brusquement prête à. À quoi ? Elle n'en sait rien elle-même. Le film ne nous le dit pas, mais il ne nous interdit certainement pas d’y penser. Cela étant, je ne tiens pas à avoir raison contre tout le monde. Il est possible que je ne sois pas dans le vrai.
12:26 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (4)
mercredi, 13 mars 2013
Demy, 7 : l’image de la mère
 La mère, chez Demy, a, heureusement pour elle, une meilleure image que celle du père.
La mère, chez Demy, a, heureusement pour elle, une meilleure image que celle du père.
Elle est fille-mère (Geneviève dans Les Parapluies, Violette dans Une chambre en ville), est veuve et vit avec sa ou ses filles (Mme Desnoyers dans Lola, Mme Émery dans Les Parapluies de Cherbourg, Yvonne Garnier dans Les Demoiselles de Rochefort, la mère de Violette dans Une chambre en ville), a son mari en prison et vit seule avec sa fille (Marie-Hélène de Lambert dans Trois places pour le 26).
 Variantes : elle espère le retour de son mari et vit seule avec son fils (Lola dans Lola), elle est veuve s’entendant mal avec sa fille et vivant dans le souvenir de son fils décédé (Mme Langlois dans Une chambre en ville).
Variantes : elle espère le retour de son mari et vit seule avec son fils (Lola dans Lola), elle est veuve s’entendant mal avec sa fille et vivant dans le souvenir de son fils décédé (Mme Langlois dans Une chambre en ville).
Elle est entraîneuse (Lola dans Lola), commerçante (Mme Émery et Yvonne Garnier, déjà citées), modèle (Lola dans Model Shop), coiffeuse (Irène de Fontenoy dans L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune), vendeuse (Violette, déjà citée), bourgeoise prostituée (Édith dans Une chambre en ville).
La constance de Demy à nous présenter cet éternel couple veuve-fille qui, malgré quelques différends, s’aime beaucoup, fait qu’on se demande parfois si lui-même ne se rêve pas en fille seule avec sa mère, le père écarté pour cause de décès ou d’emprisonnement.
Seule Irène de Fontenoy, déjà citée, a une famille classique : père-mère-fils, mais voilà que le père se retrouve enceint.
À ces situations renouvelées et perpétuées à la fois, s’ajoute la différence de classes comme dans Une chambre en ville : Guilbaud est métallurgiste, Mme Langlois, autrefois baronne de Neuville, est veuve d’un colonel. Comme il est fréquent chez un fils d’ouvriers, on remarque chez Demy une certaine déférence envers l’aristocratie, censée protéger le peuple alors que les bourgeois l’oppriment, supposée apprécier les arts alors que les bourgeois détestent les artistes. On trouve une deuxième aristocrate, la baronne de Lambert, mais celle-ci est, au vrai, une ancienne entraîneuse : elle est devenue baronne par son mariage avec un baron, tandis que la première, baronne de Neuville, avait fait, en épousant un militaire, le colonel Langlois, une mésalliance : elle était devenue une bourgeoise, par ailleurs ennemie de sa classe (« Ça vous épate la bourgeoisie qui, comme moi, s’envoie en l’air. Moi, voyez-vous, Guilbaud, j’emmerde les bourgeois »). Mais la bourgeoisie, par le biais des CRS qu'elle paie et qui la protègent, tuera Guilbaud, entraînant ainsi la mort d’Édith, fille de Mme Langlois. Celle-ci, après avoir perdu son mari et son fils, verra sa fille se suicider sous ses yeux... dans la minute qui suit la mort de Guilbaud, laquelle a lieu devant Violette, enceinte de lui. Tout cela est très gai, certes.
La différence de classe est présente aussi dans Les Parapluies de Cherbourg, où elle est double : Mme Émery est une commerçante rêvant de toujours davantage s’embourgeoiser alors que Guy Foucher, mécanicien dans un garage, est un ouvrier ; mais Roland Cassard, devenu diamantaire richissime (lui qui était sans situation dans Lola), est un plus grand bourgeois qu’elle, et cela pèse évidemment dans la balance lorsqu’elle est séduite par lui et qu’elle l’épouse indirectement en influençant sa fille pour qu’elle devienne Mme Cassard. 
Si Guy pouvait, par ses seules qualités, espérer séduire et conserver la jeune marchande de parapluies, il ne peut plus faire face lorsqu’apparaît Cassard, avec son pardessus, sa Mercédès et ses joyaux (et, ajoutons-le pour être juste, son amour sincère pour Geneviève, dont il adopte l’enfant à venir). En résumé, Guy pouvait gravir un échelon, pas deux ou davantage. Il perd la partie (une partie dont il ne savait même pas qu’il était en train de la jouer et dont le dernier pli est levé durant son absence) et retourne à son milieu d’orphelin élevé par sa marraine, tante Élise, vaincu socialement, mais vainqueur par l’amour enfin révélé de Madeleine, la jeune infirmière.
17:10 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 12 mars 2013
Demy, 6 : d’un opéra populaire à l’autre

Pourquoi le film Une chambre en ville n’a-t-il pas reçu un accueil aussi enthousiaste que Les Parapluies de Cherbourg ? Tous deux sont des opéras populaires, tous deux sont entièrement chantés.
Comme de coutume, il n’y a pas de raison unique, mais un ensemble de causes.
La musique de Michel Colombier, magnifique partition, n’est pas aussi chantante que celle de Legrand. On ne peut pas isoler d’airs, détacher des « chansons » du contexte.
La lutte des classes « paie » moins, au cinéma – ou dans ce que les spectateurs de Demy attendent faussement de lui ? – que les amours malheureuses. Et pourtant, les amours malheureuses sont aussi présentes dans Une chambre en ville, ô combien.
Les grèves de 1955 aux chantiers navals de Nantes intéresseraient-elles moins le public que la guerre d’Algérie ? 
Dans Les Parapluies, Geneviève est infidèle : elle se lasse assez vite d’attendre son amoureux parti à la guerre, emporte avec elle l’enfant qu’il lui a fait et épouse Cassard, qui donnera son nom à la fille de Guy. Cela serait-il mieux accepté que François Guilbaud abandonnant purement et simplement Violette enceinte de ses œuvres, au milieu d’un marché où l’on balaie les détritus ? Est-ce que, par hasard, le public ne saurait aimer Guilbaud après cet acte lâche, minable, la passion qu’il vit avec Édith ne le dédouanant pas, sa mort tragique ne l’excusant pas, celle d’Édith se suicidant sous les yeux de tous les protagonistes du film ne rachetant rien ?
On compte deux suicides (dont un particulièrement violent, sur le plan visuel) et une mort tragique dans la dernière partie du film : serait-ce trop pour être accepté ?
La stylisation d’Une chambre en ville est-elle plus grande que celle des Parapluies ? Ces grévistes qui lancent sur les CRS des pavés imaginaires, des pavés ramassés nulle part et qu’ils ne portaient pas dans leurs mains avant l’affrontement, seraient-ils moins crédibles que Guy et Geneviève montés sur le travelling et paraissant glisser, flotter dans leurs rêves d’amour, au lieu de marcher comme ils sont censés le faire ?

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 11 mars 2013
Demy, 5 : la figure du père
 Chez Demy, le père est absent : le plus souvent décédé, ou bien parti, et même en prison. Quand, d’aventure, il est présent, il se nomme M. Fournier (La Baie des anges), exerce la profession d’horloger, ce qui suppose, au moins dans le film, un caractère strict, précis, et porte une blouse blanche. Il est autoritaire, fermé, il ne veut pas le savoir. Parfois, un substitut de père apparaît, en la personne du patron : le garagiste Aubin, par exemple (Les Parapluies de Cherbourg). Aubin, lui aussi, porte une blouse blanche, ce qui n’est pourtant pas le plus courant dans un atelier de mécanique.
Chez Demy, le père est absent : le plus souvent décédé, ou bien parti, et même en prison. Quand, d’aventure, il est présent, il se nomme M. Fournier (La Baie des anges), exerce la profession d’horloger, ce qui suppose, au moins dans le film, un caractère strict, précis, et porte une blouse blanche. Il est autoritaire, fermé, il ne veut pas le savoir. Parfois, un substitut de père apparaît, en la personne du patron : le garagiste Aubin, par exemple (Les Parapluies de Cherbourg). Aubin, lui aussi, porte une blouse blanche, ce qui n’est pourtant pas le plus courant dans un atelier de mécanique.
Parfois, après être parti, il revient, mais c’est toujours longtemps après, plusieurs années parfois, et il est encore vêtu de blanc, comme Michel (Lola). Cela ne l’empêche pas de repartir quelque temps plus tard, cette fois pour de bon. On trouve aussi le père du sketch La Luxure, tout juste bon à distribuer des gifles au fils qui pose une question. Ou le père ultra-conservateur et autoritaire de Lady Oscar, qui décide que sa fille sera un garçon et finit, des années plus tard, par se battre avec elle à l’épée.
Souvent, les personnages ignorent qui est leur père. C’est le cas de Cécile (Lola) : elle ignore que son oncle Aimé est en réalité son père. C’est le cas de Françoise Cassard (Les Parapluies de Cherbourg) : elle ignore que Guy est son père et qu’elle devrait s’appeler Foucher. C’est le cas de Boubou (Les Demoiselles de Rochefort) : il ignore que Simon Dame est son père. C’est le cas de Delphine et de Solange (Les Demoiselles de Rochefort) : elles ignorent qui est leur père et portent le nom de leur mère, Garnier. C’est le cas de l’enfant que porte Violette (Une chambre en ville) : il ignorera que François Guilbaud est son père. C’est le cas de Marion (Trois places pour le 26) : elle s’appelle Lambert quand elle devrait s’appeler Montand ; elle ignore que Montand est son père et va pousser jusqu’au bout le rêve d’inceste qui traverse toute l’œuvre de Demy.
Parfois, le père est tout bonnement en prison : le baron de Lambert, père adoptif de Marion (Trois places pour le 26) a cet avantage d’ainsi ne déranger personne. Ici, le père est un pur et simple escroc. Parfois, il vit loin, son fils lui téléphone et leur conversation tourne court à force d’incompréhension : c’est ce qui arrive à George (Model Shop).
Les autres fois, le père est mort. M. Émery, père de Geneviève (Les Parapluies de Cherbourg). Le colonel Langlois, père d’Édith (Une chambre en ville). Ou bien il vend sa fille au fils du baron (Le Joueur de flûte). À moins qu’il ne veuille l’épouser (Peau d’âne). Ou qu’il soit enceint (L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune).
On l’aura compris, le portrait du père, chez Demy, n’est guère reluisant. M. Demy père, le garagiste, a-t-il tant dressé son fils contre lui, au moins inconsciemment, en refusant au début sa vocation de cinéaste, en voulant à tout prix qu’il aille au collège technique apprendre un métier manuel, avant de céder au bout d’un long moment devant l’obstination du jeune Jacques ?
09:49 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 10 mars 2013
Pour sauver le plus beau film du monde
« La société familiale Ciné-Tamaris a besoin de votre aide pour numériser, restaurer le film et le proposer aux normes actuelles de projection ».
J’ai vu, il y a quelques jours, que la famille Demy-Varda lançait un appel, une sorte de souscription pour sauver Les Parapluies de Cherbourg et permettre de continuer à exploiter le film, en le restaurant en numérique. Le pourquoi du comment, la méthode et le suivi de l'opération sont présentés sur une page spéciale, qui explique tout en détail. On peut verser de 1 à 6. 000 euros avec, chaque fois, d'amusantes et artistiques contreparties. Voici le lien :
http://www.kisskissbankbank.com/il-faut-sauver-les-parapluies-de-cherbourg
20:30 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 09 mars 2013
À la retraite
Vieille bique,
J’ai reçu l’autre jour un acte administratif intitulé « Arrêté de radiation des cadres », avec effet du 30 septembre prochain. Voilà que vous vous faites annoncer plusieurs mois à l’avance. Ce doit être pour me laisser le temps de dérouler le tapis rouge, le tapis gris, plutôt, à l’instar de cette comptine où l’on parle aussi de pomme de reinette.
Ainsi, vous allez enfin venir me rendre visite. Depuis si longtemps, je vous attendais et d’absurdes décisions gouvernementales venaient en permanence retarder notre hymen. Vous savez, il est ainsi des gens – on les appelle des personnalités – qui prennent des décisions dans un bureau, et ces décisions engagent votre vie, votre vie à vous, mais ils s’en moquent. Les personnalités ne connaissent pas les personnes.
J’aurai donc espéré notre liaison durant quarante et un ans. Il faut savoir se montrer patient, quelquefois, mais la patience a un défaut rédhibitoire, elle fait blanchir les cheveux et, parfois, les fait perdre. Vous conviendrez que perdre les cheveux des autres est fort culotté. C’est un peu comme si je m’avisais, moi, de faire perdre son temps à la durée. La durée de cotisation, naturellement.
Je suis du genre fidèle, j’espère que vous l’êtes et le serez aussi et que vous ne me claquerez pas dans les doigts sans crier gare, à peine célébrée et consommée notre future union. Ce serait inélégant et, toute vieille dame que vous soyez, il faudra maintenir coûte que coûte votre élégance. Il y va de notre réputation et je ne saurais marcher dans la rue, une traîtresse à mon bras. Ayez à cœur de vivre avec moi aussi longtemps qu’il nous plaira conjointement.
07:00 Publié dans Apostrophes insolites | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 08 mars 2013
Demy, 4 : de la récurrence
En littérature, en bande dessinée, les personnages récurrents sont aisés à animer. Il suffit à l’auteur de désirer les faire apparaître et réapparaître. Au cinéma, c’est bien plus difficile : les acteurs doivent être toujours vivants, intéressés par le nouveau projet et, bien entendu, libres au moment du tournage.
En dépit de ces obstacles, Demy qui, au commencement de son aventure, voulait réaliser cinquante films, pas moins, et que toutes ces œuvres soient liées entre elles (il n’est malheureusement pas parvenu à ses fins) a tout de même abouti au schéma suivant.
Personnages récurrents, présents à l’écran ou simplement évoqués
Jackie Demaistre : La Baie des anges ; évoquée dans Model Shop.
Michel : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Mme Desnoyers : Lola ; évoquée dans Les Demoiselles de Rochefort ; évoquée dans Une chambre en ville.
Cécile : Lola ; évoquée dans Model Shop.
Lola : Lola ; évoquée dans Les Parapluies de Cherbourg ; Model Shop.
Roland Cassard : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg ; évoqué dans Model Shop.
Frankie : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Yvon : Lola ; évoqué dans Model Shop.
Aimé : évoqué dans Lola ; évoqué dans Les Demoiselles de Rochefort.
M. Favigny : évoqué dans Lola ; évoqué dans Trois places pour le 26.
Dambiel : Une chambre en ville ; évoqué dans Trois places pour le 26.
Il était par ailleurs question que Guy (Les Parapluies de Cherbourg) réapparaisse dans Les Demoiselles de Rochefort, mais cela n’a pu se faire.
À noter que Demy s’autorise une mise en abyme au milieu d’une récurrence : lorsque Lola, personnage récurrent du film Lola, évoque, dans Model Shop, son passé et, en même temps, celui de Michel, d’Yvon, de Frankie, de Cassard et de Jackie Demaistre, le réalisateur ajoute Catherine Deneuve, citée, elle, comme actrice, par le truchement d’un magazine glissé sous l’album de photographies de Lola.
Toutefois, l’univers du cinéaste se prolonge dans le sens de la récurrence, à travers une série de lieux et de situations.
Lieux et situations
Cafés tenus par des femmes : Lola ; Les Demoiselles de Rochefort.
Mères vivant seules avec leurs filles : Lola (Mme Desnoyers et Cécile) ; Les Parapluies de Cherbourg (Mme Émery et Geneviève) ; Les Demoiselles de Rochefort (Yvonne Garnier et les jumelles) ; Une chambre en ville (la baronne et Édith) ; Trois places pour le 26 (la baronne et Marion).
Pères absents, ailleurs ou décédés : Lola (Cécile rejoint son oncle Aimé à Cherbourg, sans savoir qu’il est son père) ; Les Parapluies de Cherbourg (père de Geneviève décédé) ; Les Demoiselles de Rochefort (jumelles sans père ; Boubou ne sait pas que M. Dame est son père) ; Une chambre en ville (père d’Édith décédé) ; Trois places pour le 26 (père adoptif de Marion en prison ; Marion passe la nuit avec Montand, sans savoir qu’il est son père).
Femmes enceintes sans mari : Les Parapluies de Cherbourg ; Une chambre en ville.
Marraines influentes : Les Parapluies de Cherbourg ; Peau d’âne.
Baronnes désargentées : Une chambre en ville (baronne qu’une mésalliance a faite colonelle et qui, veuve, doit louer une chambre à un ouvrier) ; Trois places pour le 26 (entraîneuse devenue baronne, mais le baron est ruiné et sous les verrous).
Dîner à trois (veuve, fille et Cassard) : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg.
Enfer : Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Parking.
Foires, fêtes foraines, carnavals : Lola ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Le Joueur de flûte.
Forains ou artistes arrivant en ville et amenant l’action avec eux : Les Demoiselles de Rochefort ; Le Joueur de flûte ; Trois places pour le 26.
Personnages partant, devant partir bientôt ou désirant partir : Lola ; La Baie des anges ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Model Shop ; Peau d’âne ; Le joueur de flûte ; Trois places pour le 26.
Personnages se croisant, au début sans se connaître : Lola ; La Baie des anges ; Les Parapluies de Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ; Une chambre en ville ; Trois places pour le 26.
Homosexualité, bisexualité, ambiguïté sexuelle : Lady Oscar ; La Naissance du jour ; Parking.
Inceste ou sentiment incestueux : Lola ; Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Les Demoiselles de Rochefort ; Peau d’âne ; Une chambre en ville ; Trois places pour le 26.
Ports : Lola (Nantes) ; La Baie des anges (Nice) ; Les Parapluies de Cherbourg (Cherbourg) ; Les Demoiselles de Rochefort (Rochefort-sur-Mer) ; Une chambre en ville (Nantes) ; Trois places pour le 26 (Marseille).
Librairies : Lola ; Les Sept péchés capitaux (sketch La Luxure) ; Trois places pour le 26.
Petits commerces : Lola (coiffure) ; La Baie des anges (horlogerie) ; Les Parapluies de Cherbourg (magasin de parapluies ; garage) ; Les Demoiselles de Rochefort (magasin de musique) ; L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune (coiffure ; auto-école) ; Une chambre en ville (magasin de télévision) ; Trois places pour le 26 (parfumerie).
Passage Pommeraye : Lola ; mentionné dans Les parapluies de Cherbourg ; Une chambre en ville.
Principaux lieux où se concentre l’action et où se retrouvent tous les personnages : Les Parapluies de Cherbourg (magasin de parapluies) ; Les Demoiselles de Rochefort (café sur la place) ; Une chambre en ville (chez la baronne).
Rendez-vous donné « à huit heures devant le théâtre » : Lola (Lola à Cassard) ; Les Parapluies de Cherbourg (Geneviève à Guy).
Voitures noires survenant comme de mauvais présages : La Baie des anges (Citroën de Caron) ; Les Parapluies de Cherbourg (Mercédès de Cassard) ; Parking (Porsche de Caron).
Ces relevés, peut-être non exhaustifs, montrent que les films sont davantage liés entre eux, qu’il n’y paraît au lu d’une simple liste de personnages récurrents. Ils montrent encore la cohérence absolue du monde de Demy. On note que la récurrence, qu’elle soit des personnages, des lieux ou des situations, se manifeste indépendamment du genre des films (opéras populaires filmés, comédies musicales, films avec chansons, contes) et de la technique (noir et blanc, couleur).


Marc Michel joue Roland Cassard dans Lola et dans Les Parapluies de Cherbourg


Anouk Aimée joue Lola dans Lola et dans Model Shop
07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 07 mars 2013
Demy, 3 : demeurer un chef-d’œuvre
Pourquoi le film Les Parapluies de Cherbourg demeure-t-il un chef-d’œuvre ? Au moment de son tournage, pouvait-on se douter qu’il ferait le tour du monde et que, cinquante ans plus tard, on en parlerait encore, mieux : que la ville de Cherbourg organiserait des manifestations commémoratives ?

Comme toujours, il n’y a pas de réponse et l’on ne peut avancer que l’exposé d’une série de causes, d’un faisceau de raisons. L’authenticité absolue du cinéaste, évidemment. L’invention géniale d’un genre, naturellement. La création de couleurs et de costumes encore jamais vus, en tout cas, jamais vus réunis. La rencontre parfaite, faut-il le dire, de deux créateurs, deux artistes, Demy et Legrand, et l’osmose de leur collaboration. L’exigence et la rigueur de l’auteur, palpables dès la première vision, vérifiables au long des dizaines qui suivirent. La fluidité d’un filmage et d’un montage, parfaitement incontestables. La photographie, juste et précise, d’une société donnée à une époque donnée, tellement juste et tellement précise que, paradoxalement, elle sort du temps et devient universelle, un peu comme ces photographies de classes qui deviennent, avec les années, l'école elle-même.
Et ce film magnifique, non content de ramasser le prix Delluc et la Palme d’or au passage, comme sans s’en apercevoir, révèle et consacre en même temps un réalisateur, un compositeur, une productrice et une actrice. Seulement.

Les Parapluies de Cherbourg : tournage de la scène du départ de Guy, sur le quai de la gare : le travelling arrière est effectué à une vitesse différente de celle du train, ce qui crée un bel effet visuel (Photo DR, Ciné-Tamaris).
07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (8)
mercredi, 06 mars 2013
Demy, 2 : le plus beau film du monde
 Je ne sais pas de film plus réellement populaire, plus réussi que la merveille de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, avec la musique de Michel Legrand. C’est une fête somptueuse, bâtie sur un argument cruel au possible, œuvrée dans un décor aux couleurs inimaginables.
Je ne sais pas de film plus réellement populaire, plus réussi que la merveille de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, avec la musique de Michel Legrand. C’est une fête somptueuse, bâtie sur un argument cruel au possible, œuvrée dans un décor aux couleurs inimaginables.
Tout ici est une réussite, du générique où se croisent les parapluies filmés à la verticale, à la dernière image, celle de cette station-service dans la nuit, sous la neige de Noël, avec toutes ses lumières, tel un gâteau blanc sous le rouge cerise des pompes à essence. De la partition remarquable en tous points, qui a su permettre de chanter l’intégralité du texte, même lorsqu’il était extrêmement prosaïque (les scènes qui se déroulent au garage Aubin, par exemple), à la voix des chanteurs doublant les comédiens, qui furent tenus de jouer sur un rythme plus lent qu’au naturel. De ce choix de couleurs plus que vives (on peut même dire que certaines nuances furent absolument inventées en 1964) au contraste qu’il crée, justement, avec la noirceur du thème. C’est bien d’un opéra qu’il est question, non d’une simple comédie musicale. L’ambition même du genre s’oppose à la modestie de Guy, de Geneviève et de Mme Emery, de Madeleine ou de tante Élise. On narre une histoire triste, de tous les jours, qui, avec des personnages communs, banals, se déroule dans des milieux modestes dans une ville de province, à une époque, la plus conformiste qui soit. Mais on a fait appel à tous les talents, à toutes les inventions, on a servi le film avec amour et, de là, naît un authentique et incontestable chef-d’œuvre.
Si notre société n’a strictement plus rien à voir avec celle qui est montrée dans ce film, on le regarde encore aujourd’hui d’un œil que la nostalgie n’a même pas besoin d’attendrir. Parce qu’il reste présent, quotidien. Tour de force artistique, cette œuvre est à la fois « décalée » et « en phase » par rapport à nous. Ce qui aurait pu n’être qu’une délicieuse bluette, même tournant mal, ne se démodera jamais parce qu’ayant touché à l’universel. Cette histoire reste un bout du génie de l’humanité, un trésor de la création populaire bien comprise, respectueuse de son public et authentiquement engagée dans une démarche d’artiste consciente.
Ce film mémorable supporte plutôt bien d’être vu sur un petit écran, ce qui est rare. Il ne s’éloigne jamais, en effet, de l’intimisme inhérent à son sujet, même si la toile de fond est celle de la guerre d’Algérie, historique. Ce n’est pas pour autant un spectacle « familial » car, s’il arrive qu’on y pleure des larmes jamais vulgaires, il pourrait bien se produire aussi que l’injustice du destin y révolte des cœurs tendres.
 Des esprits jeunes, en effet, souffriront de voir Mme Emery pousser Geneviève, enceinte de Guy, à épouser Roland Cassard, diamantaire protecteur. Ils comprendront mal qu’elle n’ait pas absolument tort d’agir ainsi, contexte socioculturel aidant. Ils donneront à Guy, soldat absent, toute leur sympathie, au détriment de Cassard.
Des esprits jeunes, en effet, souffriront de voir Mme Emery pousser Geneviève, enceinte de Guy, à épouser Roland Cassard, diamantaire protecteur. Ils comprendront mal qu’elle n’ait pas absolument tort d’agir ainsi, contexte socioculturel aidant. Ils donneront à Guy, soldat absent, toute leur sympathie, au détriment de Cassard.
Et pourtant, risquons un point de vue différent de celui couramment partagé. Même en sachant, cela se voit à l’écran, que Mme Emery épouse Cassard par procuration en lui donnant sa fille, il reste que Cassard est réellement désintéressé, amoureux et sincère ; il sauve littéralement Guy d’un échec futur puisque, Cassard ou pas, enceinte ou non, Geneviève est bel et bien en train de l’oublier (« C’est drôle, l’absence ») parce que deux ans de séparation, c’est bien long, sans téléphone possible, au hasard de courriers qui n’arrivent pas. Guy et Geneviève, réunis, auraient couru au désastre. Allons, Cassard n’est pas si mal venu, n’est-ce pas ? Même si Geneviève l’épouse sans amour. Madeleine n’est pas qu’une consolation pour Guy car elle l’a, elle, toujours aimé en silence et attendu avec patience ; elle se serait effacée si elle l’avait dû, elle ne demande rien, jamais, ne réclame aucun sentiment qui n’aurait pas lieu d’être ; c’est Guy qui lui demande de rester, après la mort d’Élise qu’elle aura assistée jusqu’au bout. C’est avec elle et grâce à l’héritage d’Élise que Guy réalisera ses projets. C’est elle qui peut façonner son bonheur. Et c’est durant son absence d’un moment, à la fin du film, que revient Geneviève, par hasard (un hasard qui, alors qu’elle rallie Paris au départ de l’Anjou, la fait passer par Cherbourg !), prendre de l’essence pour la Mercedes de Cassard, qu’elle conduit à présent. Cette même Mercedes que Guy n’a pas pu réparer, au début, parce qu’il ne pouvait pas faire une heure supplémentaire, et pour cause : il allait au théâtre... avec Geneviève. Qu’allaient-ils voir et entendre ? Un opéra. Cette scène ultime, dure mais si bien notée, pour ainsi dire décalquée dans le carnet de dessins de la vie tant elle est évidente pour qui a connu un bout d’amour une fois dans son existence, peut révolter les cœurs intègres. En attendant qu’ils en vivent un jour une copie, peut-être sans musique et sans trop de couleurs cette fois.

07:00 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (2)
mardi, 05 mars 2013
Demy : que conseiller ?
 Si je devais recommander des films de Jacques Demy à quelqu’un qui ignorerait tout de ce cinéaste prodigieux, que choisirais-je ? Sans doute ne choisirais-je pas et dirais-je : « Il faut regarder, plusieurs fois de préférence, l’intégrale publiée il y a quelques années et qui, comme toute intégrale, ne l’est pas puisqu’il y manque deux courts-métrages de commande, mais enfin, ce n’est pas très grave puisque Demy ne les reconnaissait pas vraiment comme siens ».
Si je devais recommander des films de Jacques Demy à quelqu’un qui ignorerait tout de ce cinéaste prodigieux, que choisirais-je ? Sans doute ne choisirais-je pas et dirais-je : « Il faut regarder, plusieurs fois de préférence, l’intégrale publiée il y a quelques années et qui, comme toute intégrale, ne l’est pas puisqu’il y manque deux courts-métrages de commande, mais enfin, ce n’est pas très grave puisque Demy ne les reconnaissait pas vraiment comme siens ».
Mais encore ? Si je devais ? Eh bien, j’indiquerais évidemment les deux films qui ressortent d’un genre littéralement inventé par Demy, l’opéra populaire filmé. Inventé, oui, puisque personne n’avait jamais osé cela auparavant et que personne n’a plus jamais tenté de le faire ensuite, une fois le cinéaste disparu. Un genre, donc, définitivement marqué par lui, porteur de son empreinte, qui n’a rien à voir avec la comédie musicale stricto sensu, dont il a par ailleurs dessiné l’image à la française.
Un genre nouveau, qui l’est resté, où tout le texte, sans exception, est chanté. Opéra, puisqu’entièrement chanté. Populaire, puisque compréhensible. Filmé, pour la première fois. C’est tout simplement merveilleux.
On aura reconnu Les Parapluies de Cherbourg, que je tiens pour le plus beau film du monde, excusez du peu, et que j’ai dû voir vingt ou trente fois… pour le moment, car j’ai bien l’intention de continuer. On aura reconnu Une chambre en ville, qui n’eut pas le même succès, peut-être parce que le thème était plus noir encore que celui des Parapluies, peut-être parce que la musique de Michel Colombier contenait moins d’« airs » que celle de Michel Legrand. Pourtant, il s’agit ici de deux tragédies, raison de plus pour ne pas parler de comédies.
Après avoir regardé ces deux œuvres extraordinaires, il faudra poursuivre, explorer cent fois cet univers extrêmement bouleversant, traversé en permanence par les obsessions du cinéaste (bisexualité, inceste), où se promènent des personnages récurrents, où les destins se croisent, toujours dans l’amertume, où les amours ratent, sont condamnées par les guerres ou les grèves, où la figure du père, presque toujours absente, est montrée une fois ou deux d’une manière péjorative, où tous les clins d’œil et citations sont disséminés (comprenne qui pourra), où les personnages qu’on ne revoit pas physiquement sont cependant nommés au cours du dialogue, où, dans un port ou un autre, l’on va de départ en rupture, de désillusion en espoir caduc, où la pudeur de l’auteur vient farder tout cela de chansons et de gammes chromatiques éblouissantes... Bien entendu, on gagnera infiniment à regarder tout cela dans l’ordre chronologique.
univers extrêmement bouleversant, traversé en permanence par les obsessions du cinéaste (bisexualité, inceste), où se promènent des personnages récurrents, où les destins se croisent, toujours dans l’amertume, où les amours ratent, sont condamnées par les guerres ou les grèves, où la figure du père, presque toujours absente, est montrée une fois ou deux d’une manière péjorative, où tous les clins d’œil et citations sont disséminés (comprenne qui pourra), où les personnages qu’on ne revoit pas physiquement sont cependant nommés au cours du dialogue, où, dans un port ou un autre, l’on va de départ en rupture, de désillusion en espoir caduc, où la pudeur de l’auteur vient farder tout cela de chansons et de gammes chromatiques éblouissantes... Bien entendu, on gagnera infiniment à regarder tout cela dans l’ordre chronologique.

14:28 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 04 mars 2013
Bourrades
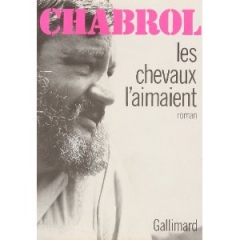 Je me souviens de Jean-Pierre Chabrol signant ses ouvrages à la fête du journal L’Humanité, à la Courneuve, en septembre 1972. Il me dédicace son roman, paru chez Gallimard, Les chevaux l’aimaient. Il note : « À Jacques Layani, avec une bourrade complice des vents rebelles ». Son écriture est à sa mesure : elle occupe la page entière. J’ai longtemps été très fier de cette dédicace. Quarante et un ans passèrent. La semaine dernière, j’avisai, vendu d’occasion chez Gibert, un autre exemplaire des Chevaux. Je l’ouvris et, l’espace d’un instant, me demandai ce que mon livre faisait là. Même écriture, évidemment, mais aussi même encre (un stylo-feutre bleu), pour cette dédicace, sans aucun doute rédigée le même jour : « À M. Untel, avec une bourrade complice de nos tramontanes rebelles ». Sacré Chabrol ! Je ne suis pas choqué, je comprends parfaitement qu’on s’autorise, lorsqu’on signe à tire-larigot, à écrire à peu près la même chose à chacun. Finalement, le plus étonnant est que, dans une agglomération de douze millions d’habitants, je tombe, moi, sur un livre revendu, porteur de ce texte de 1972, presque identique au mien, alors que nous sommes en 2013.
Je me souviens de Jean-Pierre Chabrol signant ses ouvrages à la fête du journal L’Humanité, à la Courneuve, en septembre 1972. Il me dédicace son roman, paru chez Gallimard, Les chevaux l’aimaient. Il note : « À Jacques Layani, avec une bourrade complice des vents rebelles ». Son écriture est à sa mesure : elle occupe la page entière. J’ai longtemps été très fier de cette dédicace. Quarante et un ans passèrent. La semaine dernière, j’avisai, vendu d’occasion chez Gibert, un autre exemplaire des Chevaux. Je l’ouvris et, l’espace d’un instant, me demandai ce que mon livre faisait là. Même écriture, évidemment, mais aussi même encre (un stylo-feutre bleu), pour cette dédicace, sans aucun doute rédigée le même jour : « À M. Untel, avec une bourrade complice de nos tramontanes rebelles ». Sacré Chabrol ! Je ne suis pas choqué, je comprends parfaitement qu’on s’autorise, lorsqu’on signe à tire-larigot, à écrire à peu près la même chose à chacun. Finalement, le plus étonnant est que, dans une agglomération de douze millions d’habitants, je tombe, moi, sur un livre revendu, porteur de ce texte de 1972, presque identique au mien, alors que nous sommes en 2013.
10:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)



