jeudi, 22 novembre 2012
Un Janus jauni

Ainsi donc, l’UMP se donne le ridicule public d’étaler ses dissensions, jalousies et rivalités. À son aise. Tant que se mangeront entre eux ces loups grotesques, on ne regrettera pas ce gaspillage de barbaque avariée. Car au vrai, qui imagine encore qu’il puisse exister, entre Copé et Fillon, la moindre différence authentique ? Ces deux hommes représentent les deux faces d’un Janus jauni dont nous ne voulons pas, les deux aspects des mêmes intérêts, qui ne sont pas les nôtres. L’un joue les provocateurs populistes et tente de séduire sur sa dextre par des sornettes et des vulgarités. L’autre se pose en bon élève sérieux, « gendre idéal » quoique un peu décrépit. La peste soit de ces gens comme de ceux qui les entourent, et que leur égo les étouffe.
Zundapp Janus, modèle 1958
16:17 Publié dans Humeur | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 20 novembre 2012
Pascal Pia tel qu’on l’habille
Cette note complète et développe celle publiée ici-même, le 24 avril 2012, sous le titre Pia s’habille chez le Lérot. Elle traite, du point de vue de la conception éditoriale, de l’ensemble des articles publiés par l’excellent chroniqueur littéraire dans l’hebdomadaire Carrefour.
Pascal Pia est certainement le plus grand critique littéraire de son temps, en tout cas celui dont les articles sont, aujourd’hui encore, les plus goûteux. Écrivant cela, je n’apprendrai rien à personne, et certainement pas à ceux qui ont lu, par exemple, son Apollinaire, qui fait toujours autorité.
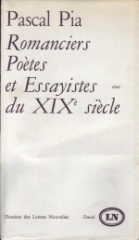

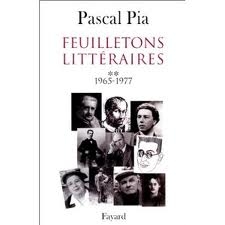 Deux nouveaux tomes ont en effet paru, longtemps plus tard, en 1999 et 2000, chez Fayard, avec l’aide du Centre national du Livre (CNL). Cette fois, on constate avec plaisir que l’édition est correcte : ordre chronologique de parution initiale des feuilletons, claire indication de la livraison d’origine. Et puis, voici une surprise : si l’on trouve ici des articles consacrés à des auteurs du XIXe siècle parus après 1971 et n’ayant donc pu être compilés dans l’édition précédente, on en lit aussi, qui eussent dû logiquement en faire partie et ont été oubliés, ou non retenus. Les deux préfaces sont de l’inévitable Nadeau. Hélas, il suffit de tenir ces volumes en main pour s’apercevoir que leur réalisation est une hérésie : papier trop blanc, police de caractères d’un corps insuffisant, poids considérable et cartonnage souple qui ne résiste pas au nécessaire temps de lecture (chaque ouvrage compte quelque neuf-cents pages au format 16 x 24, 5 cm). On n’a pas prévu de table des matières, et flanqué chaque tome de quatre index mal faits : présentés à l’identique quand ils sont d’usage différent, ils prêtent à confusion et comportent, de plus, des omissions. Il y avait matière à proposer quatre tomes au lieu de deux, ou bien aurait-on dû employer un papier-bible, infiniment plus léger et d’une exquise matité. Lire ces livres autrement qu’assis à une table est une gageure. Dans les transports en commun, cela relève de la provocation. Les emporter avec soi tient du pari athlétique et d’un entraînement de longue durée. Surtout, ils s’avèrent moins solides que celui édité en 1971, ce qui en dit long sur ce qu’est devenu le traitement physique, matériel, de la chose imprimée. Au bout du compte, on peut penser que ces livres ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits pour être vendus.
Deux nouveaux tomes ont en effet paru, longtemps plus tard, en 1999 et 2000, chez Fayard, avec l’aide du Centre national du Livre (CNL). Cette fois, on constate avec plaisir que l’édition est correcte : ordre chronologique de parution initiale des feuilletons, claire indication de la livraison d’origine. Et puis, voici une surprise : si l’on trouve ici des articles consacrés à des auteurs du XIXe siècle parus après 1971 et n’ayant donc pu être compilés dans l’édition précédente, on en lit aussi, qui eussent dû logiquement en faire partie et ont été oubliés, ou non retenus. Les deux préfaces sont de l’inévitable Nadeau. Hélas, il suffit de tenir ces volumes en main pour s’apercevoir que leur réalisation est une hérésie : papier trop blanc, police de caractères d’un corps insuffisant, poids considérable et cartonnage souple qui ne résiste pas au nécessaire temps de lecture (chaque ouvrage compte quelque neuf-cents pages au format 16 x 24, 5 cm). On n’a pas prévu de table des matières, et flanqué chaque tome de quatre index mal faits : présentés à l’identique quand ils sont d’usage différent, ils prêtent à confusion et comportent, de plus, des omissions. Il y avait matière à proposer quatre tomes au lieu de deux, ou bien aurait-on dû employer un papier-bible, infiniment plus léger et d’une exquise matité. Lire ces livres autrement qu’assis à une table est une gageure. Dans les transports en commun, cela relève de la provocation. Les emporter avec soi tient du pari athlétique et d’un entraînement de longue durée. Surtout, ils s’avèrent moins solides que celui édité en 1971, ce qui en dit long sur ce qu’est devenu le traitement physique, matériel, de la chose imprimée. Au bout du compte, on peut penser que ces livres ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits pour être vendus.
 Enfin, le solde (le solde ?) des chroniques que Pia rédigea pour Carrefour – il en restait à colliger ! – fut présenté en 2012 par un éditeur artisanal connaissant son métier. Ce livre est incontestablement le plus beau et le plus réussi des quatre et, pour cela, il mérite qu’on s’y attarde.
Enfin, le solde (le solde ?) des chroniques que Pia rédigea pour Carrefour – il en restait à colliger ! – fut présenté en 2012 par un éditeur artisanal connaissant son métier. Ce livre est incontestablement le plus beau et le plus réussi des quatre et, pour cela, il mérite qu’on s’y attarde.
Plus de cinq cents pages d’assez grand format (18 x 24 cm), de petits caractères serrés, des cahiers cousus et collés, non massicotés, une couverture rempliée, une impression en offset. S’agirait-il d’un volume d’il y a plusieurs décennies ? Point du tout, on est ici dans la maison dite « du Lérot », chez Étienne Louis, cet éditeur de Tusson (Charente) qui persiste dans l’érudition et le beau livre de conception traditionnelle.
Si l’on en croit Jean-Jacques Lefrère qui a préparé l’édition et l’a préfacée, d’aucuns s’abonnaient à Carrefour uniquement pour les articles de Pia. La période considérée s’étend de 1954 à 1977. On nous assure qu’il n’existe ici aucun doublon avec le contenu des trois parutions antérieures. C’est dire l’extraordinaire quantité de livres que Pia a pu chroniquer en plus de vingt ans d’exercice.
On observe que chaque feuilleton a sensiblement la même longueur que les autres, Pia ayant bénéficié, dans le journal, d’une rubrique fixe. Quatre pages, la dernière n’étant pas toujours entièrement pleine. Il arrive néanmoins que l’article soit plus long, atteignant cinq pages. Chacun traite d’une œuvre, parfois de deux, plus rarement de trois ou quatre. Dans ce cadre bien délimité, Pia use de phrases qui pourront paraître longues au lecteur d’aujourd’hui – elles sont pourtant simples, bien articulées, construites solidement : c’est notre regard qui a changé, pas en bien, et les habitudes de lecture.
On est frappé par l’érudition du critique, sa bienveillance qui cependant ne censure jamais le regret d’une faiblesse ou d’une insuffisance de l’auteur considéré, son humour léger, permanent, et même par un brin d’ironie arboré à fleur de sourire, comme à la boutonnière. Tout cela est servi par une langue, faut-il le dire, impeccable.
Une iconographie abondante est reproduite en fin de volume, et non au milieu comme la vogue des biographies en a généralisé la pratique. Ceci, encore, qui n’existe plus : un papillon encarté dans le livre signale deux minimes errata dans les légendes.
Et si cinquante euros, c’est une somme, il reste que cela ne représente pas plus – voire moins – que les deux tomes typographiquement « gonflés » qu’on n’aurait pas manqué de nous imposer, si ce livre avait été réalisé par un éditeur commercial sur l’immonde papier d’une presse Cameron, cette erreur historique, cette monstruosité de l’imprimerie.
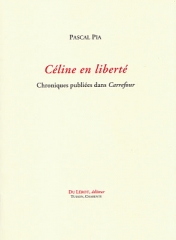
Est-ce terminé ? Non, car, parallèlement, en 2011, les éditions du Lérot ont repris, sous le titre Céline en liberté, qu’elles ont choisi, les dix articles que Pia avait consacrés dans Carrefour aux œuvres de l’écrivain. Quatre de ces textes sont des doublons, six autres complètent les ouvrages dont j’ai parlé, si bien que ce volume de quatre-vingts pages de format 15 x 21 cm, présenté par Jean-Paul Louis, vient encore s’ajouter aux précédents. On peut le comprendre puisqu’il s’agit en quelque sorte d’une anthologie thématique. Ce recueil souffre, inévitablement, des mêmes maux que celui de 1971. Rapprocher des textes parus à des écarts importants aboutit ici et là à créer des redondances. On ne s'arrêtera pas à cela.
Au total, cette œuvre, car le mot convient qui se présente seul sous la plume, représente environ trois mille pages, souvent grandes et toujours serrées. Le fait qu’il ne s’agisse ici que des « papiers » donnés à Carrefour laisse songeur : on n’a pas encore recueilli ceux du Magazine littéraire ou de La Quinzaine littéraire.
Bien que Pia n’ait jamais conçu ses articles selon un plan d’ensemble – tout au contraire, il chroniquait les ouvrages qu’il recevait, ce qui aurait dû interdire le regroupement factice effectué par Nadeau – il est devenu banal d’affirmer que l’ensemble de ces feuilletons forme, par-delà la critique au riche sens du mot, une véritable histoire de la littérature d’expression française, au travers de ce qui fut, durant de longues années, proposé en librairie. Cependant, la chose est réelle et cela constitue une raison supplémentaire de regretter la disparate de sa publication.
Il conviendrait de refaire une édition complète, qui serait repensée et réimprimée dans un esprit unique, en six ou sept volumes sur bible, par exemple, car, dans l’immédiat, on jurerait une construction dont nombre d’architectes successifs auraient repris les plans d’origine, en les modifiant à leur guise. Ne rêvons pas, cela n’existera pas.
16:49 Publié dans Pascal Pia | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 09 novembre 2012
Skyfall, une parfaite réussite
JE DOIS PRÉCISER, SELON LA FORMULE HABITUELLE, QUE CET ARTICLE DÉVOILE UN GRAND NOMBRE DE POINTS-CLÉS DU FILM.
Cet article a été précédemment publié sur trois forums consacrés à Bond.
Contexte
J’ai vu Skyfall samedi 27 octobre après-midi, vingt-quatre heures après sa sortie, en version originale sous-titrée. À Paris, avenue des Gobelins, à 13 h. Dans les premiers rangs, se tenaient des gamins de douze ou treize ans, et je me suis dit que j’avais cet âge lorsque j’allais découvrir Bons baisers de Russie. À ceci près que j’étais avec mes parents, eux étaient entre eux, formant un petit groupe. Les temps changent. Il n’en reste pas moins que, dans la salle, se pressaient quatre générations, ce qui m’a amusé.
Genre du film
La presse l’avait dit et répété à satiété : on se situe entre un film d’action et un film d’auteur, et ce tout au long de ce nouvel opus. C’est précisément ce qui m’a enchanté. Tous les codes habituels sont respectés, sans appuyer trop, sans artifice, et pourtant, c’est un film d’auteur, à l’esthétique incontestable : filmage, montage, photographie, tout est très bon. Sam Mendès signe à la fois un Bond et un Mendès, je trouve cela très bien. Il faudrait vraiment faire la fine bouche pour ne pas reconnaître que le film des cinquante ans est réussi, de haut niveau, et marquera l’histoire de la série.
Les journaux l’avaient aussi répété : le film joue en permanence sur l’opposition entre les anciens et les modernes, balançant de l’un à l’autre. Bond est-il un personnage ancien qui ne peut plus servir à rien puisque Q peut tout faire, de son bureau, avec une machine et quelques écrans, ou même de chez lui, en pyjama et avant son thé, comme il l’affirme lui-même ? Ou bien se révèle-t-il indispensable, lorsqu’il faut se battre ou dépasser la technologie dans la recherche de l’humain ? Tout au long de l’œuvre, les scénaristes jonglent avec cette opposition, adoptant tantôt un point de vue, tantôt l’autre, mais justifiant Bond au bout du compte, évidemment. Je pense que, s’agissant du cinquantenaire de la série, ce débat ne pouvait être évité. C’était une bonne façon de la remettre sur les rails, après quatre années de silence.
Bien évidemment, il ressort de cela qu’il n’y a pas lieu d’opposer l’ancien et le moderne, qui sont complémentaires.
Gunbarrel
Oui, il est à la fin et cela n’a effectivement pas de raison d’être, sinon que ça annonce la mention habituelle, la formule magique : James Bond will return.
Je n’ai aucune preuve de ce que j’avance, c’est très intuitif, mais quelque chose me dit que ce sera désormais toujours comme ça. De toute façon, nous n’y pouvons rien, nous pourrons toujours le regretter mais, dans quelques années, les plus jeunes, qui auront toujours connu le gunbarrel à la fin, se demanderont comment on a bien pu le supporter, placé au début.
Générique
Magnifique générique, enchaînant parfaitement avec le pré-générique et la chute. Bond coule, et place au graphisme magnifique et luxurieux. Évidemment, on passe abruptement de la couleur au noir et blanc (sauf à considérer le noir et blanc comme une couleur, je veux dire : comme un choix). Bien sûr, il y a beaucoup de choses dans ce générique, on peut avoir l’impression d’un fouillis, mais ce n’est pas la mienne ; il faudra d’ailleurs le revoir pour en étudier la composition de plus près.
Craig
Quand je pense qu’il y aura encore des spectateurs pour ne pas apprécier Craig dans le rôle de Bond… Il est incontestable, il l’était déjà depuis Casino Royale, mais comment, désormais, lui nier la pleine possession du personnage, en même temps que la création de quelque chose de profondément personnel, qui s’impose et s’imposera sans coup férir ? Il est impeccable. Rien à ajouter.
M Sans conteste le personnage principal du film. Depuis longtemps, elle prenait de plus en plus d’importance dans les scénarios et, sur un autre forum, je m’en étais félicité, quand d’autres le regrettaient. Ici, c’est le summum et comme ça ne pouvait pas aller plus loin, elle disparaît à la fin.
Sans conteste le personnage principal du film. Depuis longtemps, elle prenait de plus en plus d’importance dans les scénarios et, sur un autre forum, je m’en étais félicité, quand d’autres le regrettaient. Ici, c’est le summum et comme ça ne pouvait pas aller plus loin, elle disparaît à la fin.
Elle disparaît intelligemment, c’est-à-dire qu’on n’a pas l’impression que tout a été conçu dans le but de lui fournir une sortie sur mesures, après une série de films étalée sur plusieurs années, durant lesquelles elle a tenu le rôle avec une autorité et une justesse incontestables.
Faire de M une femme n’avait rien d’évident. Elle est passée par là et aujourd’hui, on se demande si Mallory sera à la hauteur pour lui succéder (je pense que oui, bien sûr).
Plus que jamais, ses rapports avec Bond relèvent de la relation mère-fils. Ça, c’était déjà dans Fleming, où Bond avait pour M (Sir Miles Messervy) une considération importante, un respect profond. Ce qui transparaissait d’ailleurs dans les premiers films où M (Bernard Lee) était le seul devant qui Sean Connery se faisait parfois petit garçon –- et ça marchait très bien.
Cette fois, Bond a perdu sa mère, c’est évident. Pas Monique Delacroix, l’épouse d’Andrew Bond, mais M. Elle meurt dans ses bras, il pleure. Qui plus est, cela se passe sur les lieux de son enfance, dans cette maison où, justement, il a appris autrefois la mort de ses parents et s’est caché durant deux jours dans le souterrain. « Quand il est ressorti, il n’était plus un enfant », dit le vieux garde-chasse, personnage secondaire admirable, interprété magnifiquement et porteur d’une très grande capacité de sympathie.
M lègue à Bond son chien de porcelaine horrible et ridicule avec le drapeau anglais sur le dos, symbole de leur complicité toujours un peu tendue, mais toujours fidèle.
Je crois que nous pouvons remercier Judi Dench pour ce qu’elle a fait du rôle depuis qu’elle l’a pris en charge. C’était vraiment excellent.
Silva
Un fou malade, magistralement interprété. Pour une fois, il ne veut pas conquérir le monde, ni, sans doute, s’enrichir. Son organisation, dont on ne sait pas à quoi elle sert, il l’a montée on ne sait pourquoi. En attendant, ce film est l’histoire de sa vengeance. Il a avec M, lui aussi, un rapport mère-fils. Il ne lui pardonne pas de l’avoir « trahi » lorsqu’elle l’a échangé contre six autres agents. Il a été détruit par cet abandon maternel. À la fin, d’ailleurs, il veut mourir avec elle et de sa main. Il l’appelle « maman », et la scène d’homosexualité, qui ne me choque pas du tout, montre, à mon avis, qu’il considère un peu tous les agents comme ses frères (comme étant tous des enfants de M, en quelque sorte). Donc, Bond est vécu comme son frère et Silva devient incestueux. Je ne veux pas faire de psychanalyse de bazar, je ressens vraiment cela comme ça. Silva est bisexuel, ça existe, pourquoi cela n’aurait-il pas sa place dans un Bond ?
Séverine
Le personnage est envoyé à la mort très vite. À la limite, on se demande pourquoi il existe. C’est vrai, il n’est pas suffisamment exploité, voire pas du tout. Je me demande donc ce qu’on peut en dire vraiment : on ne sait pas à quoi sert Séverine.
Q Quand on a annoncé, il y a plusieurs mois déjà, que Q serait un si jeune homme, j’ai été extrêmement sceptique. Je me trompais. Non seulement, Q est devenu un champion de l’informatique, mais il est interprété à la perfection. D’avance, je savoure le moment où on le retrouvera parce qu’il est vraiment bien, et solide dans son rôle.
Quand on a annoncé, il y a plusieurs mois déjà, que Q serait un si jeune homme, j’ai été extrêmement sceptique. Je me trompais. Non seulement, Q est devenu un champion de l’informatique, mais il est interprété à la perfection. D’avance, je savoure le moment où on le retrouvera parce qu’il est vraiment bien, et solide dans son rôle.
Eve
Ainsi donc, Eve est bien Moneypenny, alors que, depuis un an, tout le monde s’employait à faire taire la rumeur qui lui attribuait le rôle. Mais on ne l’apprend qu’à la fin, lorsqu’elle se glisse derrière un bureau qui, curieusement, et comme celui du nouveau M, retrouve l’aspect d’antan, alors que tout le film joue de la toute-puissance de l’informatique et de la technologie. On est effectivement dans une nouvelle forme de recommencement. Bah, ce n’est pas la première fois que la chronologie est bousculée dans la série, ni la vraisemblance. J’ai énormément apprécié le jeu de l’actrice, je l’ai trouvée vivante, active, subtile. Naturellement, comme tous se le demandent, était-il indispensable qu’elle fût noire ? Reste qu’on va la revoir dans les épisodes futurs.
Reste aussi une question : après la scène du rasage, dit « à l’ancienne », est-ce qu’elle couche ou pas avec Bond ? Si oui – et c’est vraisemblable –, alors, Bond a couché avec Moneypenny, ça, c’est vraiment une première.
Mallory
Je crois que Ralph Fiennes va être un excellent M. En tout cas, il est un très bon Mallory, tout au long du film. Il est blessé lors de la scène du tribunal, à laquelle il prend une part active. Finalement, comme M, il est, dans cet épisode, lui aussi sur le terrain, au moins durant un moment, lorsque la salle d’audience est prise d’assaut par Silva et ses sbires.
Clins d’œil
Innombrables et toujours fins et discrets, heureusement.
Défauts
Le scénario laisse en plan quelques problèmes sans solution.
En premier lieu, cette histoire de disque non récupéré à la fin du film. Il est totalement invraisemblable que M ait pu perdre un tel disque. Mais il est encore plus invraisemblable qu’un tel disque ait pu exister. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on le sait : au minimum, les informations ultra-confidentielles qu’il contient auraient dû être scindées en plusieurs disques, détenus, par exemple, l’un par le Premier ministre, l’autre par le ministre de la Défense, le troisième par M elle-même. En aucun cas, un service secret ne fera une bourde pareille. Cela dit, c’est le point de départ de l’histoire. Il n’y aurait pas eu de film, sans cela.
En deuxième lieu, pourquoi Patrice abat-il l’acheteur du Modigliani ? Je n’ai qu’une hypothèse à avancer. La formidable organisation de Silva, dont on ignore la raison d’être, doit bien être financée d’une manière ou d’une autre. J’imagine qu’il doit recourir au blanchiment d’argent, au trafic de drogue, bref, le b-a-ba du métier. Et également à la vente de tableaux volés. En tuant l’acheteur qui est sans doute venu avec la somme demandée, on peut prendre l’argent et « vendre » le tableau plusieurs fois. Qui voit une autre explication ?
Le cyanure n’a pas réussi à tuer Silva, mais a détruit sa mâchoire et ses dents. Curieusement, il n’a pas détruit sa langue, on se demande pourquoi.
14:05 Publié dans Fauteuil payant | Lien permanent | Commentaires (6)


